
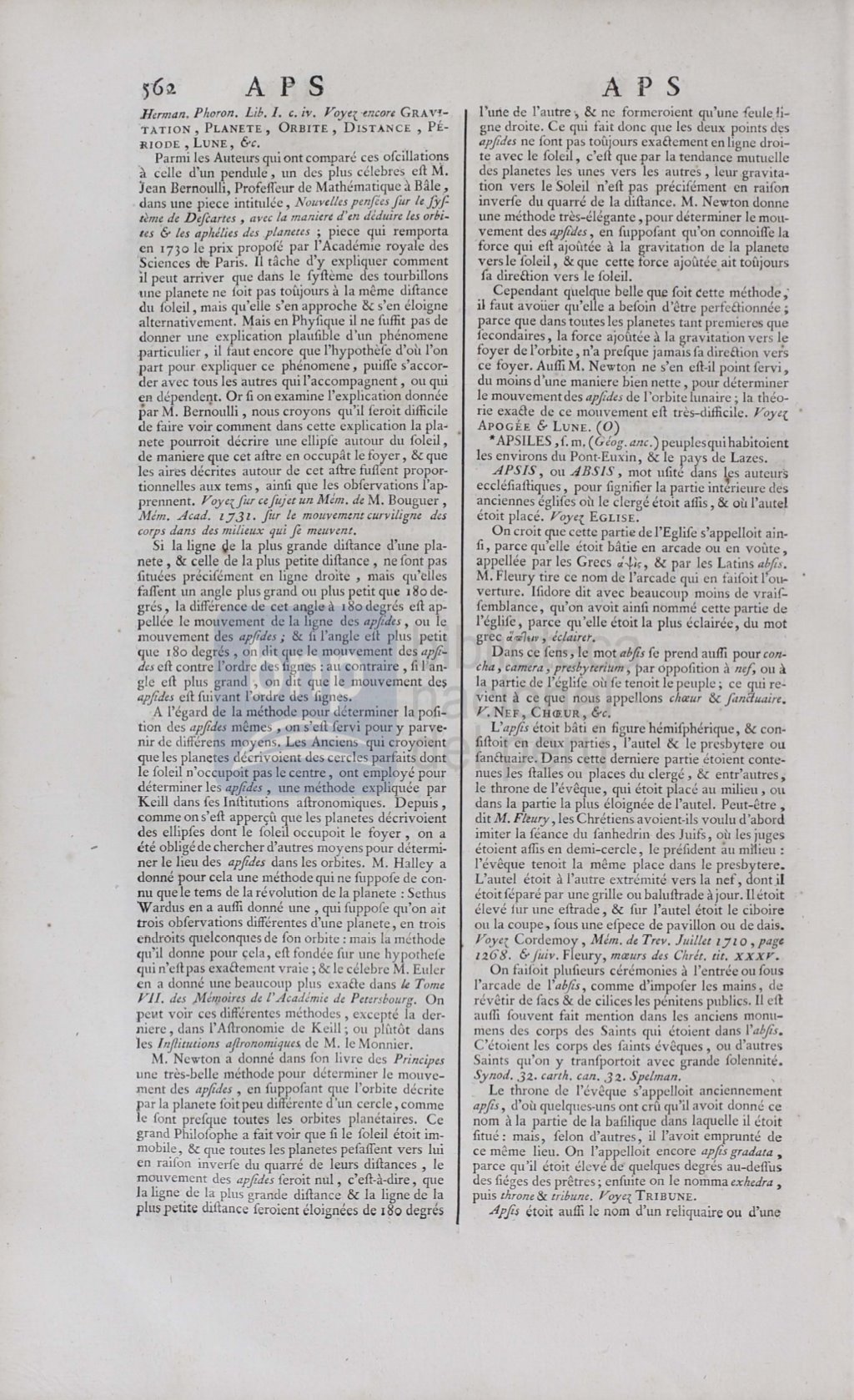
APS
Hemlan. PIlOTan. Lib.
1.
e. iv. ,voye{ -eneore
GRA
Vf–
TATION, PLANETE, ORBITE, DISTANCE , PÉ–
RIODE , LUNE,
&e.
Parmi les Auteurs qui ont comparé ces ofcillatio1}s
a
celle d'un pendule, un des
plu~ cél~bres e~
M.
Jea
n Bernolllli, Profeífeur de Mathemau,que a
BaI~,
dans une piece intindée,
NO/tve/les penfees fur le jyf
teme de D eflartes
,
avee la maniere
~'en dM~tire
les orbi–
les
&
les apJ¡élies des planeees
;
plece qUl remporta
en
1730
le prix propofé par l'Acadé.mie royale des
Sciences de Paris. 11 dkhe d'y expltquer comment
11
pellt arriver que dans le fytteme des tourbillons
-une planete ne {oit pas tOlljOurS
a
la meme dillance
dn
foleil , mais qu'ell.e s'en approch.e
&
s'en éloigne
alternativement. Mals en l>hyíique il ne fuffit pas de
dOIU1er une explication plauftble d'un phénomene
particulier, il f¡mt encore que l'hypothefe d'oh l'on
part pour expliquer ce phénomene, puiífe s'accor–
der avee tousles autres qui I'accompagnent, ou qui
~F1
dépendeI}t. Or fi on examine
l'ex~licatio.n d~
)1ln.éepar M. Bernoulli , nous croyons qu II/er<:Ht difficile
de faire voir comment dans cette exphcauon
la
pla–
nete pOUIToit décrire une ellipfe autour du foleil,
de maniere que cet attre en occupat le foyer,
&
que
les aires décrites autour de cet afrre fuirent propor–
tionnelles aux tems, ainfi que les obfervations l'ap–
prennent.
Voye{fur cefiljet un Mém. de
M. Bouguer ,
Mém. A cad.
lj
3
lo
jitr le mouyemtnt euryiligne des
eorps
dans
des milieux qui fe mellvent.
Si la ligne Qe la plus grande dittance d'une pla–
nete ,
&
celle de la plus petite difrance, ne font pas
firuées pn!cifément en ligne droite , mais qu'elles
fairent un angle plus grand ou plus petit que
180
de–
grés, la différence de cet angle
a
180
degrés efi ap–
pellée le mouvement de la ligne des
apJides,
ou le
mouvement des
apjides;
&
íi l'angle eH plus petit
que
180
degrés , on dit (lue le mouvement des
apji~
des
ett contre l'ordre des fignes ; au contraire , íi l'an–
gle efi plus grand , on dit que le mouvement des
apjides
efi fuivant l'ordre des fignes.
A l'égard de la méthode pour déterminer la pofi–
tion des
apjides
memes , on s'efi fervi pour y parve–
nir <le différens moyens. Les Anciens
qui
croyoient
que les p1anetes décrivoient des cercles parfaits dont
le foleil n'occupoit pas le centre, ont employé pour
détermÍner les
a,pjides ,
une méthode expliquée par
Keill dans fes lnfritutions afironomiqlles. Depuis,
comme on s'efi apperc;:í'l que les planetes décrivoient
des ellipfes dont le foleil occupoit le foyer, on a
été obligédechercherd'autres moyenspour détermi–
ner.lelieu des
apjides
dans les orbites. M. Halley a
d0nné pour cela une méthode qui ne fuppofe de con–
nu quele tems de la révolution de la planete ;Sethus
Wardus en a auffi donné une, qui fllppofe qu'on ait
trois obfervations différentes d'une planete, en trois
endroits quelconqlles de fon orbite ; mais la méthode
qll'il donne pour cela, efi fondée fUT une hypothefe
(Jui n'efipas exat1ement vraie;
&
le célebre M. Euler
en a donné une beaucoup plus exat1e dans
le
Tome
,v1I. des ,M¿flJoires de l'Aeadémie de Puersbourg.
On
pe14t voir ces différentes méthodes , excepté la der–
niere, dans l'Afuonomie de Keill ; ou pllltat dans
les
Injlitutiolls ajlronomiques,
de M. le Monnier.
M. Nemon a donné dans fon livre des
Principes
une tres-belle méthode pour détem1Íner le mouve–
ment des
apJides
,
en fuppofant que I'orbite décrite
par la planete foit peu différente d'tm cercle, comme
le fom prefque toutes les orbites planétaires. Ce
grand Philofophe a fait voir que fi le foleil étoit im–
mobile,
&
que toutes les planetes pefaífent vers hu
en raifon invene du quarré de lems difiances , le
mO:lvement des
apfLdes
feroit nul, c'efi-a-dire, que
la ligne de la plus grande d.i1l:ance
&
la ligne de la
plus petite diftance feroient éloignées de 180 degrés
A P S
l'une de I'sutre .,
&
ne formeroient qu'une {eule.!i–
gne droite. Ce qui fait done que les deux poÍnts des
apjides
ne fom pas toújours exat1ement en ligne droi–
te avec le foleil, c'efi que.par la tendance muruelle
des planetes les unes vers les autres, leur gravita–
tion vers le Soleil n'efi pas précifément en raifon
invene du quan'é de la difiance. M. Newton dOIU1e
une méthode tres-élegante ,ponr déterminer le mou–
vement des
apji'des,
en fuppofant qu'on connoiífe la
force qui efi ajolltée
a
la
~ravitation
de la planete
vers le foleil,
&
que cette force ajoCltée ait tOlljours
fa diret1ion vers le foleil.
Cependant q\.telque belle que foit éette méthode;
il
faut avoiier qu'elle a befoin d'etre perfet1ionnée;
paree que dans toutes les planetes tant premieres que
{econdaires, la force ajolltée a la
~ravitation
vers le
foyer de I'orbite, n'a prefqlle jamats fa diret1ion
veis
ce foyer. Auffi M. Newtqn ne s'en efi-il point fervi,
du moÍns d'une maniere bien nette , pour déterminer
le mouvementdes
apjides
de I'orbitc lunaire; la théo–
rie exaéle de ce mouvement efr tres-difficile.
,voye{
ApOGEE
&
LUNE.
(O)
*
APSILES ,f.m.
(Géog.allc.)
peuplesquihabitoient
les environs du Pont-Euxin,
&
le pays de Lazcs.
APSIS,
on
ABSIS,
mot uíite dans \es autcll1's
eccléíiailiques, pour fignifier la parrie interieure des
anciennes églifes on le clerge étoit affis,
&
olll'autel
étoit placé.
,voye{
EGLISE.
On croit que cette partie del'Eglife s'appelloit ain–
íi, paree qu'elle étoit batie en arcade ou en voute,
appellée par les Grecs
,,'{k,
&
par les Latins
affis–
M. Fleury tire ce nom de l'arcade qlu en faifoit
1
ou–
verture. Iíidore dit ave
e
beaucollp moins de vraif–
femblance, qu'on avoit ainíi nommé cerre partie de
l'églif;;
parc~ ~I'elleétoitla
plus éclairée, du mot
grec
"-,.n",,
eclaLTet.
Dans ce fens, le mot
abJis
fe prend auffi pour
con–
cha, camera> presbyeerillm,
par óppoíition a
nef,
OU
a
Ja partie de l'églife ou fe tenoit le peuple; ce qui re–
vient a ce que nous appellons
cMmr
&
fanauaire.
V.
NEF,
CH<EUR,
&e.
L'apjis
étoit bati en figure hémifphérique,
&
con–
íifioit en denx parties, l'autel
&
le presbytere ou
fant1uaire. Dans cerre derniere partie étoient conte–
nues les fialles ou places du clergé,
&
entr'autres.
le throne de l'évl!que, qui étoit placé au milieu, OH
dans la partie la plus éloignée de l'aute!. Peut-etre,
dit
M . Füury,
lesChrétiens avoient-ils vOlllll d'abord
imiter la féance du fanhedrin des Juifs,
011
les juges
étoient affis en demi-cercle,
le
préíident
im
ml1ieu :
l'éveque tenoit la meme place dans le presbytere.
L'aurel étoit a I'autre extrémité vers la nef, dont
il
étoit féparé par une grille ou balull:rade
11.
jour.llétoit
élevé fur une eíhade,
&
fur ¡'antel étoit le ciboire
ou la coupe, fous une efpece de pavillon ou de dais.
,voye{
Cordemoy,
M ém. de Trev. JuiLLet
Ijl
O,
page
I268.
&
jiúv.
Fleury,
mreurs des Chréc. tito
XXXV.
On faiíoit plufieurs cérémonies a l'entrée ou fOllS
I'arcade de
l'abJis,
comme d'impofer les mains, de
révetir de faes
&
de cilices les pénitens pllblics. II eíl:
auffi fOl/vent fait mention dans les anciens monu–
mens des corps des Saints qui étoient dans
l'abJis.
C'étoient les corps des faints éveques, ou d'autres
Saints qu'on y tranfportoit avee grande (olennité.
Synod.
32.
eanh. can.
32.
Spelman.
,
Le throne de l'éveque s'appelloit anciennement
apjis,
d'oll quelqnes-uns ont cri't qn'il avoit donné ce
nom
11.
la partie de la baft.!ique dans laquelle il étoit
íitué; mais, felon d'autres, ill'avoit emprunté de
ce meme lieu. On l'appelloit encore
apjis grada/a .
paree qu'il étoit élevé de quelques degrés au-dellus
des íiéges des pretres; enCuite on le nomma
e:-chedra •
puis
lhrollt& tribum. ,voye{
TRIBUNE.
Apjis
étoit auffi le oom d'un reliquaire ou d'une
















