
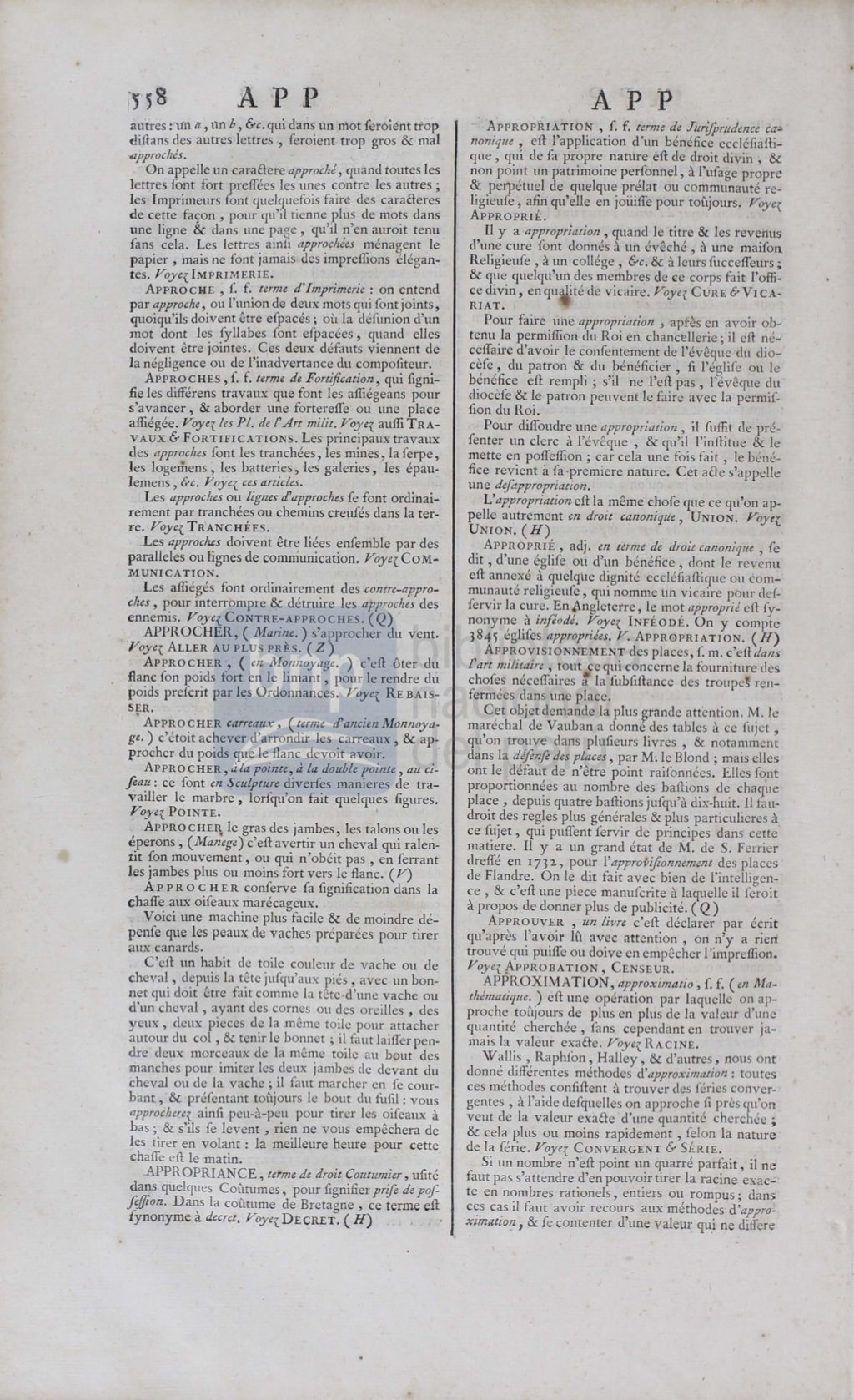
APP
autres :V!1
¡z,
no
b,
&e.
qui daos un mot feróiéot trop
diil:ans des autres lettres , feroient trop gros
&
mal
approchés.
On appelle un caraé1:ere
approeM,
quand toutes les
lenres font fort preífées les unes contre les autres ;
les Imprimeurs font 'luel'luefois faire des caraé1:eres
de cette fa<;on , pom qu'il tienne plus de mots dans
une ügne
&
dans une
pa~e,
qu'il n'en auroit tenu
fans cela. Les lettres ainh
approchées
ménagent le
papier , mais ne font jamais des impreffions élégao–
tes.
Voye{
IMPRIMERIE.
ApPROCHE , f. f.
terme d'Imprimerie
:
on entend
par
approclle,
OU l'union de deux mots 'lui font joints,
quoiqu'ils doivent etre efpacés; ou la défunion d'un
mot dont
les
fyllabes font efpacées, quand elles
doivent etre jointes. Ces deux défauts viennent de
la négligence ou de l'inadvertance du compofitem.
ApPROCHES, f. f.
terme de Fonifieation,
c¡ui figru–
ñe les différens travaux que fom les affiégeans pour
s'avancer,
&
aborder une fortereífe ou une place
affiégée.
Voye{ Les
Pi.
de L'Art miLito Voye{
auffi TRA–
VAUX
&
FORTIFICATIONS. Les principauxtravaux
des
approehes
font les tranchées, les mines, la ferpe,
les logemens , les batteries,
les
galeries, les épau–
lemens
,&c.
Y
oye{ ces anicles.
Les
approclus
ou
Lignes d'approc/'es
fe font ordinai–
rement par tranchées ou chemins creufés dans la ter–
re.
Voye{
TRANCHÉES.
Les
approches
doivent etre liées enfemble par des
paralleles oulignes de communication.
Voye{COM~
MUNICATION.
Les affiégés font ordinairement des
contre-appro–
des,
pour interrompre
&
détntÍre les
approches
des
ennernis.
Voye{
CONTRE-APPROCHES.
(Q)
APPROCHER, (
Marine.)
s'approcher du vento
roye{
ALLER AU PLUS PRESo
(Z)
ApPROCHER , (
en Monnoyage.
)
c'eí!: oter du
flanc fon poids fort en le limant, pour le rendre du
poids preferit par les Ordonnances.
Voye{
RE BAIS–
SER.
ApPRO CHER
earreallx, (terme d'ancÍen Monnoya–
ge.
)
c'étoit achever Q.'arrondir les carreaux,
&
ap–
procher du poids que le flanc devoit avoir.
ApPRO CHER,
ti
la pointe,
ti
La double pointe, all ci–
fi(/u:
ce font
en SClllpture
diverfes manieres de tra–
vailler le marbre, lorfqu'on fait quelques figures.
roye{
POlNTE.
•
ApPROCHEI\ le gras des jambes, les talons ou les
éperons,
(Manege)
c'eíl:avertir un cheval qtú ralen–
tit fon mouvement, ou qttÍ n'obéit pas , en ferrant
les jambes plus ou moins fort vers le flanco
(Y)
A PPRO CHE R conferve fa fignification dans la
chaífe aux oifeaux marécageux.
Voici une machine plus facile
&
de moindre dé–
penfe qtle les peaux de vaches préparées pour tirer
aux canards.
C'eí!: un habit de toile couleur de vache ou de
cheyal, depltÍs la tete jufqu'aux piés , avec un bon–
net qtli doit etre fait comme la tete·d'une vache ou
d'lm cheval , ayant des cornes ou des oreilles , des
yeux, cleux pieees de la meme toile pour attacher
autour du col,
&
tenir le bonnet ; il fam laiíferpen–
dre deux morceaux de la meme toile au bout des
manches p01U imiter les deux jambes de devant du
cheval ou de la vache; il fant marcher en fe cour–
bant,
&
préfentant tOlljours le bout dn film: vous
approc/,ere{
ainfi peu-a-peu pour tirer les oifeaux
a
bas;
&
s'ils fe levent , rien ne vous empechera de
les tirer en volant : la meilleure helue pour cette
chaífe eíl: le matin.
APPROPRIANCE,
terme de droit Coutumier,
ufité
daos quelques COlltumes, p01U fignifiel'
prife de pof–
fi(Jion.
Daos la coí'ttume de Bretagne , ce terme eí!:
(ynonyme
a
deem.
Voye{ DECRET.
(H)
APP
ApPROPRIATrON, f.
f.
temle de Juri../PmJence ca-–
Ilonique,
eí!: l'application d'un bénéfice eceléfiaíl:i–
que, (fUi de fa propre nature eíl: de droit divin,
&
non point un patrimoine perfonnel, a l'túage propre
&
perpétuel de qtlelque prélat ou commlmauté re–
ligieufe, alin CJlI'elle en joiiiífe pour tolljours.
V.rye{
ApPROPRIÉ.
1I
y
a
appropriation,
qtland le titre
&
les revenus
d'une cure font donnés
a
un éveché ,
a
une maifon
Religieufe , a un collége ,
&e.
&
a
leurs fucceífeurs;
&
que quelqu'un des membres de ce corps fait
1'0Ri–
ce divin, enc¡u ité de vicaire.
Voye{
CURE &VICA–
RIAT.
Pour faire une
appropriatÍoll
,
apl-(:s en avoir ob–
tenu la permiffion dn Roi en chancelterie; il eil: né...
ceífaire d'avoir le confentement de l'éyeque du (ÜO–
cefe, du patron
&
du bénéficier,
(¡
l'églife on le
bénéfice eí!: rempü ; s'il ne l'eíl: pas, l'éveque dl!
diocHe
&
le patron peuvent le faire avec la permif–
fion du Roi.
Pour diffoudre une
appropriation,
il fuffit de pré–
fenter un elerc
a
l'éveque ,
&
qu'il I'inil:itue
&
le
mette en poffeffion ; car cela une fois fait , le béné–
nce revient
a
fa ·premiere nature. Cet aél:e s'appelle
une
defappropriation.
L'
appropriation
eí!: la meme chofe que ce qn'on ap–
pelle autrement
en droit eanoniq/Le,
UNJON.
Voye{
UNJON.
(H)
ApPROPRIÉ, adj.
en terme de droit eanoniqlle
,
fe
dit , d'une églife ou d'tm bénéfice, dont le revenu
eí!: annexé a quelCJIle dignité eceléfiail:ique ou com–
munauté religieufe, qui nomme un vicaire pour deí–
fervir la cure. En
~ngletetre,
le mot
approprié
eil: fy–
nonyme
a
inflodé. V.rye{
INFÉoDÉ. On
y
compte
3845 églifes
appropriées.
V.
ApPR0PRIATION.
(H)
ApPROVISIONNEMENT des places, f. m.
c'eil:dans
tan miLitaire
,
tout ce ql1i concerne la fournirure des
chofes néceífaires a la fubflil:ance des
troupe~
ren–
fermées dans une place.
Cet objetdemande la plus
~rande
attention.
M.lemaréchal de Vauban a donne des tables a ce fujet ,
qtl'on trouve dans plnfieurs livres ,
&
notamment
dans la
déflnfi des plaees
,
par
M.leBlond ; mais elles
ont le défaut de n'etre point rai/onnées. Elles font
proportionnées au nombre des baíl:ions de cha(jue
place, depuis qtlatre baíl:ions jufqtl'a clix-huir. II fau–
droit des regles plus générales
&
plus particulieres
a
ce fujet, qui puífent fervir de príncipes dans cette
matiere. 11 y a un grand état de M. de S. Ferrier
dreífé en 1732, pour l'
approPijionmment
des places
de Flandrc. On le dit fait avec bien de I'intelligen–
ce ,
&
c'eí!: une piece manufcrite
11
laquellc il ¡Croit
a propos de donner plus de publicité. (
Q
)
ApPROUVER ,
un Livre
c'eíl: déclarer par écrit
'Iu'apres l'avoir
111
avec attention , on n'y a rien
trouyé qui puiífe ou doive en empecher l'impreffion_
Yoye{ApPROBATlON, CENSEUR.
APPROXIMATION,
approximatio,
f. f.
(en
Ma–
thématique.
)
eíl: une opération par laquelle on ap–
proche tOLljOurS de plus en plus de la valeur d'une
quantité cherchée, fans cependant en trouver ja–
mais
la
valeur exaé1:e.
Voye{
RAer E.
\Vallis , Raphfon, Haltey ,
&
d'autres, nous ont
donné différentes méthodes
d'approximation:
tomes
ces méthodes confiíl:ent
a
u'ouver des féries conver–
gentes, a l'aide defqtlelles on approche fi pres ql1'on
veut de la valeur exaé1:e d'une quantité cherchée;
&
cela plus ou moios rapidement , felon la natLUe
de la férie.
Voye{
CONVERGENT
&
SÉRIE.
Si un nombre n'eí!: point un qtlarré parfait, il ne
faut pas s'atrendre d'en pouvoir tirer la racine exac–
te en nombres rationels, enriers ou rompus; dans
ces cas il fallt avoir rccours aux méthodcs
d'appro–
ximlltion,
&
fe contenter d'une valenr ql1;i ne diJfere
















