
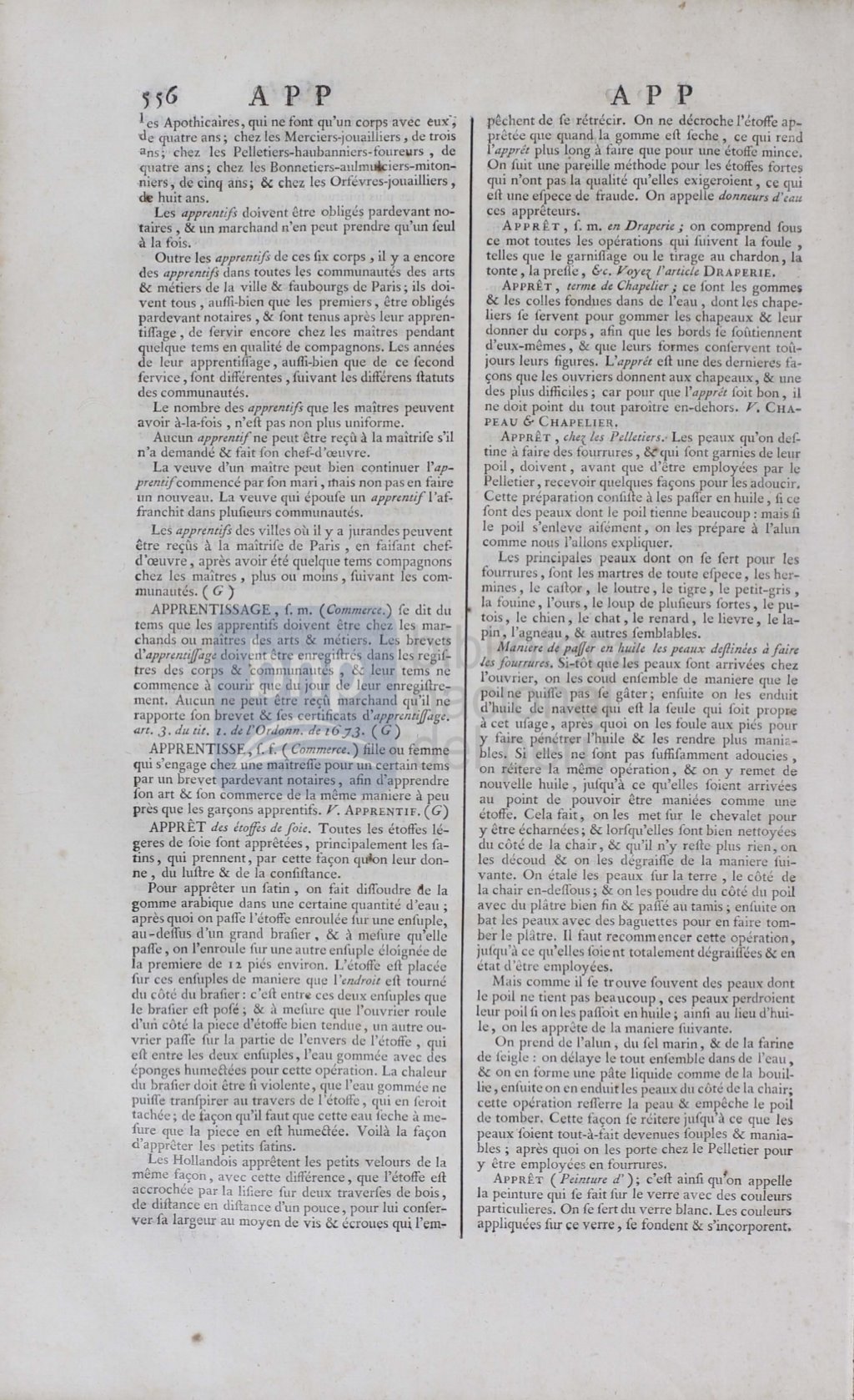
APP
les Apotlúcaires, qui ne fOn! qu'un corps avec eux,-;
-de qnatre ans; chez les Merciers-jouailliers, de trOls
ans' chez les Pelletiers-haubanniers-foureurs , de
qua~'e
ans; chez les
Bonnetiers-a.t~mu6ciers-~~ton
niers, de cinq ans;
&
chez les Orfevres-¡ouallliers •
d'E
huit ans.
Les
apprelllifs
doivent &tre obligés pardevant no–
taires,
&
1m marchand n'en peut prendre qu\m [eul
·a
la fois.
Outre les
apprentifs
de ces [¡x corps , ü y a encore
des
apprentifs
dans coutes les communautés des arts
&
métiers de la ville
&
faubourgs de Paris; üs doi–
vent tous , aufli-bien que les premiers, etre obligés
pardevant notaires ,
&
[ont tenus apr s leur appren–
tiirage, de [ervir encore chez les maltres
pend~nt
que!c¡ue tems en qualité de compagnons. Lcs annees
de leuI apprentiífage, auffi-bien que de ce [econd
fervice, font différentes ,fuivant les différens fiatuts
des communautés.
Le nombre des
appreneifs
que les maltres peuvent
avoir a-Ia-fois , n'ea pas non plus uniforme.
AUClm
apprentif
ne peut etre re(;.LI
a
la maitrife s'il
n'a demandé
&
faít {Oll chef-d'reuvre.
La veuve el'un maltre peut bien continuer
I'ap–
prentifcommencé
par fon mari , mais non pas en faire
un nouveau. La veuve qui époufe un
appreneif
I'af–
franchit dans pluúeurs communautés.
Les
apprentifs
eles villes oil ü y a jurandes peuvent
etre re<;l!s a la maltriCe de Paris , en faifant chef.
d'reuvre, apres avoir été quelque tems compagnons
chez les maltres, plus ou moins, [uivant les com–
munautés. (
G
)
APPRENTlSSAGE,
f.
m.
(Commerce.)
fe dit du
tems que les apprentifs doivent etre chez les mar–
chands ou maltres des arts
&
métiers. Les brevets
d'apprentiffage
doivent etre enrepifués dans les regif–
tres des corps
&
'communautes ,
&
leur tems ne
commence a comir que du jour de leur enregifue–
ment. Aucun ne peut etre re<;í\ marchanel qu'il ne
rapporte fon brevet
&
fes certificats
el'appremiffage.
arto
3 .
du tito
z.
dd'Ordonn. de
z6:/3.
(G) ,
APPRENTISSE, f. f. (
Commerce.
)
filIe ou femme
qui s'engage chez une ma¡treífe pour un certain tems
par un brevet parelevant notaires, afin d'apprendre
Con art
&
fon commerce de la meme maniere a peu
pres que les gar<;ons apprentifs.
r.
ApPRENTIF.
(G)
APPRET
des étoffis de Joie.
Toutes les étoffes lé–
geres de foie [ont appretées, principalement les fa–
tins, qui prennent, par cette falfon quien leur don–
ne, elu lufue
&
de la confillance.
Pour appreter un fatin, on fait diffoudre de la
gomme arabique dans une certaine quantité d'eau ;
apres quoi on paffe l'étoffe enroulée Ílu' une enfuple,
au - deffus d'un granel braúer,
&
a mefure qu'elle
paífe, on l'enroule fur une autre enfuple éloignée de
la premiere de
12.
piés environ. L'étoffe eft placée
{ur ces en[uples de maniere que
l'endroit
eft tourné
elu coté du braíier: c'eft entró! ces deux enfuples que
le brafler eft pofé;
&
¡\
mefme que l'ouvrier roule
cl'un coté la píece d'étoff'e bien tendue, un autre ou–
vrier paffe fur la partie ele l'envers ele l'écoffe , qui
eíl: entre les deux enfuples, I'eau gommée avec des
éponges humeétées pour cette opération. La chaleur
du braíier cloit etre [¡ violente, que l'eau gommée ne
puiffe tranfpirer au travers de l'étoffe, qui en feroit
tachée; de fa<;on qu'ü faut que cette eau [eche a me–
Cure que la piece en eft humeétée. Voila la falfon
d'appreter les petits [atins.
Les Hollandois appretent les petits velours de la
meme falfon, avec cette différence , que l'étoffe eft
accrochée par la liíiere [ur cleux traverfes de bois,
de diftance en diftance d'un pouce, pour lui
conCer–
ver fa 1argeur au moyen de vis
&
écrolles
qu~
!'em-
APP
pechent de fe rétrécir. On ne décroche
l'~toffe
ap–
pretée que quand la gomme eft [eche, ce qui rend
l'appret
plus long
a
faire que pour une étoffe rnince.
On [uit une pareille méthode pour les étoffes fortes
qui n'ont pas la qualité qu'elles exigeroient, ce qui
eft une efpece de fraude. On appelle
donneurs d'eau
ces appreteurs.
ApPR ~T,
f. m.
en Draperie;
on comprend fous
ce mot toutes les opérations qui [uivent la fouJe ,
telles que le garniífage ou le tirage au chardon, la
tonte, la prefl'e,
&c. Voye{ l'arúcle
DRAPERIE.
ApPRET,
ftrme de Chapelier;
ce font les gommes
&
les colles fondues dans de l'eau, dont les chape–
!iers fe fervent pour gommer les chapeaux
&
leur
donner du corps, afin que les bords
le
fOlltiennent
d'eux-memes ,
&
que leurs formes confervent tOll–
jours leurs figures.
L'apprét
efi une cles dernieres fa–
<;ons que les ouvriers donnent aux chapeaux,
&
une
des plus difficües; car pour que l'
app'¿t
foit bon, il
ne doit point du tout paroitre en-dehors.
r.
CHA–
PEAU
&
CHAPELIER.
ApPRET ,
che{ les Pelletiers.
Les peaux c¡u'on def–
tine a faire des fourrures ,
&
qui [ont garnies de 1em
poil, doivent, avant que d'etre employées par le
Pelletier, recevoir quelques fac;ons pour les adoucir.
Cette préparation confúte
a
les paffer en huüe, íi ce
font des peaux dont le poil tienne beaucoup: mais fi
le poil s'enleve aifément, on les prépare a l'alun
comme nous l'allons expliquer.
Les principales peaux clont on fe fert pour les
fourrures, font les martres de totlte ef¡Jece, les he\'–
mines, le cail9\', le loutre, le tigre, le petit-gris ,
la fouine, I'ours, le loup de pluíieurs fortes, le pu–
tois, le cbien, le chat, le renard, le lievre, le la–
pin, l'agneau,
&
autres femblab1es.
Maniere de paffer en Il/tile les peaux deflinées dJaire
les fourmres.
Si-tot que les peaux [ont arrivées chez
l'ouvrier, on les coud enfemble de maniere que le
poil ne puiífe pas fe gater; enfuite on les enduit
d'huile de navette qui efi la [eule qui foit propr-e
a cet ufage, apres quoi on les foule aux piés pour
y faire pénétrer I'huile
&
les rendre plus mani2-
bies. Si elles ne font pas fuffifamment adoucies ,
on réitere la m&me opération,
&
on y remet de
nouvelle huüe, jlúqu'a ce Cfil'elles foient arrivées
au point de pouvoir &tre maniées comme une
étoffe. Cela fait, on les met fur le chevalet pour
y etre écharnées;
&
lorfqu'elles [ont bien nettoyées
du coté de la chair,
&
~u'ü
n'y refte plus rien,on
les découd
&
on les degraiffe de la maniere
fi.¡j–
vante. On étale les peaux [ur la terre , le coté de
la chair en-deíI'ous;
&
on les poudre du coté clu poü
avec du pUitre bien fin
&
paffé au tamis; enfuite on
bar les peaux avec des baguettes pour en faire tom–
ber le platre. Il faut recommencer cette
op~ration,
julqu'a ce qu'elles foient cotalement dégraiffées
&
en
état d'etre employées.
Mais comme il [e trouve fouvent des peaux dont
le poil ne tient pas beancoup, ces peaux perdroient
leur poil íi on les paffoit en huüe; ainíi au lieu d'hui–
le, on les apprete de la maniere fuivante.
On prenel de l'alun, du fe! marin,
&
de la farine
de feigle : on délaye le tout en{emble dans de I'eau ,
&
on en forme une pitte liCfilide comme de la bouil–
lie, enCuite on en endlút les peaux du coté de la chair;
cette opération reíI'erre la peau
&
empeche le poil
cle tomber. Cette fac¡on fe réitere jufqu'a ce que les
peaux 'íüient tout-a-fait devenues fouples
&
rnania–
bIes; apres quoi on les porte chez le Pellener pour
y &tre employées en fourrures.
ApPRET
(Peinture
d');
c'efi ainfi cIufon appeIle
la peinture CIlli le fait [¡lT le verre avec des couleurs
particulieres. On fe [ertdu verre blanc. Les couleurs
appligl1ées [¡Ir ce verre , fe fondent
&
s'incorporent.
















