
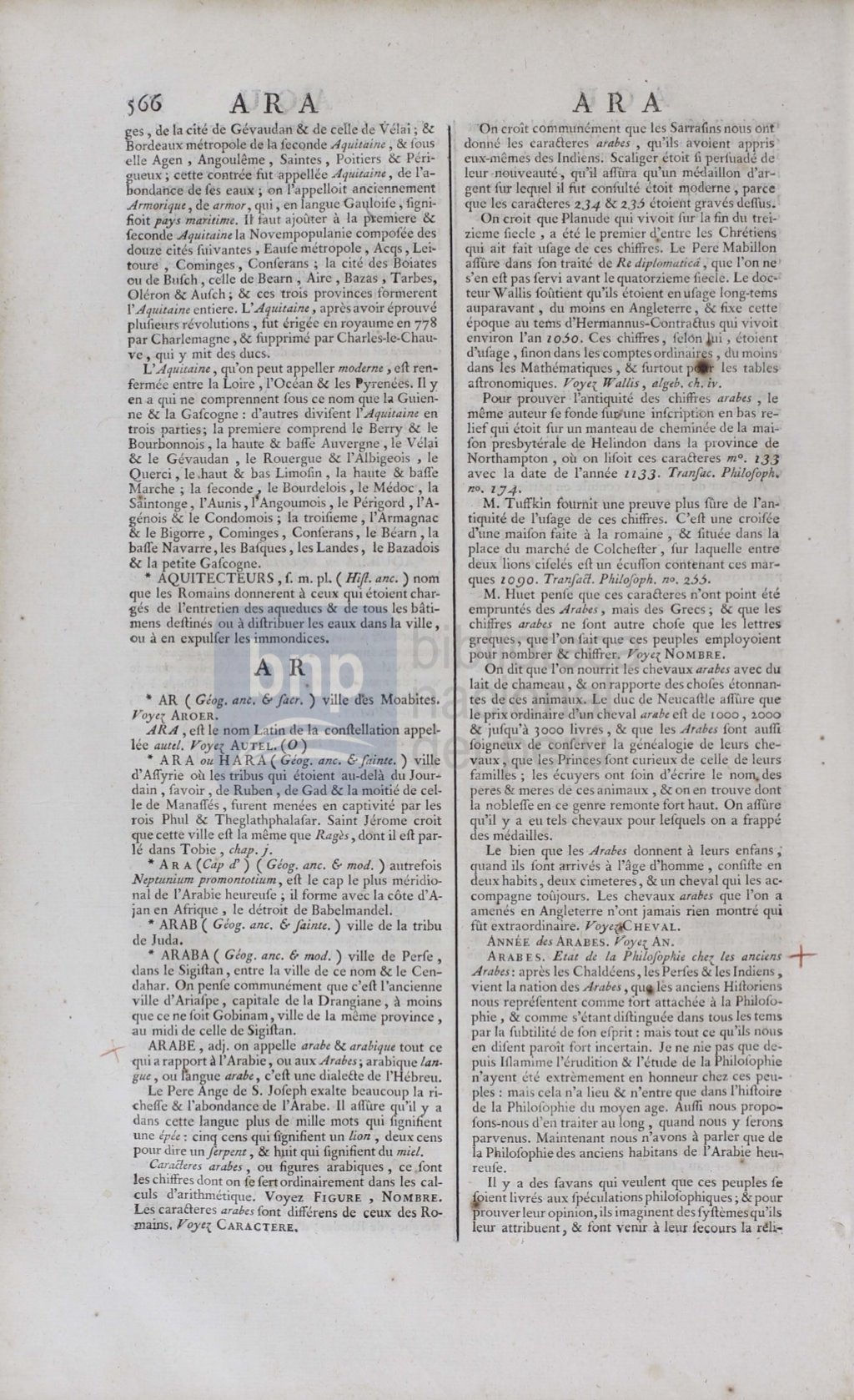
ARA
ges, de la cité de Gévaudan
&
<le cene de
V
élai ;
&
Bordeaux métropole de
la
[econde
A'luitaine
,
&
[ous
elle Agen , Angouleme, Saintes, Poitiers
&
Péri–
oueux; cette contrée fut .appellée
Aquitaim,
de l'a–
~ndance
de fes eaux ; on I'appelloit anciennement
Armori'lue
l
de
armor,
qui, en langue Gat loife., figni–
fioit
pays maritime.
n
faur ajouter it la p emtere
&
feeonde
Aquitaim
la Novempopulanie compofée des
douze cités faivantes , Eaufe métropole , Acqs, Lei–
toure , Cominges, Conferans ;. la cité des Boiares
ou de Bufch, eelle de Bearn , AIre, Bazas, Tarbes,
Oléron
&
Aufch;
&
ces trois provinces femlerent
l'
Aquitaine
entiere.
L'Aquitaine,
apres avoir éprouvé
plufieurs révolutions , fut érigée en royaume en 778
par Charlemagne
,&
fllpprimé par Charles-le-Chau–
ve, qui y mit des ducs.
L'Aquitaim,
qu'on peut a?peller
moderne,
eft ren–
fermée entre la Loire , l'Ocean
&
les Pyrenées,
Il
y
en a qni ne comprennent fous ce nom que la Guíen–
ne
&
la Gafcogne : d'autres divifent
l'Aquilaine
en
trois parties; la premiere comprend le Berry
&
le
Bourbonnois, la haute
&
baífe Auvergne, le Vélai
&
le Gévaudan , le Rouerguc
&
l'
Alhigeois , le
Querci , le .haut
&
has Limoftn, la haute
&
haífe
Marche; la feconde( le Bourde!ois , le Médoc , la
Saintonge, l'Aunis, 1Angoumois , le Périgord , l'A–
génois
&
le Condomois; la troifieme, l'Armagnac
&
le Bigorre, Cominges, Conferans, le Béarn , la
baífe Navarre, les Bafques , les Landes, le Bazadois
&
la petite Gafcogne.
*
AQUITECTEURS, f. m. pL
(Hifl.
anc.
)
nom
que les Romains donnerent
a
ceux qui étoient char–
gés de l'entretien des aqueducs
&
de tous les
h~ti
mens deíl:inés on it diíl:rihuer les eaux dansla ville,
ou
a
en expulfer les in1l11Ondices.
A R
*
AR (
Ciog. anc.
&
Jacr.
)
ville des Moabites.
roye{
AROER.
ARA,
eft le nom Latin de la coníl:ellation appe!–
lée
aUlet. roye{
AUTEL.
(O)
*
A R A
ou
HA R A (
Ciog. anc.
&
Jaime.
)
vüle
d'Aífyrie oit les tribus qui étoient au-delit du Jour'"
dain , favoir , de Ruben , de Gad
&
la moitié de ce!–
le de Manaífés, nlrent menées en captivité par les
rois Phul
&
Theglathphalafar. Saint Jérome croit
que cette ville eft la meme que
Rages,
dont il eft par–
lé dans Tobie,
chap.}.
*
A R
A
(Cap
ti')
(
Ciog. anc.
&
modo
)
autrefois
Neptunium promontotium,
eft le cap le plus méridio–
nal de l'Arabie heureufe; il forme avec la cote d'A–
jan en Afrique, le détroit de Babelmandel.
*
ARAB (
Céog. anc.
&
Jaime.
)
ville de la tribu
de Juda.
*
ARABA (
Ciog. anc.
6-
modo
)
ville de Perfe ,
dans le Sigiíl:an , entre la ville de ce nom
&
le Cen–
dahar. On penfe communément que c'eft l'ancienne
ville d'Ariafpe, capitale de la Drangiane,
a
moins
que ce ne foit Gobinam, ville de la meme province ,
<lU
midi de celle de Sigiftan.
~
ARABE, adj. on appelle
arabe
&
arabique
tout ce
-qui a
rap~ort
al'Arabie, ou
auxArabes;
arabique
fan,
gue,
ou langue
arabe,
c'eft une dialeUe de l'Hébreu.
Le Pere Ange de S. Jofeph exalte beaucoup la ri–
chelfe
&
l'abondance de l'Arabe.
Il
a(fure qu'il y a
dans cette hmgue plus de mille mots qui fignifient
une
ipie:
cinc¡ cens qui fígnifient un
lion
,
deux cens
pOllr dire un
fl'7'ent
,
&
11Jlit qui fignifient du
miel.
Ca~aL1eres
arabes,
ou figures arabiques, ce [ont
les c1uffresdont on fe
[ert
ordinairement dans les cal–
culs d'arithmétique. Voyez FIGURE, NOMBRE.
Les caraéleres
arabes
font différens de ceux des Ro–
mains.
Yoye{
CARACTERE.
ARA
'On croit communément que les SarraÍlns nous ont
donné les caraUeres
arabes
,
qu'ils avoient appris
eux-memes des Indiens. Scalíger étoit
fi
perfuadé de
lcur 110uveauté,
~u'il
aKura qll'un médaillon d'ar–
gent fUf leque! il nlt confuIté étoit moderne , parce
que les caraUeres
234
&
236
étoient gravés dell'us_
On croit que Planude 'luí vivoit (ltr la
fin
du rrei–
zieme fieele , a été le premier d:entre les Chrériens
Cjlli ait fail ufage de ces chiffres. Le Pere Mabillon
alflu'e dans fon traité de
Re diplomatica,
que I'on ne
s'en eíl: pas fervi avant lecluatorzieme fiecle. Le doc–
teur \VaIlis [o('¡tient qu'ils étoient en ufage long-tems
auparavant, da moins en Angleterre,
&
me cette
époque au tel'ns d'Hermannus-Oontraéllls qui vivoit
environ l'an
zo'sO.
Ces chiffres, felón lui , étoienr
d'u{age , finon dans les comptes ordinaires , dtI moins
dans les Mathématiques ,
&
furtotlt pIes tables
aftronorruques.
Yoye{ Wallis, algtb. ch. iy.
Pour prouver I'antiquité des chiffres
arabes
,
le
meme auteur fe fonde fur;une infcription en bas re–
lief qui étoit fm un manteau de cheminée de la mai–
fon presbytérale de Helindon dans la province de
Northampton , Oll on lifoit ces caraUeres
mO.
l33
avec la date de l'année
ll33.
TranJac. PluloJoph.
no,
l:74.
M. Tuffkin toUrnit une preuve plus fltre de I'an–
tiquité de l'ufage de ces chiffres. C'eft une croifée
d'tme mai(on faite it la romaine ,
&
fituée dans la
place du marché de Colchefter, fur laqueIlc entre
deux lions cifelés eíl: un écufron contenant ces mar–
ques
l090.
TranJaa, PhiloJoph. no.
2's's.
M. Huet penfc que ces caraUeres n'ont point été
empnmtés des
Arabes,
mais des Grecs;
&
que les
chiffres
arabes
ne font autre chofe que les lettres
greques, que 1'on fait que ces peuples employoient
pour nombrer
&
chiffrer.
roye{NOMBRE.
On dit que I'on nourrit les chevaux
arabes
avec du
lait de chameau,
&
on rapporte des choCes étonnan–
tes de ces animaux. Le duc de Neucafrle affi'tre que
le prix ordinaire d'un chevalarllbe eíl: de 1000, 2.000
&
jtúqu'a 3000 livres,
&
que les
.drabes
font auffi
foigneux de conferver la généalogie de lettrs che–
vaux, que les Princes font curieux de celle de leurs
familles; les écuyers ont foin d'écrire le 110m. des
peres
&
meres de ces animaux ,
&
on en rrouve dont
la nobleífe en ce genre remonte foft haut. On aífúre
Cju'il y a eu tels chevaux pour lefquels on a frappé
des médailles.
Le bien que les
Arabes
donnent a leurs enfans ;
quand ils font arrivés it l'age d'bomme , confiíl:e en
d~ux
habits, deux cimeteres,
&
un cheval qui les ac·
compagne tOlljOurS. Les chevaux
arabes
que l'on a
amenés en Angleterre n'ont jamais rien montré qui
IDt extraordinaire. roye{lCHEvAL.
ANNÉE
des
ARABES.
Yoye{
AN.
ARAB ES.
Etat de la PhiloJop/¡ie chez les ancims
+
Arabes:
apres les Chaldéens, les Penes
&
les Indiens.
vient la nation des
Arabes
,c¡u les anciens Hiíl:oriens
nous repréfcntent comme fort attachée
a
la Philofo–
phie,
&
comme s'étantdiilinguée dans tous les tems
par la fubtilité de fon efprit : mais tout ce qu'ils nOlls
en difent parolt fort incertain. Je ne nie pas que de-
puis Iílamime l'érudition
&
I'étude ele la Philofophie
n'ayent été extremement en honneur chez ces peu-
pIes: mais cela n'a lieu
&
n'entre que dans l'hiftoire
de la Philofophie du moyen age. Auffi nous propo–
(ons-nous d'en traiter au long, Cj1\3nd nous y ferons
parvenus. Maintenant nous n'avons a parler Cj1le de
la Philofophie des anciens habitans de l'Arahie heu..,
reufe.
Il
y a des favans qui veulent Cj11e ces peuples [e
foient livrés aux fpéculations philofophiques;
&
pour
prouver leur opinion, ils
ima~inent
des fyíl:emes qu'ils
leur attribuent,
&
font vel11r
el
leuT fecours la
réli~
¡
















