
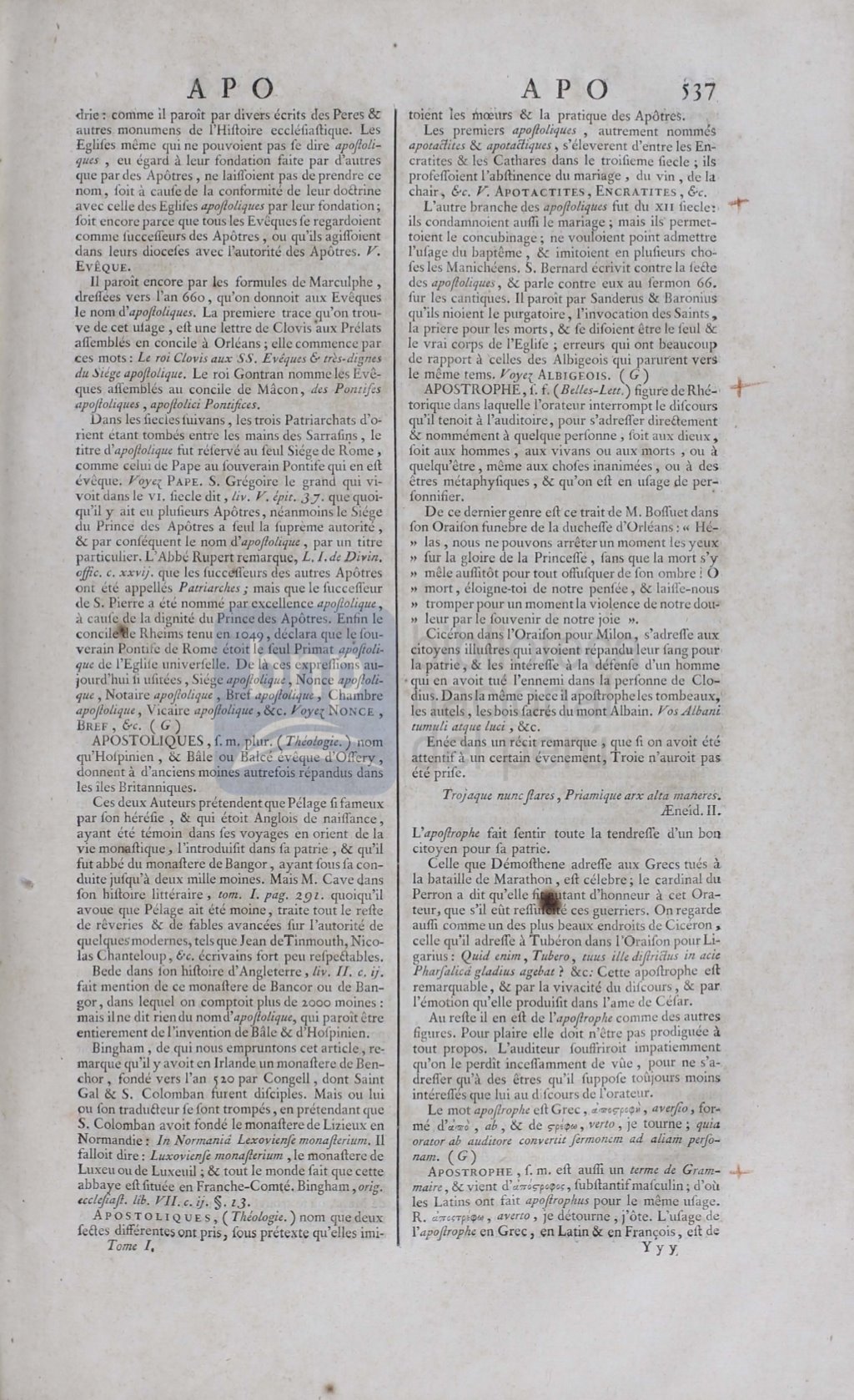
APO
<lrie: comme iI parolt par divers écrits des Peres
&
aurres monumens de l'Hifioire eccléíiafiique. Les
Egli{es meme qui ne pouvoient pas {e dire
apoJloli–
'lues
,
eu égard
a
leur fondation faite par d'autres
que par des Aporres, ne laiffoient pas de prendre ce
nom, {oit
11
caure de la conformité de leur dofuine
avec celle des Egli{es
apojloliques
par leur fondation;
foit encore parce que tollS les Eveques
re
regardoient
comme {llcceffeurs des Apotres , ou qu'ils agiffoient
<lans leurs dioce(es avec I'.¡¡utorité des Aporres.
V .
EvftQUE.
11
parolt encore par les formules de Marculphe ,
clreffees vers l'an 660, qu'on donnoit
atLX
Eveques
le nom
d'apojloli'lues.
La premiere trace qu'on trou–
ve de cet uiage , efr une lettre de Clovis 'aux Prélats
affemblés en concile
a
Orléans; elle commence par
ces mots:
Le roi CLoyis aux SS. EyéqItes
&
tr~s-dignts
du Siége apojlolique.
Le roi Gontran nomme les Eve–
qlles aífemblés au concile de Macon,
des Pontifes
apojloliques, apoJlolici Pontifiees.
Dans les íiecles iuivans , les trois Patriarchats d'o–
rient étant tombés entre les mains des Sarraíiqs , le
titre d'
apojloLique
fut réfervé au {eul Siége de Rome ,
comme celui de Pape au fouverain Pontife qui en efr
éveque.
Voye{
PAPE. S. Grégoire le granel qui vi–
voit dans le
VI.
íieele dit,
liv.
V.
épit.
J:J.
que quoi–
qu'il y ait eu plllfieurs Apotres, néanmoins le
Sié~e
dn Prince des Apotres a {enlla (lIpreme autorite,
& par conféquent le nom
d'apojloLi'lue,
par un tio'e
particulier. L'Abbé Rupert remarque,
L.
J.
de D i'l'in.
oiJic.
c.
xxyij.
que les (ucceífeurs des auo'es Apotres
ont été appellés
Patriarcltes;
mais que le fucceífeur
de S. Pierre a été nommé par excellence
apojloli'lue,
a
cauCe de la dignité du Prince des Apotres. Enfin le
concile e Rheims tenu en
1049,
déelara que le (ou–
verain POBufe de Rome étoit le (eul Primat
apoftoli–
que
de l'Egliie univer{elle. De
la
ces expreffions au–
jourd'hui
íi
uíitées , Siége
apojloli'lue
,
Nonce
apojloli–
'lue
,
Notaire
apojlolique
,
Bref
apojloli'lue,
Chambre
apojloli'lue,
Vicaire
apojloli'lue)
&c.
Yoye{
NONCE ,
BREF ,
&c.
(G)
APOSTOLIQUES,
f.
m. plur. \
ThéoLogie.)
110m
<Iu'Holpinien,
&
Bale ou Balcé eveque d'Oífery,
donnent
a
d'anciens moines autrefois répandus dans
les iles Britanniques.
Ces deux Auteurs prétendentque Pélage íi fameux
par ron héréíie ,
&
qui étoit Anglois de naiífance,
ayant été témoin dans (es voyages en orient de la
vie monafrique) 1 'introduiíit dans {a patrie,
&
qu'il
fut abbé du monafrere de Bangor, ayant {ous (a can–
duite ju(qu'a deux mille moines. Mais M. Cave dans
fon hifroire littéraire,
tomo
l.
pago
29l.
quoiqu'il
avoue que Pélage ait été moine, traite tout le refre
de reveries & de fables avancées {ur I'autorité de
<Iuclquesmodernes, tels que Jean deTinmouth, Nico–
las Chanteloup,
&c.
écrivains fort peu re(peébbles.
Bede dans ton hifroire d'Angleterre,
Liy.
1I.
c.
ij.
fait mention de ce monafrere de Bancor ou de Ban–
gor, dans lequel on comptoit plus de
2.000
moines :
mais ilne dit riendu
nomd'apojlolique,
qui paroit etre
entierement de 1'invention de Bale
&
d'Ho(pinien.
Bingham , de qui nous empruntons cet article , re–
marque qu'il y avoit en Irlande un monafrere de Ben–
ehor, fondé vers l'an
52.0
par Congell , dont Saint
Gal
&
S. Colomban furent difciples. Mais ou luí
ou fon traduéleur {e font trompés , en prétendant que
S. Colomban avoit fondé le monafrere de Lizieux en
Normandie :
In Nonnaniá Lexoyienfi monajlerium.
Il
falloit dire:
LtlXoyienfi monajlerillrn
,le monafrere de
Luxeu ou de Luxeuil ;
&
tout le monde (ait que cette
abbaye efi íituée en Franche-Comté. Bingham,
orig.
~ccLe¡,ajl.
ltb.
VII.
c.
ij.
§.
zJ.
A Po.STo
L 1
Qu ES, (
Théologie.
)
nom que deux
feéles d1.fférentes
Ont
pris, fous prétexte 'lu'elles imi–
Tome
l,
APO
537
toient les t\Joollrs
&
la pratique des Apotres.
Les premiers
apojloLiques
,
autrement nommés
apotaHites
&
apotaaiques
j
s'éleverent d'entre les En–
cratites
&
les Cathares dans le troiíieme íieele ; ils
profeffoient l'abfiinence du mariage, du vin, de la
chair.,
&c.
V.
ApOTACTITES, ENCRATITES,
&c.
L'autre branche des
apojloli'lltes
fut dil
XII
fiecle~
ils condamnoient auffi le mariage ; mais ils' permet–
toient le concubinage; ne vouloient point admettre
l'ufage dll bapt&me,
&
imitoient en pluíieurs cho–
{es les Manichéens.
S.
Bernarcl écrivit contre la {eéle
des
apofloLi'llles ,
&
parle contre eux au (ermon 66_
{ur les canti'lues.
11
paroit par Sanderus
&
Baronius
qu'ils nioient le purgatoire, l'invocation des Saints,
la priere pOLlr les morts,
&
{e di(oient etre le (eul
&
le vrai corps de l'Egli{e ; erreurs qui ont beallcou]>
de rapport
a
celles des Albigeois qui parurent verS
le meme tems.
Voye{
ALBIGEOIS.
(G)
APOSTROPHE,
f.
f.
(BeLies-Lett.)
figure de Rhé–
torique dans laquelle I'orateur interrompt le di(cours
qu'il tenoit
a
l'auditoire, poU\" s'adreíTer direélement
&
nommément
a
quelque per{onne
>
foit aux dieux.
foit aux hommes , aux vivans Oll aux morts , Ol!
a
quelqu'etre, meme aux cho(es inanimées, ou
a
des
etres métaphyíiques, & qu'on efr en u(age de per–
{onnifier.
.
De ce dernier genre efr ce traitue M. Boífuet clans
ron Orai(on funebre de la ducheífe d'Orléans : "
Hé–
" las, nous ne pouvons auererun moment les yeux
" (ur la gloire de la Princeífe, (an que la mort s'y
" m&le aulUtot pour tout offit{'luer de ron ombre
¡
O
" mort, éloigne-toi de notre pen(ée,
&
laiífe-nous
>1
tromper pour un moment la violence de notre dou–
" leur par le (ouvenir de notre joie
>l.
Cicéron dalls 1'0raifon pour M.ilon, s'adreífe aux
citoyens illufrres 'lui avoient répandu leur {ang pour,
la patrie,
&
les intéreífe
a
la défenfe d'un homme
qui en avoit tué l'ennemi dans la per(onne de Clo–
dius. Dans la m&me piece il apofuophe les tombeaux,
les autels , les bois {acrés du mont Albain.
Vos Albani
tllmllli atque lucí,
&c.
Enée dans un récit remarque, que íi on avoit été
attentifa un certain évenement, Troie n'auroit pas
été prife.
Troja'lue nUllejlares, Priami'lue arx alta nzaneres_
ftneícl.
Ir.
L'apojlrophe
fait fentir toute la tendreífe d'un bOIl
citoyen pour {a patrie.
Celle que Démofihene adreífe aux Grecs tués
11.
la bataille de Marathon , efr célebre; le cardinal dlL
Perron a dit qu'elle
fi
ttant d'honneur
a
cet Ora–
teur, que s'il eltt refil\ é ces guerriers. On re
9
arde
auffi comme un des plus beaux endl"Oits de Ciceron
~
celle c¡u'il adreífe
a
Tubéron dans 1'Orai(on pourLi–
garius:
Quid enirn , Tubero,
tuus
iLie dijiriHus in aeie
Pharfalieá gladitlS agebat?
&c:
Cette apofrrophe efr
remarquable , & par la vivacité du di{cours ,
&
par
l'émotion qu'elle produiíit dans l'ame de Cé{ar.
Au refre il en efr de
l'apojlrophe
comme des autres
figures. Pour plaire elle doit n'etre pas pro.diguée
a
tout propos. L'auditeur fouffriroit impatlemment
qu'on le perdit inceífamment de vl!e, I?our ne s.'a–
dreffer
~u'a
des etres qu'il (uppo{e tOÚ¡ours moms
intéreíTes que lui au d,(cours de l'orateur.
Le mot
apojlrophe
efi Grec
" d""o,pof$':
,
ayerjio,
for–
mé
d'd",,~
,
ab,
&
de
, pi",,,, ,
yerto,
je tou;ne;
quia
orator ab auditore convertit firmomm ad aüam perjO–
nom.
(G)
ApOSTROPHE , {. m. efr auffi un
terme de Gram–
maire,
&
vient
d'd'lTJ,po",o~,
(ubfiantifma(culin; d'oll
les Latins ont fait
ap~flroplUls
pour le me¡ne ufage.
R.
d'lT.~Tp;","' ,
ayerlO,
je détourne ,j'ote. L'u{age de
l'apojlrophe
en Grec, en Latin
&
en Fran<;ois, efr de
Yyy'
















