
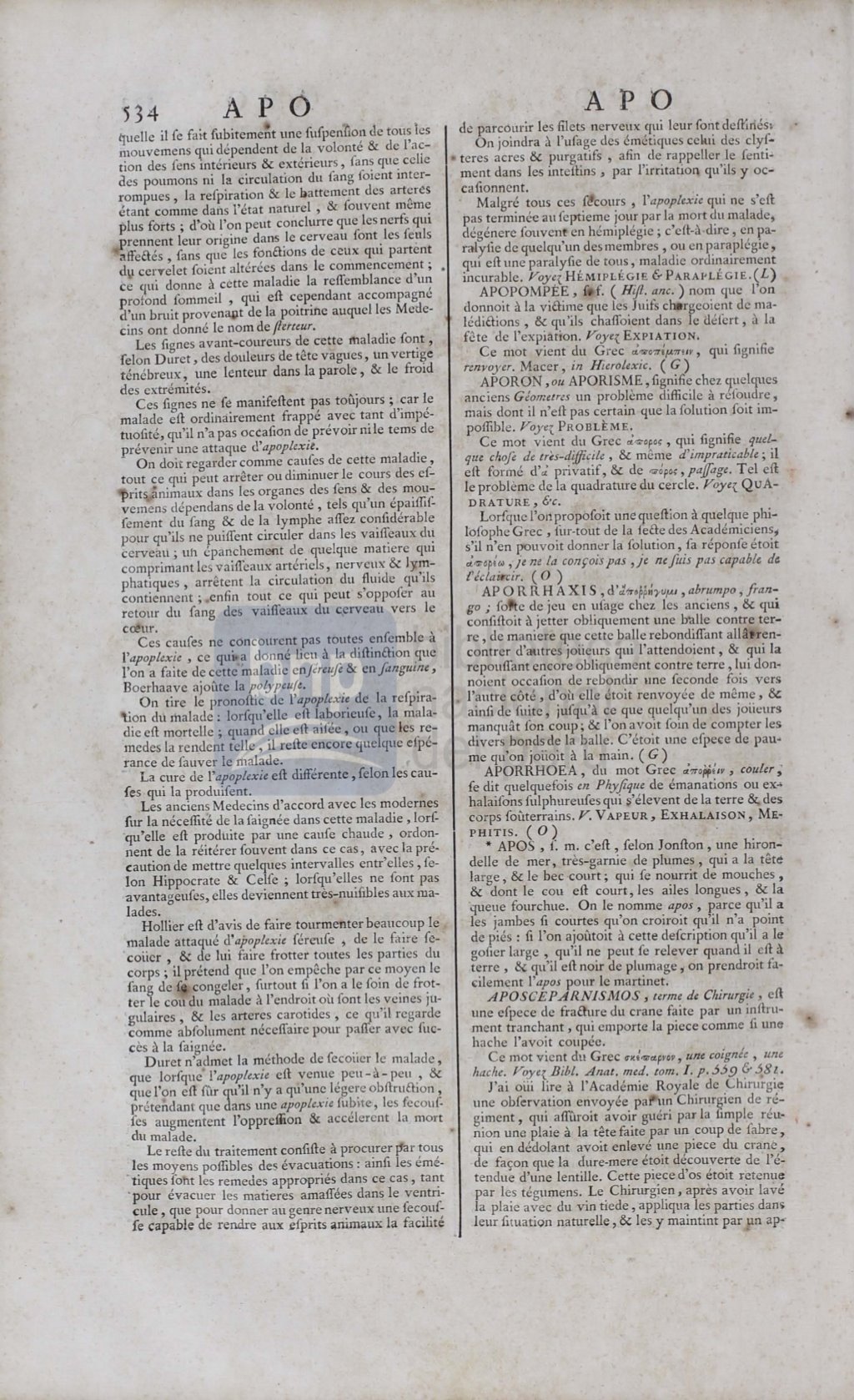
534
APÓ
quelle
il
fe fatt fubitement une fufpenuon de tous les
mouvemens qlÚ dépendent de la volonté
&
de
I'a~tion des fens imérieurs
&
extérieurs , fans que celte
aes poumons ni la circulacion du fang foient inter–
rompues, la refpiration
&
le battement des arteres
étant comme dans l'état nature1 ,
&
fouvent meme
plus fOits ;
d~ou
I'on peut conclurre que les nerfs qui
prennent leur origine dans .Ie cerveau font .Ies feuls
affeétés , fans que les fonétlOns de ceux qll1 partent
du cervelet foient altérées dans le commencement; •
c~
qui donne a cette maladie la reífemblance d'un
profond fommeil , qui efi c.ep.endant accompagné
d'un bmit provena¡¡t de la pOItrIDe auque1les Metle–
cins ont donné le nom de
fletteur.
Les fignes avant-coureurs clAe
cette
maladie
fo~t,
felon Duret> des dÓllleurs de tete vagues, un vertlge
ténébreux, une lenteur dans la parole,
&
le froid
des extrémités.
Ces fignes ne fé manifefient pas toujours ; car le
malade efi ordinairement frappé avec tant d'impé–
tuofité, qu'il n'a pas occafion de prévoir ni le tems de
prévenir une attaque
cl'apoplexit.
.
On doit regarder comme caufes de cette maladle ,
tout ce e¡tú peut arreter ou diminuer le COlU"S des ef–
prits imimaux dans les organes des fens
&
des mou–
vemens dépendans de la volonté , tels qu'un épaiffif–
(ement dll fang
&
de la lymphe aífez confidérable
pOllr qu'ils ne puiífent circuler dans les vaiífeaux du
cerveau; un épanchement de quelque matiere qlÚ
comprimantles1)"aiífeaux artériels, nerveux
&
lym–
phatiques, arretent la circulation du fluide qu'ils
contiennent; enfin tout ce qui peut s'oppofer au
retour du fang des vaiffeaux du c.erveau vers le
creur.
Ces caufes ne concourent pas toutes enfemble
a
l'apoplexie
> ce qui. a donné lieu a la difiinfrion que
1'on a faite de cette Ínaladie
enflreufe
&
en
fanguine
>
Boerhaave ajollte la
polypeufe.
On tire le pronofric de
I'apoplexie
de la refpira-
110n dü malade: lorfqu'elle
ell:
laborieufe, la mala–
die efi mortelle ; quand elle efi aifée , ou que les re–
medes la rendent telle , il refie encore quelque efpé–
rance de fauver le malade.
La cure de l'
apoplexie
efi différente , felon les cau–
fes qui la produifent.
Les anciens Medecins d'accord avec les modernes
fur la néceffite de la faignée dans cette maladie , lorf–
qu'elle efi produite par une calúe chaude> ordon–
nent de la réitérer fouvent dans ce cas, avec la pré–
caution de mettre quelques intervalles entr'elles , fe–
lon Hippocrate
&
Celfe ; lor[qu'elles ne font pas
avantageufes, elles deviennent tres-nuiftbles aux ma–
Jades.
Hollier eO: d'avis de faire tourmenter beaucoup le
malade attaqué
d'apoplexie
féreufe ; de le faire fe–
coiier ,
&
de lui faire frotter toutes les parties du
corps ; il prétend que I'on empeche par ce moyen le
fang de f@ congeler, fnrtout fi l'on a le foin de frot–
ter le cou du malade a l'endroit Oil font les veines ju–
gulaires,
&
les arteres carotides , ce qu'il regarde
comme abfolument néceífaire pour paífer avec fuc–
ces a la faignée.
Duret n'admet la méthode de fecoiicr le malade,
que lorfque l'
apoplexie
eO: venue peu -
a-
peu ,
&
que I'on efi ffLT qu'il n'ya qu'une légere obO:ruétion ,
prétendant que dans une
apoplexie
fubite , les fecouf–
fes augmentent I'oppreffion
&
accélerent la mort
du malade.
Le TeO:e du traitement conftfre a procurer ¡far tous
les moyens poffibles des évacuations: ainfi les émé–
tiques font les remeues appropriés dans ce cas, tam
.pour évacuer les matieres amaífées dans le ven
tri–
cule, que pour donner au genTe nerveux une fecouf-
fe capable de rendre aux eíprits animaux la facilité
APO
de parcóurir les filets nerveu" qui leur ront
defrínés~
On joindra
a
l'uf.'ge des émétielues cdui des clyf–
teres acres
&
purgatifs , afin de rappeller le fenti–
ment dans les inteilins > par I'irritation qu'ils y oc–
cafionnent.
Malgré tous ces ft!cours ,
l'apoplexie
qui ne s'efr
pas terminée au feptieme jour par la mort dumalade,
dégénere fouvent en hémiplégie; c'eft-a·dire, en pa–
ralpie de quelqu'un des membres , ou en paraplégie,
qui eO: une paralyfie de tous, maladie ordinairement
incurable.
Voy~{HÉMIPLÉGIE
&
PARAi'LÉGIE.(L)
APOPOMPEE>
íi
f.
(Hifl. anc.
)
nom que 1'0n
donnoit a la viétirne que les Juifs dutrgeoient de ma–
lédiétions,
&
qu'ils chaifoient dans le défert,
a
la
fete de l'expiation.
Voye{
EXPIATION.
Ce mot vient du Grec
d""07T~P.7T"V,
qui íignilie
renYoyer.
Macer,
in Hieroüxic. (G)
APORON
,ou
APORISME, fignifie chez <J;lelqucs
anciens
Géometres
un probleme difficile
a
refoudre ,
rnais dont il n'eO: pas certain que la folution foit im–
poffible.
Voye{
PROnLEME.
Ce mot vient du Grec
d""opot;
,
qui fignifie
quel–
que chelje de trts-difficile,
&
meme
d'impraticabte;
il
eO: formé d'd privatif,
&
de
""'~pot;,paJ[age.
Tel e{l¡
le probleme de la quadrantre du cercle.
Voy<{
QuA–
D
RATURE >
&oc.
Lorfquel'011propo{oit unequeO:ion a ql1elque phi–
lofophe Grec >lllr-tout de la feéte des Académiciens1
s'il n'en pouvoit donner la folution, fa réponfe étoit
d"".p;'"
,
je ne la con;ois pas ,je nejilis pas ,apable de
l'éclainir.
(O )
AP O R R H A
X
1S , d
'a'?r'pp~'>'IJp.,
,
abmmpo, fran–
go
;
fo e de jeu en ufage chez les anciens,
&
qui
confifioit
a
jetter obliquement une baile contre ter–
re, de maniere que cette baile rebondiífant allbren–
contrer d'autres joüeurs qui l'attendoient,
&
qui la
repouífam encore obliquement contre terre , lui don–
noient occafion de rebondir une feconde fois vers
l'autre coté, d'orl elle étoit renvoyée de meme>
&
ainfi de fuite, jufqu'a ce que quelqu'un des joiieurs
manquat fon coup;
&
I'on avoit foin de compter les
divers bonds de la baIle. C'étoit une efpeee de pau"
mc qu'on joiioit a la main. (
G)
APORRHOEA, du mot Grec
d7TO¡';;'V
,
couter;
fe dit quelquefois
en PhyJique
de émanations ou ex"
halaifons fulphureufes qui s'élevent de la terre
&
des
corps fouterrains.
V.
VAPEUR >EXHALAISON, ME–
PHITIS.
(O)
,. APOS ,
e
m. c'eO: , felon JonO:on , une hiron–
delle de mer, tres-garnie de plumes , qui a la teté
large,
&
le bec comt; qui fe nourrit de mouehes,
&
dont le cou efi court, les ailes longues,
&
la
queue fourchue. On le nomme
apos,
paree qu'il a
les jambes fi eourtes qu'on croiroit C¡tl'il n'a point
de piés : fi I'on ajoutoit a cette defcription C¡tl'il a le
gofier large , qu'il ne peut fe relever C¡tland il eO:
a
terre,
&
qu'il eO: noir de plumage , on prendroit fa–
cilement l'
apos
pour le martinet.
APOSCEPARNlSMOS, mme de Clúrurgie,
eft
une efpeee de fraéture du erane faite par un iníl:ru.
ment tranchant, C¡tli emporte la piece corome ú une
hache I'avoit coupée.
Ce mot vient du Grec
,nd""tt.pvop, une coignle, une
hache. Voye{ Bibl. Anat. medo tomo
J.
p . .J.J9
&
3,8z.
J'ai oüi lire a I'Aeadémie Royale de Chirurgie
une obfervation envoyée pafun Chimrgien de ré–
giment, qui aífllroit avoir gl.léri par la úmple réu–
nion une plaie a la tete faite par un coup de fabre,
qui en dédolant avoit enleve une piece du crané ,
de fac;on C¡tle la aure-mere étoit déeouverte de l'é–
tendue d'une lentille. Cette pieee d'os étoit retenue
par les tégl.1mens. Le ChinLTgíen, apres avoir lavé
la plaie avec du vin tiede, appliqua les partíes
dan~
leur fituation nanlreIle,
&
les y maintint par un ap-
















