
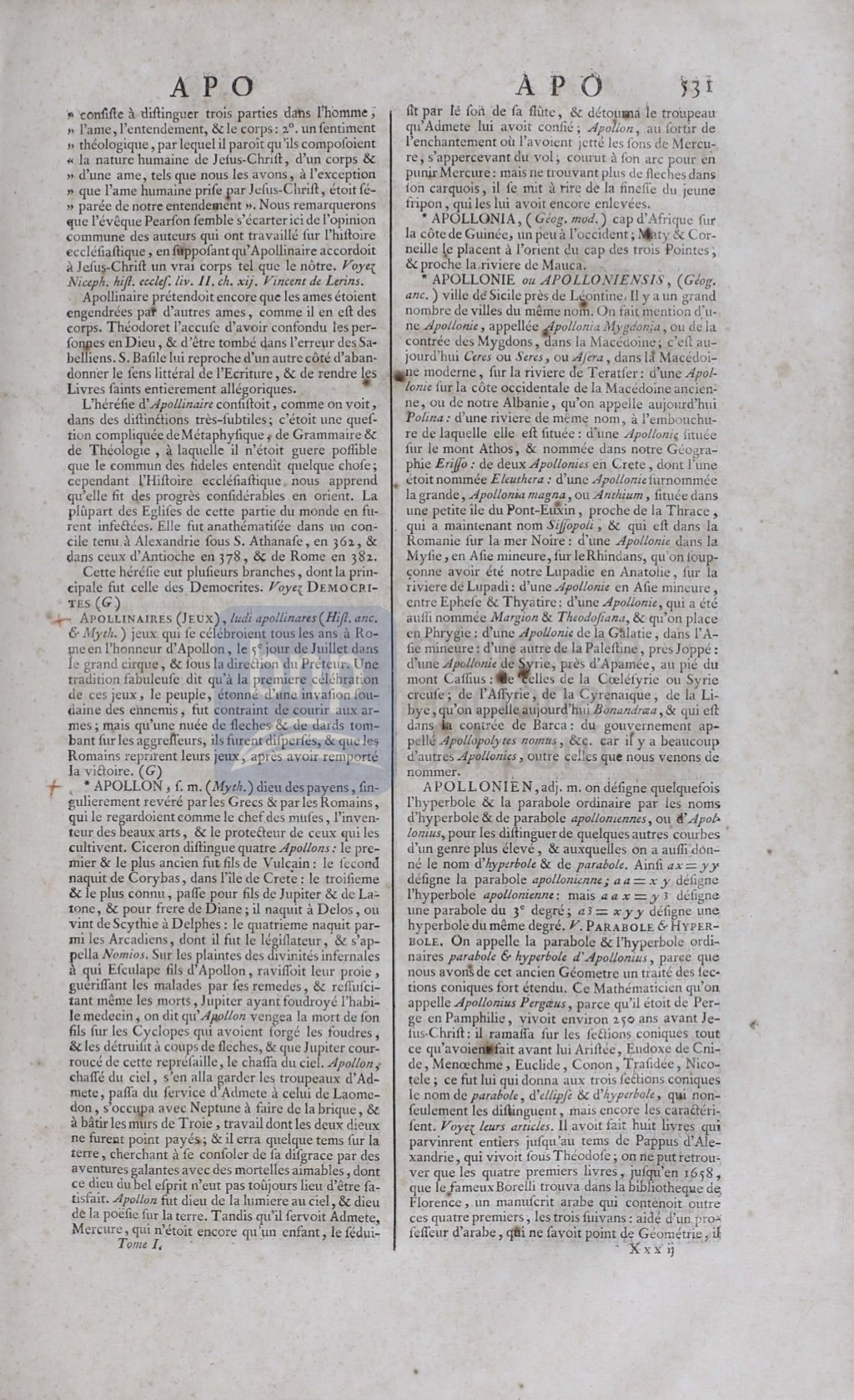
APO
'JI
'Confúle
a
uiilinguer trois parties tlans
llJ1omme;
" l'ame, l'entendement, & le eorps:
2°.
un fentiment
JI
théologiqlle, par lequel il parolt qu 'ils eompofoient
f<
la nahLre humaine de Jefus-Chril!:, d'un eorps &
" d'une ame, tels que nous les avons,
a
l'exeeption
»
que I'ame humaine prife par
Jefi.ls-Clu'i1l:, étoit fé–
" parée de notre entendement
>l.
NOl1s remarquerons
lJue l'éveql1e Pearfon femble s'éearterici de I'opinion
commune des auteurs qui ont travaillé fur I'hil!:oire
€ccléfiaíl:ique, enfi.lppofant qu'Apollinaire accordoit
¡\
Jefus-Chri1l: un vrai corps tel que le notre.
Voyez
Niuph. hij!. ecele¡: /iy.1l. ch. xi}. Vincent de Lenns.
Apollinaire prétendoit encore que les ames étoient
cngendrées par d'autres ames, comme il en el!: des
corps. Théodoret l'accufe d'avoir confondu les per–
fonpes en Dieu,
&
d'etre tombé dans I'erre\lr des Sa–
belliens. S. Ba{¡}e lui reproche d'un autre coté d'aban–
donn'er le fens littéral de l'Ecriture, & de rendre les
Livres faints entierement allégoriques.
L'héréfie d'
Apollinaire
confil!:oit, comme on voit,
dans des dil!:inéhons tres-fubtiles; c'étoit une quef–
tion compliquée deMétaphyfique, de Grammaire &
de Théologie , a laquelle il n'étoit 8llere poffible
que le eommun des fideles entendit quelque chofe;
cependant l'Hil!:oire eccléfiaíl:ique nous apprend
<plelle lit des progres confidérables en oriento La
pltlpart des Eglifes de cette partie du monde en fu–
rent infeél:ées. Elle fut anathématifée dans un con–
cile tenu
a
Alexandrie fous S. Athanafe, en 362,
&
dans ceux d'Antioehe en 378, & de Rome en 382.
Cetre héréfie eut plufieurs branches, dont la prin–
cipale fut eelle des Demoerites.
Voye{
DEMOCRI–
TES
(G~
... ApOlJLlNAIRES (JEUX),
ludi. apollinares (Hij!. a12c.
&
Myt/¡.
)
jeux qui fe célébroient tOllS les ans
a
Ro–
tne en I'honneur d'Apollon, le
)e
jour de Juillet dans
le grand cirque, & 10us la direél:ion du PrétellT. Une
tradition fabllleufe dit qu'a la premiere célébration
de ces jeux, le pellple, étonné d'une invafion fOll–
daine des ehnemis,
fi.ltcontraint de comir aux ar–
mes; mais qu'une nuée de fleches- & de dards tom–
bant fur les aggrefi"enrs, ils furent difperfés,
&
que
le~
Romains reprirent lems jeux, apnes avoir remporté
la viél:oire.
(G)
f-
*
APOLLON
J
f. m.
(Myth.)
dieu des payens , fin–
I
gulierement revéré par les Grees
&
par les Romains,
gui le regardoient eornme le chefdes mLIfes, l'inven–
tem des beaux arts, & le proteél:eur de ceux qui les
cultivent. Ciceron di1l:ingue quatre
Apollons:
le pre–
mier
&
le plus ancien
fi.ltlils
de Vulcain: le ú:cona
naquit de Corybas, dans I'ile de Crete: le troifieme
& le plus connu, paífe pour fils de Jupiter & de La:..
tone, & pour iTere de Diane ; il naquit
a
Delos , ou
vint de Scythie
a
Delphes: le quatrieme nac¡uit par–
mi les Arcadiens, dont il fut le légiílateur, & s'ap–
pella
Nomios.
Sur les plarntes des divinités infernales
a
qu.i Efculape fils d'Apollon, raviífoit leur proie,
gueniI"ant les malades par fes remedes, & reífllfci–
tant meme les morts, Jupiter ayant fOlldrOyé l'habi–
le medecin ; on dit qu'
Aflollon
vengea la mort de ron
fils fur les Cyclopes qui avoient forgé les fouclres;
&
les détruifit
a
coups de fleches,
&
que Jupiter cour–
roucé de cetre repréfaille, le chaífa du cielo
ApoLlon,'
chaífé du ciel, s'en alla garder les troupeaux d'Ad–
mete, paífa du [enrice d'.¡\dmete
a
cehú de Laome–
don, S'OCCl\pa avec Neptune a faire de la brique, &
a
batir les mms de Troie, travail dont les deux rueux
ne furent point payés;
&
il erra qnelque tems fur la
terre, cherchant
a
fe confoler de {a difgrace par des
ave~tures
galantes avec des mortelÍes aimables, dont
c.e
d~en
du bel efprit n'eut pas toujours líen d'etre {a–
tlsfalt.
Apollon
fi.ltdieu de la lllmiere au ciel & dieu
de la poefie fur la terreo Tandis qu'il fervoit ¡dmete
Mercure, 'lui n'étoit encore qu 'un enfant, le fédui:
TomeI,
ApÓ
ítt
par
té
Con de fa f1ihe, & détouliIla le troupeau
qll'Admete lui avoit confié;
Apollon,
au Cortir de
l'enchantement olll'avoient jctté les fons de Mercu–
re, s'appercevant du vol; courut
a
fon arc paur
en
punir Mercure: mais ne trouvant plus de fleches dans
1001 carquais, il fe mit aorire; de la fineífe du jeune
fioipon, <pli les Illi avoit encore
e~llevées.
.. APOLLONIA,
(Géog. mod.)
cap d'Afric¡ue [ur
la cote de Guinée, un peu
a
I'occident;
ty
&
Cor–
neille J.e placent
a
l'orient du cap des trois Pointes,
& proche la,riviere de Mauca.
.. APOLLONIE
011
APOLLONIENSIS
,
(Géog,
anc.
)
ville dé Sicile pres de L 'ontine. Il y a un grand
nombre de villes du meme nomo
011
fait mentian d'u–
ne
ApoLlollie,
appellée
/lpollollia Mygdonia,
ou de la
contree des Mygdons, "(¡¡lOS la Macédoine;
c'ea
au–
jourd'hui
Ceres
ou
Ser~s,
ouAjera,
dans la Macédoi–
ne moderne, fur la riviere de Teratfer: d'une
Apo/–
lonie
fur la cote occidentale de la Macédoine ancjen;
ne, ou de nou'e Alb¡¡.nie, qu'on appelle aujonrd'hlli
Po/ina:
d'une riviere de meme nom,
a
I'embonchu–
re de la<plelle elle el!: útuée: d'llne
Apolloni~
ftmée
Cm le mont Athos,
&
nommée dans notre Géogra–
phie
Erij[o
:
de deux
Apollonies
en C:rete, dont I'llne
étoit nommée
E leutlzera
:
d'une
Apollonie
{urnommée
la grande,
Apollonia magna,
ou
Amhium,
fituée dans
une petite ile du Pont-Euxin, proche de la Thrace ,
qui a maintenant nom
Sij[opoli;
& qlli el!: dans la
Romanie fur la mer Norre: d'une
ApolLonie
dans la
Myfie, en Afie mineure, {ur leRhindans, qu'onloup–
~onne
avóir été notre Lupadie en Anatolie, {m la
riviere de Lupadi: d'une
Apollonie
en Afie mineure,
entre Ephe{e & Thyatire: d'une
Apollonie,
qui a été
auffi nommée
Margion
&
Theodojiana,
& qu'on place
en Phrygie : d'une
ApoLLonie
de la
G~latie,
dans l'A–
fie minellre: d'une autre de la Palel!:ine , pres Joppé ;
d'uneApollonie
de S rie, ¡noes d'Apamée, au pié du
mont Caffius: e elles de la Creléfyrie ou Syrie
creu[e; de l'Aífyrie, de la Cyrenai"que, de la Li–
bye, qu'on appelle aujourd'hui
Bimandr12a,
&
qui e1l:
dans
~
contrée de Barca: du gouvernement ap–
pcllé
ApollopoLytes nomllS,
&c. car ir y a beaucoup
d'autres
Apol/onies,
outre celles que nous venons de
nommer.
APOLLONIEN ,adj. m. on défigne quelquefois
I'hyperbole & la parabole ordinaire par les noms
d'hyperbole
&
de parabole
apoLLoniennes,
ou d'
ApoL>
lonius,
pour les
diftin¡~uer
de qllelques autres combes .
d'lln genre plus éleve,
&
auxquell"s
0.0
a auffi dón–
né le nom
d'hypabolt
&
de
parabole.
Ainfi
ax=yy
défigne la parabole
apollonienne; a a
=
x
y
déftgne
I'hyperbole
apoltonienne:
mais
a a x
=
y
3
défigne
une parabole du 3
e
degré;
a
r
=
x
y y
défigne une
hyperbole dumeme degré.
Y.
PARABOLE
&
HYPER–
BO.LE.On appelle la parabole & l'hyperbole ordi–
naIres
paraboLe
&
hyperbo~e
d'ApoLLonius,
par'fe que
nous avons de cet ancien Géometre un traite des fec–
tions
~oniques
fort
~tendu.
Ce Mathématicien <pl'on
appelle
Apollomus Pergrells,
parce qu'il étoit de Per–
ge enPamphilie, yivoit environ
250
ans avantJe–
fÍIs·Chril!:: il ramaífa fm les feaion$ coniques tout
ce qu'avoien.fait avant lui Aril!:ée, Ij'.udpxe de Cni–
de, Menrechme, Euclide, Conan, Trafidée, Nico–
tele ; ce
fi.ltlui qui donna aux trois feél:ions coniques
le nom de
paraboLe, d'ellipfi
&
d'hyperboLe,
quí non–
[eulel11ent les
diilin811~nt,
mais encore les caraél:éri–
fent.
Voye{ leurs anides.
II avoit fait huit livres <fui
parvinrent entiers jufqu 'al! tems de Pappus d'Ale–
xandrie, qui vivoit {ous Théodo{e; on ne put retroll'
ver que les <platre premiers lívres
1
ju{qu'en
¡
65 8 ;
que lefamellxBorelli t:-ollva dans !a bibliothec¡ue de:;.
Florence, un manufcnt arabe qm contenoit outre
ces quatre premiers, les trois fuivans : aidé d'uopro.:(
feífeur d'arabe,
qtti
ne {¡lvoit point
4~
Géométrie
~
i1
- X xx' ij
















