
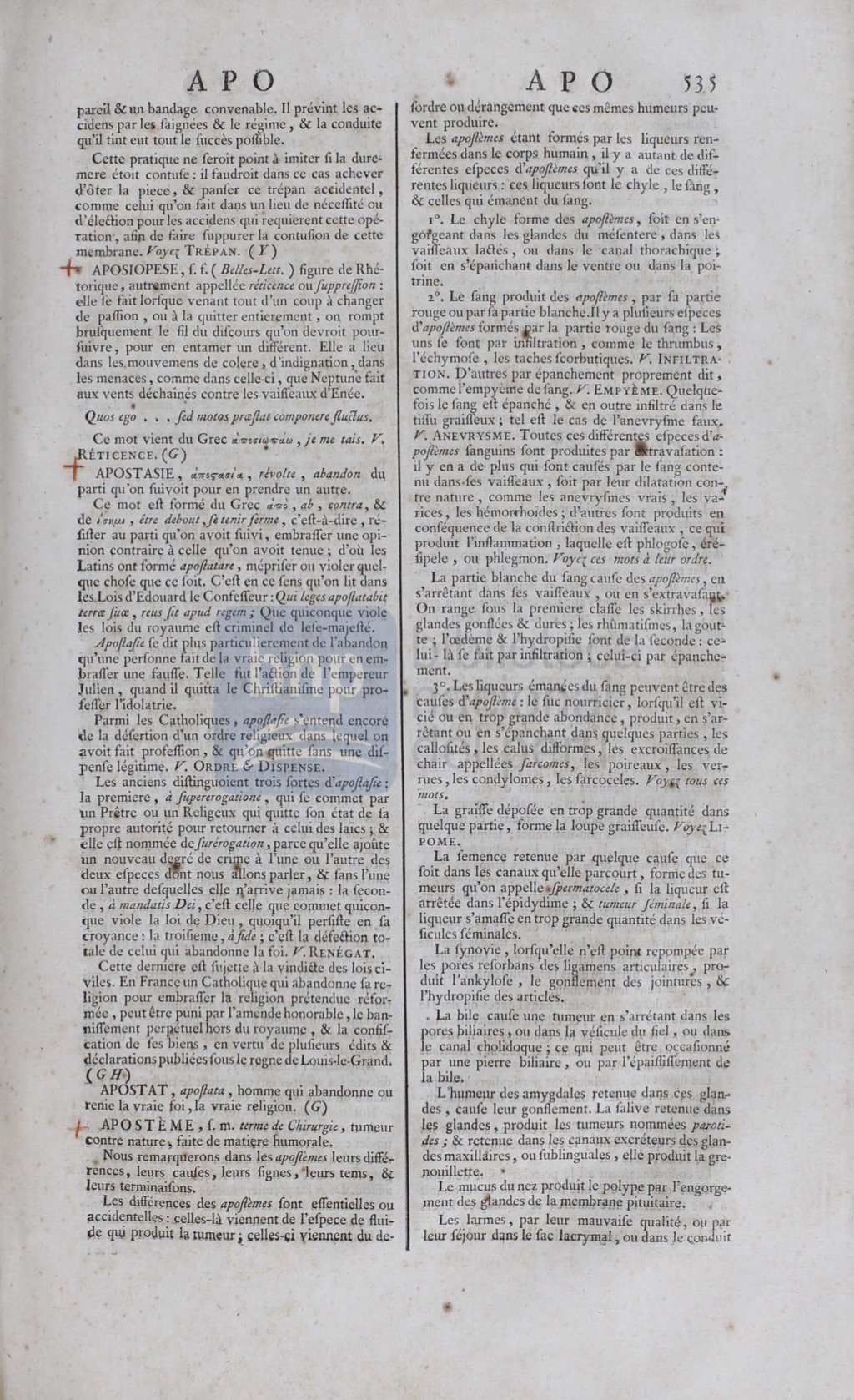
APO
pareíl
&
un bandage convenable.
Il
prévint les ac–
cidens par le¡ [aignées
&
le régime,
&
la conduite
'l,u'il tint eut tout le [ucces poílible.
Cette pratique ne [eroit point
11
imiter íi la dure–
mere étoit contu[e: il faudroit dans ce cas achever
d'oter la piece,
&
panfer ce trépan accidente!,
comme celui qu'ún fait dans un lieu de néceffité ou
d'éleaion pour les accidens qui requierent cctte opé–
ration, afijl de faire [uppurer la contufLon de cette
membrane.
Yoye{
TRÉPAN.
(Y)
APOSLOPESE,
f. f. (
BelL.:s-Lett.
)
figure de Rhé–
toriql1e, autrement appellée
réticmce oujilppr1Jion
:
elle
le
fait lorfque venant tom d'un coup a changer
de paílion, 011 a la quitter entieremer;¡t , 011, rompt
bnúquement le fil du difcours qu'on devroit pour–
fuivre, pour en entamer un différent. Elle a lieu
dans les mouvemens de colere, d 'indignation, dans
les menaces , cornme dans celle-ci, que Neptune fait
aux vents
déchaio.éscontre les vai{feaux d'Enée.
QIlOS
eg~
•••
fed motos prl2jlae componerejlllfllls.
Ce mot vient du Gree
';""0"''1'.'':'.,
,je
me tais.
Y.
,RÉTICENCE.
(G)
T
APOSTAStE,
d"'O'M/tt.,
réyolte
,
abandon
du
partí
qu'on fl1ivoit pour en prendre un autre.
Ce mot eíl formé du Gree
d",,~
,
ab, contra,
&
de
/""1-1.1
,
1m
debout
,ft
tenirfirme,
c'eíl-a-dire, rJ–
{¡í!:er au parti qu'on avoit [uivi, embra{[er une opi–
nion contraire
a
eelle qu'on avoit tenue; d'ou
le~
Latins ont formé
apojlatare,
méprifer OH violer quel–
que chofe que ce foit. C'eí!: en ce fens qu'on
lit
dans
•es.Lois d'Edouard le Confe{feur:
Qlli lcges apojlatabi{
temeJure,
rms jit aplld regem;
Que quiconque viole
les lois du Toyaume eíl crimine! de lefe-majeílé.
ApoJlajie
fe dit pll\s particulierement de l'abandoq
~l'une
perfonne fait de la vraie rcligion pOl\r en em–
bra{fer une fall{fe. Telle fut l'aaion de l'empereur
Julien, quand il quiúa le Chriil:ianifme pour pro–
fe{fer I'idolatrie.
Parmi les Cíltholiques,
apojlajie
s'entel'\d el'\core
'rle la défertion d'un or<lre religieux dans leque! 01'\
avoit fait profeílion,
&
qu'on '1llitte fans une dif–
penfe légitime.
Y.
ORDRE
&
DISPENSE.
Les anciens diftinguoient trois [ortes
d'apojl.ajie;
la premiere,
a
Jupererogatione,
qui fe comm¡;:t par
\111
Pretre ou un Religeux qui quitte fon état de f'l
~ropre
autorité pour retourner
a
eelui des lalcs
¡
&
elle el! nommée
deJurérogati()n,
parce qu'elle
~jollte
un nouveau de ré de cripe a
l'tln~
ou l'autre qes
¿eux efpeces dont nous aJlons parler,
8¡.
fans ¡'une
ou l'autre defquelles eije f\'a¡-rive jamais :
la
[econ~
de,
ti
mandatis D ei,
c'eft celle que eornmet quicon–
que viole la
loi
de Diell , qt)oiqu'il perfiíle en fa
croyancc: la troiíieme,
tifide
;
c'eft la défeaion
to–
tale de eelui
qui
abandonne la foi.
r.
RENÉGAT.
Cette derniere eft fujette
a
la yindiéte des lois ci–
'viles. En Franee un Catholiqlle qui ab¡¡ndonne fa
rc–
ligion pOlU embra{fer la religion prétenelue n\fQr–
p1ée , peutetre puni p¡¡r l'amende honor<¡ble ,le bap–
nilfement perpétue! hors du
roraurn~
,
&
la confif–
éatíon de [es biens, en vertu de plufieurs édits
&
déclarations
pupij¿~s{ous
le
r~gne
de LOllis-le-Grand.
( Gl{)
APOSTAT ,
apoflq.ta,
homme
qtJÍ abanc!onne ou
renie la vraie foi, la vraie religion.
(G)
I
AP
O ST
E
ME ,
f.
m.
termede Chirllrgie,
nllneur
Contre natllTe} faite de matif:re humorale.
Nous remarquerons dans les
apoJlemes
leurs cli/fé–
rences, leurs calÚes, leurs íignes, 'lellrs tems,
&
leu/,s tern1Ínaifons.
~es
différcjlee¡ des
apofl~mes
[ont ¡:{fentielles ou
accld~ntelles
: celles-la viennent de l'efpece de flui–
PI!
qll,l
prolllllt líl
t\lmelJJ
~
celles-ci
V~IU1ent
c;lu
de-
APO
535
fordre Oll dérangcment que
~es
m&mes humeurs pcu–
vent produire.
Les
apojl~lIles
étant formés par les Iiqtleurs l'en–
fermées d<lns le eorps humain , il
Y
a amant de
dif–
férentes efpeces
d'4poJümes
qtl'i! y a de ces di/fé–
rentes liqueurs ; ces liqueurs [ont le chyle , le fang
&
celles qtú émanent du fango
'
1°.
Le chylc forme des
apojlemes,
foir en s'en·
gófgeant dans les glandes du méfentere, dans leS
vai{feaux laaés , ou dans le canal thoraehique ;
foit en s'éparlchant dans le venere ou dans la poi–
trine.
2°.
Le [ang prodtút eles
apojlemes,
par
[a
partie
rouge ou par Ül partie blanche.Ily a plufieurs elpeces
d'apoflemes
formés Rar la partie rouue du fang : Les
uns fe font par in1iltration,
comm~
le thrumbus ,
l'éehymofe , les taches fcorbutiques.
r.
INFlL
TRA–
TI ON. D'autrcs par épanchement proprement dit,
c~mme
l'empycme
~c
ümg.
.v.
EMPyEME. Quelque–
fOlS
le fang eIt épanehé ,
&
en outre infiltré dans le
ti{fu graiífeux; te! eíl le cas de l'anevryfme faux.
Y.
ANEVRYSME. Toutes ces différentes efpecesd'a–
poJlemes
fangu.ins [ont produites par tra"afation :
il y en a de plus qui font caufés par le fang conte–
nu dans-fes vai{feam: , foit par leur dilatation eon–
tre nature, comme les anevryfmes vrais, les va}
rices, les hémorcholdes ; d'alltres font produits en
conféqucnce de la coníl:riaion des vailfeaux , ce qtü
produit l'inflammation, laqtlelle eft phlogo[e, éré–
íipele , ou phlegmon.
Yoye{ ces mots
ti
leur ordre.
, L'!, parrie blanche dI! fang caufe des
apoJlernes,
en
s an'etant dan.s fes vatn:caux , ou en s'exrravafallt•
On range [ous la premlere cla{fe les skinhes, les
glandes gonflées
&
dures; les rhumatifmes, la gOt!t>
te ; l'cedeme
&
l'hydropiíie [ont de la [econde : ce"
lui-
h\
fe fait par infiltration; celui-ci par épanche–
mento
•
3°.
Les Iiqtleurs émanées du fang peuvent &tre des
cau[es
d'apojleme
:
le fue nourrieier, lorfqp'il eft vi–
cié ou en trop grande abondance, produit; en s'ar–
r~tant
ou en s'ép,;'nchant dans quelques parties , les
callofLtés, les calus difformes, les excroi{fances de
chair appellées
Jarcomes,
les poireaux, les ver–
rues ,les condylomes, les [arcoceles.
YOY'Z tOItS
ces
mots.
La graíífe dépofée en tróp grande
qtlall~té
dans
'ql1elque partie, forme la 101lpe grailfellfe.
V
c?ye{
LI–
POME.
La [emence retenUe par qtlélqtle caufe qtle ce
[oit dans les canaux ql1'elle parcotlrt forme des
tu–
meurs qll'on appelle
•
.!fermatocele
,
fi
la liql1e¡¡r el!:
arr&tée dans l'épidydime ;
&
tlimeur féminale,
f¡
la
liqtlellr s'ama{fe en trOp grande qtlantité dans les vé–
fLcllles féminales.
La íynoyie ,
lorf~u'elle
r¡'eft poiflt repompée par
les. pores reforbans des
ligam~ns
articulaires; pro–
dUlt l'ankylofe , le gOflflell1ent des jOÍjltures,
&
l'hydropifie des articles.
. J.,a bile caufe une tl1meur en s'arrétant dans les
pores piliaires , ou dans
le}'
yéficule du fiel, ou dans
le
canal <;:holidoque; ce qtti peut &tre qccafionné
par une pierre biliaire, ou par l'epaiffi{fernent de
la bile. ·
L'hurneltr des amygdales retenue dalJs
c~s
glan.–
des, caufe leur gonflement. La [alive retenue dans
les glandes, prod¡¡it les tumeurs nommées
ptUoti–
d~s
;
&
~ete.nue
dans les. C¡lI1anx excréteurs
~es
glan–
des maxtlláJ.res , ou fub1ll1guales , elle
prodi.utla gre–
J1011illette. •
Le mtlcU5 du nez produit le pglype PElr l'enuorge–
ment des glan.<Les de la merpbr3Jle pituitaire. "
Les [¡u'mes, par lem mallvaife qualité ou
par
kur [éjour
.d~ns
le [ae lactymgl, Otl dans le'<;.onduit
















