
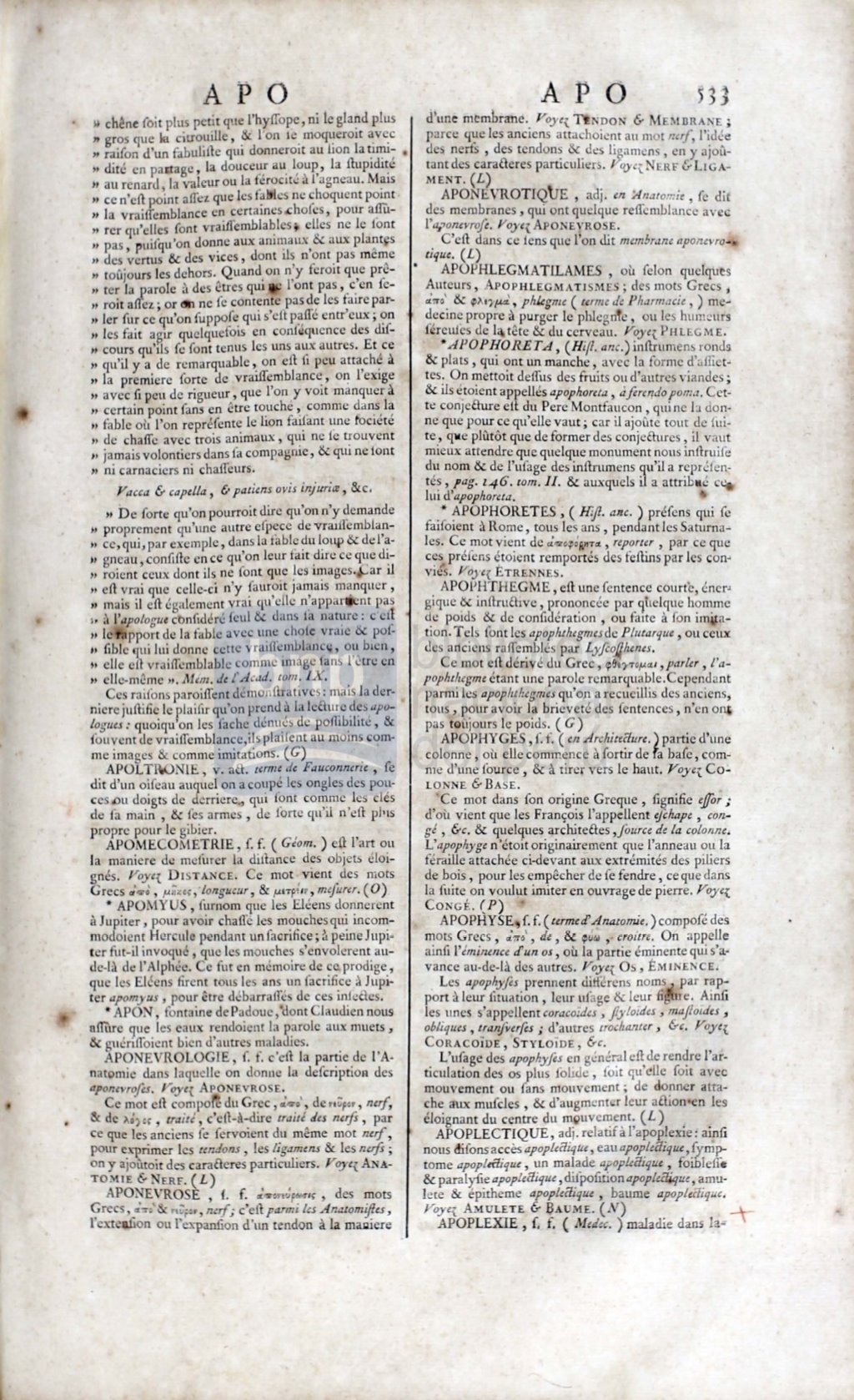
APO
)1
chene (oil plus p tit q le I'hy{[ope,
ni
l gla?d plus
" gros que
la
irrouüle ,
&
l on le!.
mo~ero¡( ~
.c
" Tal[on
d'un abulille qui donneroH au lion la
t;u~-
•
" dité en p agc , la douceur au.
I,ou~,
la
fiupldi~
II
au renard, la valeur ou la féro It<:
~
1agneau.
M~
" ce n'ell poine a{[C4 que les
f~
les ne hoqucne pOUlt
" la vraiífemblance n certalnes ho(c ,
pour~-
" rer qu'elles (ont
vraiífembla~1
S'
eU
s
ne le JOnt
" pas, puilClu'on
do~
aux
am~a\L\:,
, aux
pl~t
s
"d vertll
&
des VIces, dOnl
il
n one pas meme
" loíljours les dehor5.
Quand.onn) eroit
q~e
pre-
" ter la paroJe
a
dcs erres qUl
Iont pas,
c.enfc-
" roit a{fcz ' or
dIn
ne fe comente pas de I s faJI'e par-
" ler (ur cc 'qu'on fuppofe: qui s'eft
p~"'é
enrr'cLLx; ?n
" les fait
a~lr
quelquefOl en
cool
quence des
dif-
" cours qu'tls
(e
(ont tenus les uns aux autres. Et ce
" qu'il y a de remarquable '. on el} íi peu
attach~ ~
" la premiere foree de
vrai{[~mblanc~,
o,"!
I
eXIge
" avec íi peu de rigueur, que
1
011/ VOlt manquer
a
" ccrtain point Can en rre to.uche
~ ~omme da~s, I~
" fablc ou I'on rcpréCente le lion
a~am
une toclete
" de cha{fe avec trois animaux, ql\l ne le trouvent
" jamaisvolontiersdans fa compagnie
&
qui ne 10m
"ni arnaciers ni haífcurs.
Yacea
&
capella,
(,.
palieflS oyis injuril1l,
&c.
" De (oree qu'on pourroit dise qu'on n'y demande
II
proprement qu'une autre
efp~c devnulrembla~)1
cc,qui, par e emple, dans la fabl .
~ul.ou,p
&
de
I~j,
gneau, conlille en ce qu'on leur faH .elire
ql~e
di.–
" roient ceux dont ils ne Cont que les unages. ar
il
"ell mi que celle-ci n'y Cauroit jamais manquer,
" mais il eO: 6galement vrai qu'elle n:app
1"
nt
~a
.. a
l'apolo[JUe
c'f>n(ldéré (eul
&
daos la nacure: c
íl
"le PPOrt de la fable
a
ec
u~e:
chole vraie
por–
" íible qui
lu~
d.onne cene raIn .mbl nce,.O!\ bIen,
j'
elle ell vra\(!cmblable comm unage lan5 Ietre
n
" Ilc-ml!me
l.
M
m .
de L'.dcad.
10m.
1 .
e r¡¡i(ons paroiífent démonllratives: mais la der–
niere juílilie le plairlr qu'on
pr~nd
a la le uro
?~S
opa–
lO!Juu.'
quoiqu'on les (ache
dcnu.é~
de
pol1i~lltté ,
&
{ouvcm de vraiífemblance,ils pladent au moUl om-
me image
omme imitations.
(G)
APOL
1\0
rlE
. a .
temu de Fauconntrie,
fe
dit d un oircau auqucl on a oupé le ongle des pou–
ce u doigts de
d
'rriere qui 10nt comme I
lés
dO;) fa main ,
&
les arme , de lore qll'il n'eO: phs
proprc pOllr I gibier.
AP
E
METRIE
r.
f. (
G'om. )
fi
I'art ou
la maniere do melilT r la diJian e des obj
l>
éloi–
gnés.
Yo
'{
DISTA.:'cE. e mot vient des mOl
Grecs ,;...;
, f'ii..
~
longu ur,
&
fL'TP''' ,
meJimr.
(O)
• APO 1
, (IIrnom qlle le E1éens donnerem
n
Jupiler, pour avoir chaílc les mouchesqui incom–
modoient Hcr ule pendant un (acrilice;
~
peineJupi–
ter nlt-il invoqu ,que les mOllches 'envolerent au–
de-Ia de l'Alphée. c fur en mémoire de
a
prodige,
que le El (ens
fu
nt t
liS
les ans un racrilice
¡\
Jupi-
ler
apom
us
pour ctre Mbarra11i de ce in!
s.
• P
l
tontaine de Padoue, (lone laudi n nous
allure que les au. rendojenl
la
parolc aux muets ,
&
gu~ri(!oiem
bien d'allrres maladies.
APONEVR LOGrE
r. .
c'cO: la parcie de I'A–
natomie dan laquel1e on donne la deCcriprioR de
npon roft!.
y"
'{ PO EVRO E.
e mOt cn compo du Crec
d=o'
de
"Uf"
mrf,
, de
;"0'"
uaid
c'e!l:-A-dlre
tTrl;tl Ju
ntrfs
par
e que les ancien le Cervoiem du m me mot
ntrf,
ur
e~-primer
I s
rmJoflS
le
1;
dmUtS
les
nufi ;
n ajoutoit d caraD res parti
uli
' r5.
({
ANA-
T
~IlE~,
E.RE.( L)
AP
, EVR
E /.
f.
d"..nJ
I~
d
mots
_';''70' - ..
ii¡~.
nuf;
c'
n
parm;
fu
Anatomijlu
on ou l":\-Panllon d\m t ndon la matú re
A P O
3"
d'une memlmme..
Y Oyt{
Tl
'DO .
&
{EMDRA 'E;
parce
~e
les anclens ana hoit:ne all mot
1:
rI
I'idée
des n
rfS ,
des tendons
e
des
ü
amen en
y
jOII–
tantdes caraDeres parti ullers.
c¡y
-
E~F
&
LIGA–
MENT.(L)
APO EVROTIQ\JE, adj.
en ;4"ofomi,
Ce
dit
des membranes, qui ont qu Iqu r
ffi
mblancc aye
1'~?ofUYroft.
POJ" {
PO 'EVROSE.
'eO: dans
e
leos que I'on dit
mernbrrlnt npOlUVro–
lir¡ue.
(L)
APOPHLEGMATILAMES , ou (elon quelques
Aureurs, POPHlEGMATI
ME ;
el s mots Crees
j
d.".o'.
&
~),.Ii·,..d,
phJegme (urm
ti
Pharmocie,)
m -
decm propre
a
purger le pille
nte,
11
les hllmeurs
íi
reuf d I lete
&
du cerveau.
Yoy({
PHLEGME.
•
.dPOPHORET.A,
(Hifl.
afl
.)
i.nl1:rumen~
ronds
&
plats , qui 001 un manche, a ee la forme d'alli t–
tes. On mettoil de{[lIs des frwts 011 d'aulres \'iande .
&
ilsé.toientappeUésapophoma,
aflru¡dopOl/ld.
e;
te! eon¡efutre eH du Pere Momfaucon , qlli nc
I:t
don–
ne que pour ce qll'el1e vallt; car il ajotnc tout de (üi–
te.' qlle plíltot que de former d s conjeDmc ,il vaut
mi ux attendre qu quelque monllment nous inO:ruiJe
du nom
&
de I ufage des in.l1:rumens qu'il a reprélen–
t s,
lag.
u¡.6.
10m.
JI.
&
allxquel
il
a attrib. é '
lui
d'apopho~
la.
. O'
~POPHORETES
, (
11:jl.
anc.
)
préfens qui fc
fal(OJent aRome, tous les ans , pendant les Sanlrna–
les. e mot vient de
d"".~óA"TcL
,
reponer,
par ce que
ce pré[cns étoient rempore 's des fellins par les con–
viés.
Yoye{
ÉTRE ES.
APOPHTHEGME , eO: une (entence courte, énep
gique
&
inftruébve, prononcée par qhelque homme
de poids
&
de eoníidérarion , ou falte
a
fon imi,ta–
tion. Tels (Ont les
apopluhlgl/lesdc Plularr¡ue,
ou ceux
oc
ancien raífemblés par
iv'Jcoj¡henu.
e mOl ell dériv du
Crec,
q>&.yrOf'cLl
,parler,
['0-
popllllugme
étant une parole remarquable. ependant
parmi les
apoplalugmes
qu'O)1
a
recueillis des anciens,
IOUS,
pOllr avoir la brievet des
f¡
ntenees , n'en o",
pas toí'tjours le poids. (
G)
APOPHYGE
,r.
f. (
en
A rehiuélurt.
)
partie d'une
colonne , Olt eUe commenee fortir de fa ha(e, com–
me d'une {ouree ,
&
¡\
tirer ers le hallt.
Yoye{
Co–
l O
E
&BA
E.
e
0l0(
dans fon origine Creque, fi&nilie
tffor;
d'OII ient que les Franc;ois l'appeUent
eJchape
,
con–
e'
,
&c.
&
quelqlles arcruteél:es
,jouree de la colonne.
L'opophygt
n'étoit originairement que l'anneau oula
féraille atta hée ci-devant aux ex'trémités de pillers
de bois, pour les empecher de (e fendre , ce que dans
la (uite on voulul imiter en ouvrage de pierre.
Y oytt
ONGÉ.(P)
,
APOPHYSE
f.
f.
(ttrmurAnatomit. )
compofe des
mots Grecs ,
d
7T
o' ,
tú,
&
q>ut./ ,
croar .
On appeUe
ain1i
I'éminmct d'un os ,
011 la parrie éminenteqw s'a–
ance au-de-Ia des autres.
YOyt{
O
,ÉiI1I ENCE.
Les
apophyfls
prennent diffihens noms par rap–
pore a leur ficuarion, leur ulage
&
leur
fi
le.
Ainii
les unes s appellem
coracoüús
,
JlylOldu , maJloules
~
obtiquu , uanfoer{u
;
d'autres
trochanttr, &c. Yoytt
ORAcoioE, TYl OioE,
&c.
L'ufage des
apophyfls
en énéral eíl de rendre I'ar–
tiClllation des
os
plus lollde , (oit CJlI'cUe foit avec
mou ement ou fans mou\'ement; de donner alta–
cbe
aux
mufcles ,
&
d'augment r leur ailiono n les
é10ignant du cenrre du mQuvcmem.
<
L )
APOPLECTlQUE, adj. relatiH I apoplexie:
ainfi
nous diloosacces
apopleaiqlit,
eau
apopleair¡Ia
,
(ymp–
torne
apopl.mque,
un malade
apopúmr¡Ut,
oibleífe
&
paralyúe
apopleai'1/1e ,
elilpofition
apopleéW¡ue,
amu–
lete
&
épitb me
apopüélir¡ut
baume
apopleHir¡ue.
Y~y'{
A MULETE
&
BA
ME.
<N)
APOPLEXIE,
r.
f. ,
Mtd~
. )
maladie dan 1a-
















