
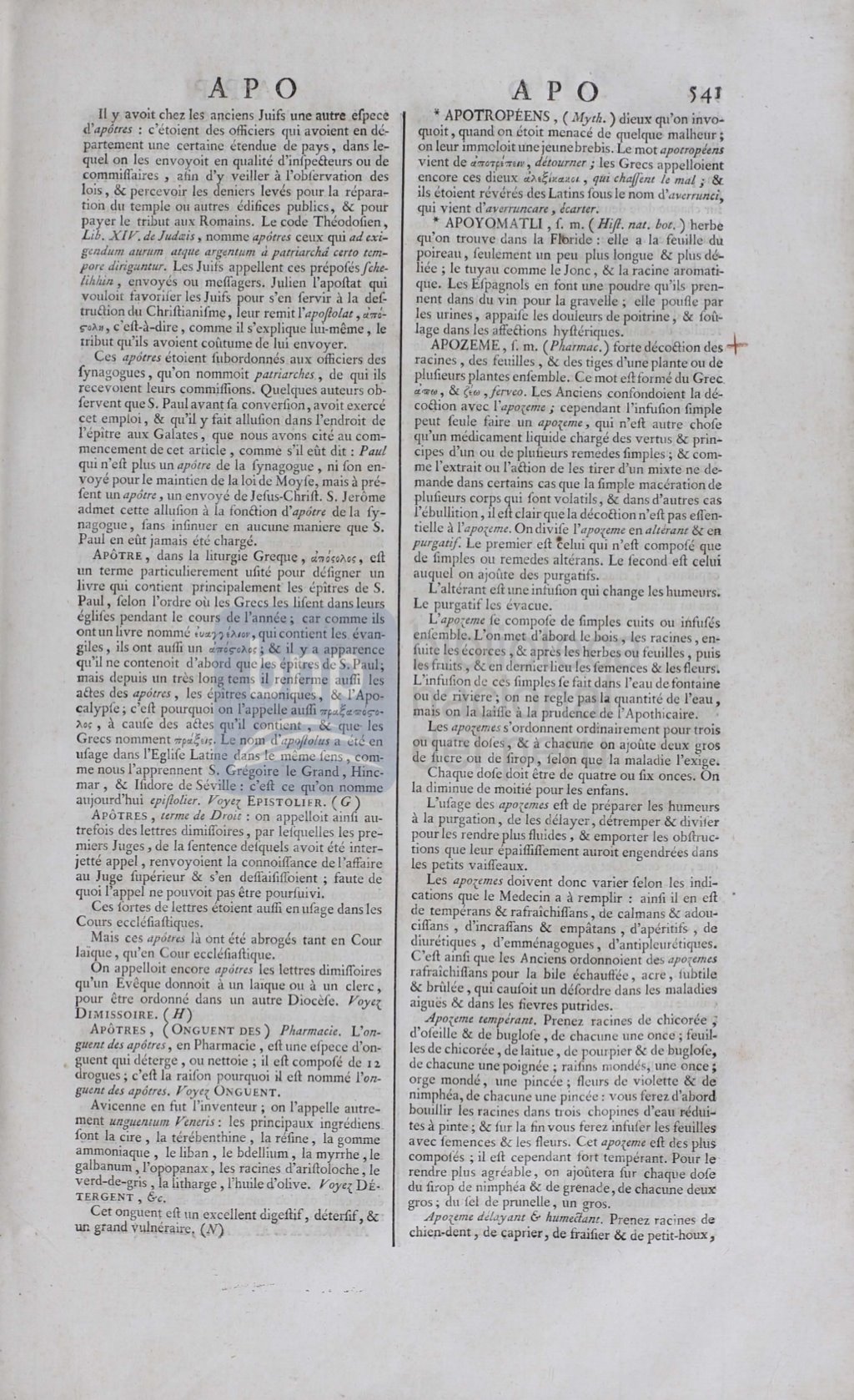
APO
Il
Y avoit chez les anciens Juifs une autre efpeee
d'apótres
:
c'étoient des officiers qui avoient en dé–
partement une certaine érendue de pays, dans le–
quel on les envoyoit en qualité d'infpeél:eurs ou de
eommiífaires , afin d'y veiller
a
l'obfervation des
lois,
&
percevoir les deniers levés pour la répara–
rion dll temple ou autl·es édifices publics,
&
pOtU·
payer le tribut aux Romains. Le code Théodoúen,
Lib.
XlV.
d. JudtÚs,
nomme
apótres
ceux qui
ad exi–
gendum aUT/lm at<jlle argentlllll
J.
patriarcha ceno tem–
pore dirig:mtar.
Les Juifs appeIlenr ces prépoCésfche–
fi/z1zin,
envoyés ou meífagers. Julien l'apofiat qui
vouloir favoriíer les Juifs pour s'en fervir
a
la de[.
truéhon du ChrifiianiCme, leur remit
l'apoJlofat
,d7T~$"OAII,
c'efi-a-dire , comme il s'explique llU-meme, le
rribut qu'ils avoient eofttume de lui envoyer.
Ces
apótres
étoient fubordonnés aux officiers des
fynagogues, qu'on nommoit
patriarches ,
de qui ils
receVOlent leurs commiílions. Quelques auteurs ob–
fervent que S. Paul avant fa converúon, avoit exercé
cet emploi,
&
qu'il y fait alluíion dans l'enclroit de
l'épitre aux Galates, que nous avons cité au com–
mencement de cet article, comme s'il eflt dit :
Pallf
qui n'efi plus un
apótre
de la fynagogue, ni fon en–
voyé pour le maintien de la loi de Moyfe, mais
a
pré–
fent
unapótre,
un envoyé de Jefus-Chrifi. S. Jerome
admet cetre alluíion a la fonél:ion
d'apótre
de la fy–
nagogue, fans iníinuer en aucune maniere que S.
Paul en eut jamais été chargé.
ApOTRE, dans la liturgie Greque ,
d7l~'OAO',
efi
un terme particulierement uíité pour déíigner un
livre qui cO'1tient principalement les épitres de S.
Paul, felon I'ordre Olt les Grecs les li[ent dans leurs
égliCes pendant le cours de I'année; car comme ils
ont un Iivre nommé
;U!L"Y)
iAIOV ,
qui contient les évan–
giles, ils ont auíJi un
d7T¿C;-OAO,;
&
il Y a apparence
qu'il ne contenoit d'abord que les épitres de S. Paul;
mais clepuis un tres long tems il renferme auíli les
aél:es des
apótres,
les épitres canoniques,
&
I'Apo–
calypfe; c'efi pourquoi on I'appelle auffi
7TpCi.~"-""O$"o
AO,
, a catúe des aél:es qu'il contient ,
&
que· les
Grecs nomment
.,pd.~",.
Le nom
d'apojlollls
a été en
ufage dans l'Eglife Latine dans le meme fens , com–
me nous l'apprennent S. Grégoire le Grand, Hinc–
mar,
&
Iúdore de Séville: c'efi ce qu'on nomme
aujourd'hui
epiflolier. Voye{
EPISTOLI ER. (
G )
ApOTRES,
terme de Droit
:
on appelloit ainíi au–
trefois des letrres dimiífoires, par lef(jllelles les pre–
miers Juges, de la fentence de{quels avoit été inter–
jetté appel, renvoyoient la connoiífance del'affaire
au Juge fupérieur
&
s'en delfaiíiífoient ; faute de
quoi I'appel ne pouvoit ,ras elre pourfuivi.
Ces (<lrtes de lettres etoient auffi en ufage dans les
Cours eceléúailiques.
Mais ces
apótres
la
ont été abrogés tant en Cour
laique, qu'en Cour eccléfiafiique.
On appelloit encore
apótres
les lettres dimiífoires
qu'un Eveque donnoit
a
un lalque ou
a
un e1erc,
pour etre ordonné dans un autre Diocefe.
Voye{
DIMISSOIRE.
(H)
ApOTRES, (ONGUENT DES)
Pharmacie. L'on–
guent des apótres
,
en Pharmacie , efi une efpece d'on–
guent qui déterge , ou netroie ; il eíl: compofé de
12-
drogues; c'eíl: la raifon pourquoi iJ. efi nommé
l'on-
guentdes apÓtres. Voye{
ONGUENT.
.
Avicenne en fut I'inventeur; on I'appelle autre–
ment
unguenllllll Veneris:
les principaux ingrédiens.
font la cire, la térébenthine, la réíine, la gornme
ammoniaque, le liban, le bdellium , la myrrhe ,le
galbanum , I'opopanax , les racines d'ariíl:oloche, le
verd-de-gris, la litharge, l'huile d'olive.
Yoye{
DÉ–
TERGENT ,
&c.
Cet onguent eíl: un excellent digefiif, déte¡fú,
&
un grand vlJlnéraire.
(N)
APO
54
J
1>
APOTROPÉENS ,
(Myth.
)
dieux qu'on invo–
quoit, qlland on étoit menacé de quelque malheur;
on leur immcloit une jeunebrebis. Le mot
apotropéens
vient de
d.,o-rpi7TUV,
détourner;
les Grecs appelloient
encore ces dieux
dA'~;Y.a."OL,
<jui ch1fene
le
mat;
&
ils étoient révérés des Latins fous le nom d'
aJlerrunci,
qui vient
d'avernmcare, Jearter.
i<
APOYOMATLl, f. m.
(Hift. nato bot.)
herbe
qu'on trouve dans la Floride: elle a la feuiUe du
poireau, feulement un peu plus longue
&
plus dé–
Iiée ; le tuyau comme le Jonc,
&
la racine aromari–
que. Les Efpagnols en font une poudre qu'ils pren–
nent dans du vin pour la gravelle; elle pouíle par
les urines, appaife les douleurs de poitrine,
&
foft-
lage dans les affeilions hyíl:ériques.
+
APOZEME,
f.
m.
(Plzarmac.)
forte décoél:ion des
racines, des feuilles ,
&
des riges d'une plante ou de
pluíieurs
~lantes
enfemble. Ce mot efrformé du Gree
d""""
&
~.",
,firveo.
~cs
Anciens confondoient la dé–
coél:ion avee
I'apo{eme ;
cependant l'infuíion íimple
peut feule faire un
apO{ellle,
qtÚ n'efi autre chofe
qu'un médicament liquide chargé des vertus
&
prin–
cipes d'un ou de pluúeurs remedes fimples ;
&
com–
me I'extrait oul'ailion de les tirer d'un rnixte ne de–
mande dans certains cas que la íimple rnacération de
plufieurs corps qui font volatils,
&
dans d'autres cas
l'ébullition, il eHclairque la décoaion n'efi pas eífen–
tielle
a
I'apo{eme.
OndiviCe
l'apo{eme
en
altérane
&
en
purgad!
Le premier efi
~elui
qui n'efi compoCé que
de íimples ou remedes altérans. Le fecond efi celui
auquel on ajoftte des purgatifs.
L'altérant eíl: une infuíion qui change les humeurs.
Le purgatif les évaeue.
L'apo{eme
fe compofe de fimples ClIits ou iMufés
enfemble. L'on met d'abord le bois, les racines, en–
fuite les écorces ,
&
apres les herbes ou feuilles , puis
les fnúts ,
&
en dernier Iieu les femences
&
lesf1eurs.
L'infuíion de ces funples fe fait dans I'eau defontaine
ou de riviere ; on nc regle pas
lot
quantiré de l'eau,
rnais on la ¡ailfe
a
la prndence de l'Apothicaire.
Les
apo{~mes
s'ordonnent ordinairement pour trois
ou c¡uatrc dofes,
&
a
chacune on ajollte deux gros
de Iilcre ou de íirop, felon que la maladie I'exige.
Chaque dofe doit etre de quatre ou fIX onces. On
la diminue de moitié pour les enfans.
L'ufage des
apo{emes
efi de préparer les hllmeurs
a la purgation, de les délayer, détremper
&
divifer
pour les rendre plus fluides,
&
emporrer
le~
obfiruc–
ti011S que leur épaiíliífement auroit engendrées dans
les petits vai1TeallX.
Les
apo{unes
doivent donc varier felon les indi–
cations
~ue
le Medecin a
a
remplir : ainfi il en eíl:
de temperans
&
rafraichiífans, de calmans
&
adou–
ciífans , d'incraífans
&
empihans, d'apéritifs , de
diurétiqlles , d'emménagogues, d'antipleurétiques.
C'efi ainíi que les Anciens ordonnoient des
apo{emes
rafraichiíIans pour la bile échauftee, acre, ii.lbtile
&
brulée ,
'luí
caufoit un déCorclre dans les malac!ies
aiglles
&
dans les fievres putrides.
Apo{ellle tempirane.
Prenez racines de chicorée ;.
d'oCeille
&
de bllglofe , de chacune une once; feuil–
les de chicorée , de laiule, de pourpier
&
de buglofe,
de chacune une poignée ; raiíim mondés, une once;
orge mondé, une pincée; flcurs de violette
&
de
nimphéa, de chacllne une pincée; vous ferez d'abord
bouillir les racines dans t:rois chopines d'eau védui–
tes
a
pinte;
&
fur la fin vous ferez infufer les feuilles
a
vee
femences
&
les fleurs. Cet
apo{eme
efi des plus
compofés ; il eíl: cependant fort tempérant. Pour le
rendre plus agréable, on ajoittera Cur chaque dofe
du frrop de nimphéa
&
de grenade, de chacune deux
gros; du
fel
de pnmelle, un gros.
Apo'{eme dJiqyant
&
humeaant.
Prenez racines de
chien-dent, de caprier, de fraiíier
&
de petit-houx
~
















