
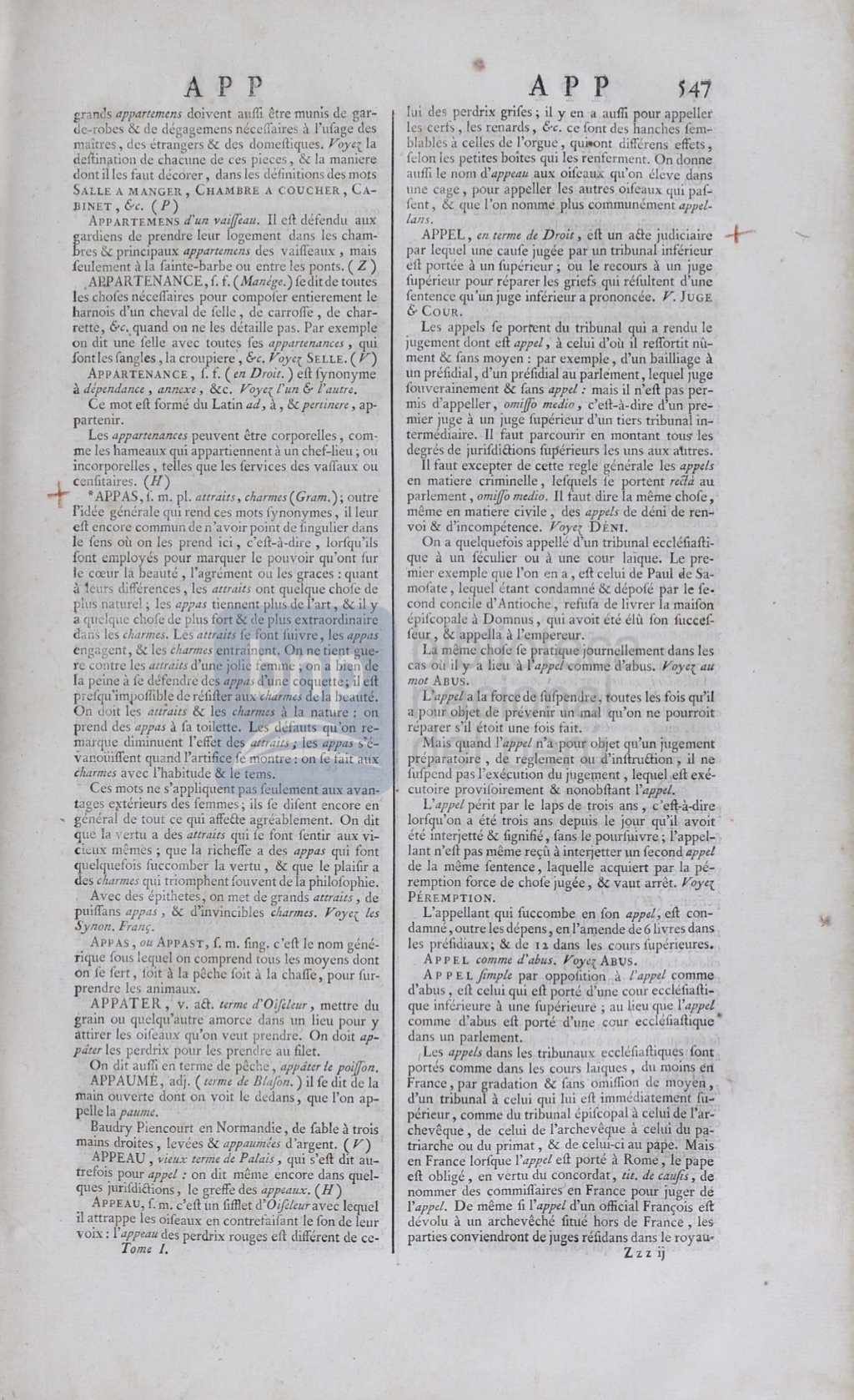
AP P
grands
appartemens
doivent auJli &tre munis de gar–
de-robes
&
de dégagemens néceífaires
a
l'u{age des
maltl'es , des étrangers
&
des domeíliques.
Voye.¡:
la
deilination de chacune de ces pieces ,
&
la maniere
dont il les faut décorer, dans les définitions des mots
SALLE AMANGER, CHAMBRE A COUCHER, CA–
DINET,
&c.
e
P)
ApPARTEMENS
¿'1m vaif{eau.
Il
ea défendu aux
gardiens de prendre 1eur logement d¡¡ns les cham–
bres
&
principaux
appartemens
des vai{[eaux, mais
feulement
a
la (ainte-barbe ou entre les ponts.
e
z )
.AP.PARTENANCE ,
f.
f.
eManége. )
(editde tolltes
les chofes néceíraires pour compofer entierement le
harnois d'un cheval de felle, de carroíre , de char–
rette,
&c..
quand on ne les détaille pas. Par exemple
on dit une felle avec toutes fes
apparlenances ,
qui
10ntles fangles, la croupiere,
&c. Voye.¡:
SELLE.
e
V )
ApPÁRTENANCE,
f.
f.
(en
D roil.)
ea fynonyme
a
dépendance, annexe,
&c.
Voye{ tun
&
L'aUlre.
Ce mot
ea
formé du Latin
ad,
a,
&
pminere,
ap–
partenir.
Les
appartenances
peuvent &tre corporelles,
com–
me les hameaux qui appartiennent
a
un chef-lieu; ou
incorporelles , telles que les fervices des vaífaux ou
ceníitaires.
eH)
..APP
AS,
f~
m. pI.
auraits, clzarmes
e
Gram.);
outre
fidée générale qui rend ces mots fynonymes, illeur
ea encore commun de
n
'avoir point de fingulier dans
le fens Oll on les prend ici, c'ea-a-dire , lorfqu'ils
font employés pour marquer le pouvoir qu'onr fur
le creur la beauté , I'agrément ou les graces ; quant
a
teurs di/férences , les
altrailS
ont quelque chofe de
plus naturel; les
appas
tiennent plus de l'art,
&
il
Y
a quelque chofe de plus fort
&
de plus extraordinaire
dans les
c!tarmes.
Les
allraits
fe font fuivre, les
appas
engagent,
&
les
c/tannes
entrainent. On ne rient gue–
re contre les
attraÍts
d'une jolie femme ; on a bien de
la peine
a
fe défendre des
appas
d'une coquette; il
ea
prefqu'im,poJlible de réfi11:er aux
ellarmes
de la beauté.
On doit les
atúaits
&
les
,/tarmes
a la nature ; on
prend des
appas
a
fa toilette. Les défauts qu'on re–
marque diminuent l'e/fet des
attraits;
les
appas
s'é–
vanoiiiífent quand I'artilice fe montre ; on fe fait aUJe
ellarmes
avec l'habitude
&
le tems.
Ces mots ne s'appliCj11ent pas feulement aux avan–
tages e¡ctérieurs des femmes; ils fe di{ent encore en
, général de tout ce qui a/feae agréablement. On dit
que la vernl a des
attraits
Cjui {e fonr fentir aux vi–
cieux memes ; que la riche{[e a des
appas
Cj1ti font
quelc¡uefois fuccomber la vertu,
&
que le plai{u' a
des
clzannes
qllÍ triomphent fouvent de la philofophie.
Avec des épithetes, on met de grands
attraits,
de
puiírans
appas,
&
d'invincibles
e/larmes. Voye{ Les
Synon. Fran
y•
ApPAS ,
ou
AppAST,
f.
m. fing. c
'ea
le nom géné–
rique fous leCj11el on comprend tous les moyens dont
on fe fert, foit a la peche foit a la chaífe , pour fur–
prendre les animaux.
APPATER, V. aa.
lerme d'OifeLeltr ,
mettre du
gr~in
ou qu.elqu'autre amoree dans un 1ieu pour y
artlrer les olfeaux qu'on veut prendre. On doit
ap–
páter
les perdtix pour les prendre au Iilet.
011 dit auíft en terme de p&che,
appáler
le
poij{on.
APPAUME, adj. (
terme de BlaJan.
)
iI
fe dit de la
main ouverte dont on voit le dedans, que l'on ap–
pelle la
paltme.
~audry
Piencourt en Normandie, de fable
a
trois
mams droites, levées
&
appaumées
d 'argent.
( V )
APPEAU ,
vieux lerme de Palais ,
'lui
s'ea
dit au–
trefoi~
pOllr
appel
:
on dit m&me encore dans quel–
Cjlles ]urifdiUions, le gre/fe des
appeaux.
eH)
. ApPEAU, Cm. c'ea un flillet
d'Oifeleuravec
leque!
il
attrappe les oifeaux en eontrefaifant le fon de leur
voix ; l'
appeau
des petdrix rouges
ea
di/férent de ce-
Tome
1.
APP
547
lui des perdrix grifes ; il Y en a allffi pour appeller
les cerfs , les renards,
&c.
ce font des hanches fem–
blables
a
celles de l'orgue , qui.ont difFérens e/fets,
felon les petites boites qui les rel{ferment. On donne
auJli le nom
d'appealt
allx oifeaux Cj11'011 éleve dans
une cage , pour appeller les autres oifeaux qui paf–
fent,
&
que l'on nomme plus communément
appel–
larrs.
APPEL,
en lerme de D roit, ea
un aae judiciaire
par lequel une caufe jllgée par un tribunal inférieur
ea
portée
a
un fupérieur;
OU
le recours
a
un juge
fupérieur pOUI réparer les griefs Cj1ti réfultent d'une
fentence qu 'un juge inférieur a prononcée.
V.
J
UGE
&
COUR.
Les appels fe portent du tribunal qui a rendu le
jugemenr dont eíl:
appel,
a
celuí d'olt il refI'ortit n\l–
ment
&
fans moyen ; par exemple, d'un bailliage
a
un préfidial, d'un préfidial au parlément, lequel ]uge
fouverainement
&
fans
appel:
mais il n'ea pas per–
mis d'appeller ,
omij{o medio ,
c'eíl:-a-dire d'un pre–
mier juge
a
un juge fupérieur d'tm tiers tribunal in–
termédiaire.
Il
faut parcourir en montant touS' les
degrés de jurifdiilions fuJ5érieurs les uns aux a\ttres.
Il
faut excepter de cette regle générale les
appels
en matiere criminelle, lefquels
fe
portent
reao.
au
parlement,
omij{o medio.
Il
f¿mt dire la m&me chofe,
m&me en matiere civile, des
appels
de déni de ren'"
voi
&
d'incompétence.
Voye{
D ÉNI.
On a quelqllefois appellé d'un tribunal eccléfiaíl:i–
que
a
un fécuJier ou
a
une com lai'que. Le pre–
'mier exemple que 1'0n en a , e11: celui de Paul ae Sa–
mofate, lequel étant condamné
&
dépofé par le fe–
cond concile d'Antioche, refufa de livrer la maifon
épifcopale
iI
D omnus, qui avoit été élft fon {nccef–
feur ,
&
appella
a
l'empereur.
La meine chofe fe pratique journellement dans les
cas Ol! il
Y
a lieu
a
l'appel
comme d'abus.
Voye{ au
mot
ABUS.
L'
appel
a la force de fufpendre, foutes les fois qu'il
a pour objet de prévenir un mal Cj11'on ne pourroit
réparer s'il étoit une fois fair.
Mais quand
l'appel
n'a-p011! objet qu'un jugement
préparatoire , de reglement ou d'infuuélion , il ne
fufpend pas I'exécution du jugelTlent , lequel eíl: exé–
cutoire provifoirement
I\l
nonobaant
l'apyel.
L'appel
périt par le laps de trois ans,
c'eft-a-dir~
lorfgu'on a été troís ans depuis le
jO~lr
qu'il avoit
été mterjetté
&
fignifié, fans le pourüúvre; l'appel–
lant n'eíl: pas m&me
re~fl
a
interjetter un fecond
appet
de la m&me fentence, laqueUe acqttiert par la pé–
remption force de chofe jugée
J
&
vaut arr&t.
Voye{
PÉREMPTION.
L'appellant qui fuccombe en fon
appet,
eíl: con:
damné , outre les dépens, en I'amende de6 1ivres dans
les préfidiaux;
&
de
12
dans les cours fupérieures.
ApPE L
comme ¿'abuso
V~e{ ABus.
A P P EL
jimple
par oppofition
a
l'appel
comme
d'abus, ea celui Cj1ti eíl: porté d'une cour eccléfia11:i–
Cj1le inférieure
a
une fupérieure ; au Lieu Cj1le
l'appe!
comme d'abus ea porté d'une cour eccléíiaíl:ique ·
dans un parlement.
,Les
appels
dans les tribunaux eccléliaaiques [ont
portés comme daos les cours lruques, du moins
en
France, par gradation
&
fans omiffion de moyen,
d'un tribunal
iI
celui Cj1li lui eíl: immédiatement fu–
périeur, comme du tribunal épifcopal
a
celui de l'ar–
CheVeqtle, de c;ehú de
l'archeveCj11~
a celui du pa–
triarehe ou du primat,
&
de Ce1Ui-Cl au pape. Mais
en France lorfque
l'appel
eíl: porté a Rome, le pape
ea
obligé, en veml du concordar,
tit. de cazifis,
de
nommer des commiffaires en France pour juger
qe
l'appet.
D e meme fi
l'appel
d'un oflicial
Fran~ois
e1l:
dévolu
a
un archev@ché finlé hors de France , les–
parties conviendront de juges réfidans daos le royau-
ZZ7.
ij
















