
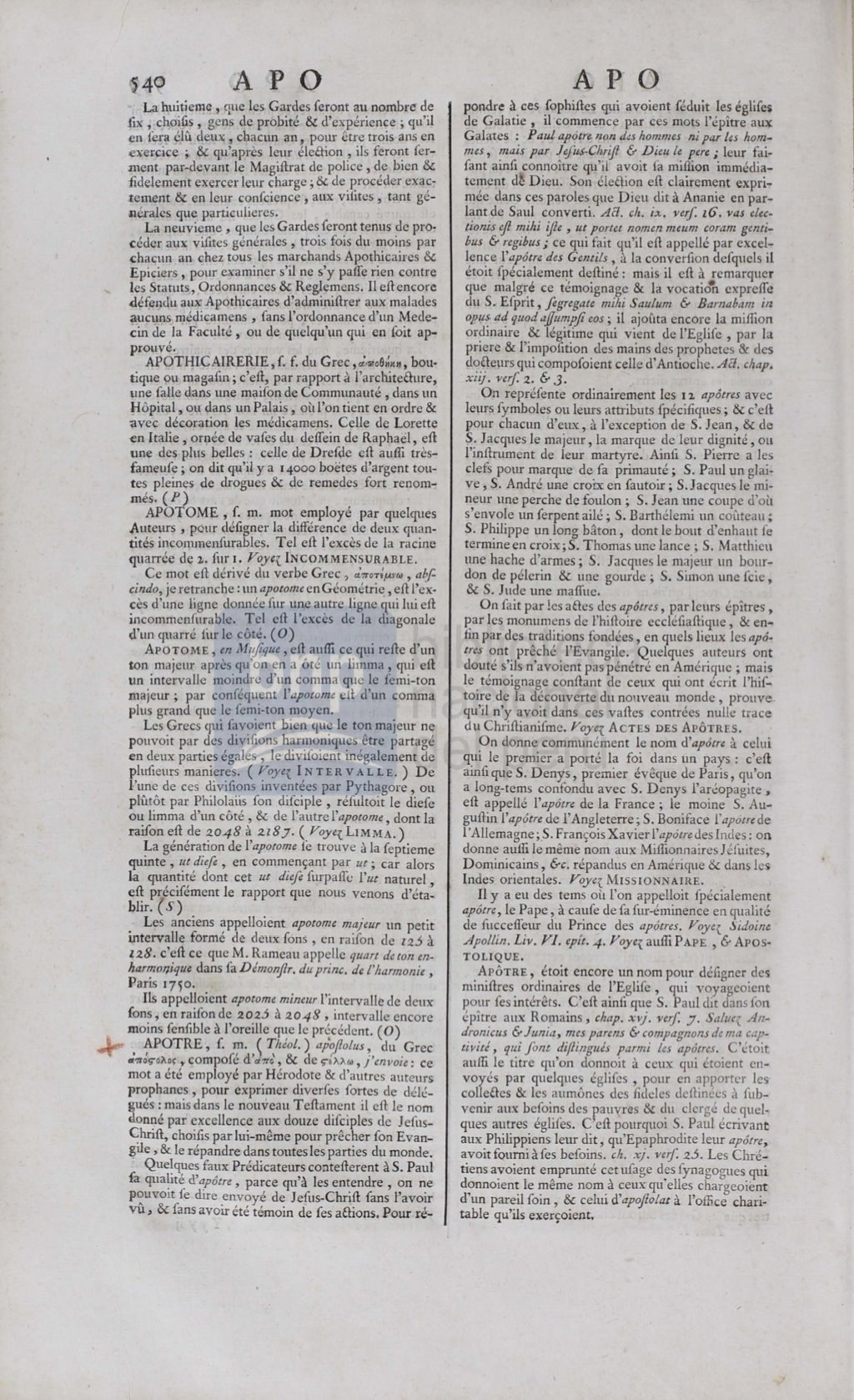
APO
La
hlútieme , que les Gardes feront au nombre! de
fIx , ch.0'iús, gens de probité
&
d'expérience ; qu'il
en
fer~
élCI deux , chacun an, pom
~tre
trois ans en
exercice ;
&
qu'apres leur élefrion
?
ils
fero~t
(er–
ment par-devant le Magiftrat de police , de bIen
&
fidelement exercer leur charge ; & de procéder exac–
.tement
&
en leur confcience, aux viútes, tant gé–
nérales que particulieres.
La neuvieme, que les Gardes feront tenus de pro–
céder aux viútes générales , trois fois du moins par
chacull an chez touS les marchands Apothicaires
&
Epiciers, pour examiner s'il ne s'y paffe rien contre
les Statuts, Ordonnances
&
Reglemens. Il eílencore
céfendu auxApothicaires d'adminiílrer aux malades
aucuns médicamens , fans l'ordonnance d'un Mede–
cin de la Faculté, ou de quelqu'un quí en foit ap–
prouvé.
APOTliLCAIRERIE, f. f. du Grec,
d""o8~y.n,
bou–
tique ou magafin; c'eíl, par rapport
a
l'architeétme,
une falle dans une maifon de Commlmauté , dans un
,tIopital, ou dans un Palais, oid'on tient en ordre
&
avec décoration les médicamens. Celle de Lorette
~n
ltalie,
on~ée
de vafes du deífein de RaphaeI, eíl
une des plus belles: celle de Drefde eíl auffi tres–
fameufe; on dit qu'il y a
14000
boetes d'argent tou–
tes pleines de drogues
&
de remedes fort renom–
més.
(P)
APOTOME ,
f.
m. mot employé par quelques
Auteurs , pour déúgner la différence de deux 'luan–
tités incommenfmables. Te! eíll'exces de la racine
quarrée de
2..
fur
l.
Voye{
INCOMMENSURABLE.
Ce mot eíl dérivé du verbe Grec ,
d."o";",.,,,
,
aE1-
cindo,
je retranche :1m
apotome
enGéométrie ,eíll'ex–
d:s d'une ligne donnée fm une autre ligne 'lui !tú eíl
incommenfmable. Tel eíl l'exces de la cliagonale
d'un c¡uarré tilr le coté.
(O)
ApOTOME,
Ul
Mlifique
,
eíl auffi ce 'luí reíle d'un
ton majeur apres qu'on en a oté un limma, c¡ui eíl
un intervalle moindre d'un comma que le femi-ton
majeur; par conféc¡uent
I'apotome
eH d'un comma
plus grand que le femi-ton moyen.
Les Grecs c¡ui favoient bien c¡ue le ton majenr ne
pouvoit par des dívifions harmoniques
~tre
partagé
en deux parties égales, le divifoient inégalement de
plufleurs manieres.
(Voye{
J NTER
V
ALLE. ) De
['une de ces divifions inventées par Pythagore , ou
plutot par Philolaiis fon difciple , réfultoit le diefe
ou limma d'un coté,
&
de I'autre
l'
apotome,
dont la
raifoneil: de
2048
a
2z8:J.
(Voye{LIMMA.)
La génération de
l'apotome
le
trouve
a
la feptieme
quinte ,
lit diife
,
en commen<;ant par
ut;
car alors
la
quantité dont cet
ut diife
furpaífc
l'ut
naturel
eíl précifément le rapport que nous venons
d'éta~
blir.
(S)
Les anciens appelloient
apotome majeur
un petit
intervalle formé de deux fons , en raifon de
Z2.5
a
l28.
c'eíl ce que M. Rameau appelle
quart de ton en–
harmo¡¡jque
dans fa
D émonjlr. du princ. de ¡'harmonie ,
París
1750.
lis appelloient
apotome minmr
I'intervalle de deux
(ons, en raifon de
202.5
a
2048
,
intervaIle encore
moins fenflble a l'oreille que le précédent.
(O)
APOTRE, f. m. \
Théol.) apo;zolus,
du Grec
.:.,,~~o;>,.o,
,.compofé d'''7T.',
&
de
~'A;>"'"
,j'envoie :
ce
mot a été employé par Hérodote
&
d'autres auteurs
prophanes , pour exprimer diverfes fortes de délé–
gués : mais dans le nouveau Teil:ament il eil: le nom
donué par excellence aux douze difciples de Jefus–
~hrill,
choifis par lui-m&me pOUT pr&cher fon Evan–
gile ,
&
le répandre dans tontes les parties du monde.
Quelques faux PrédicateuTs conteílerent aS. Paul
fa
qt\a~té
d'apótre,
parce qtl'a les entendre , on ne
pOUVOlt fe dire envoyé de Jefus-Chriíl fans l'avoir
vil> &
fans avoir été témoin de fes aétions. Pour ré-
APO
pondre
a
ces fophiíles qtú avoient féduit les églifei
de Galatie,
il
commence par ces mots I'épltre aux
Galates :
PauJ
aflotr~
non d.s hommes ni par l.s hom–
fileS,
mais par l efitt-Chrijt
&
Dieu le Fere;
leur fai–
fant ainfi connoltre qu'il avoit fa miílion immédia–
tement d! Dieu. Son éleéUon eíl clairement expri–
mée dans ces paroles que Dieu dit a Ananie en par–
lantde Saul convertí.
Aa.
ch.
i:r..
veif.
z6.
vas
elu–
tionis
efl
mihi
~r¡e
,
ut pOr/el nomen mmm ,oram genti–
bus
&
regibus;
ce qui fait c¡u'il eíl appellé par excel–
lence l'
apótre des Gelltils
,
a la converlion defqtlels iI
étoit fpécialemef!t defiiné: mais il eíl
a
remarquer
que malgré ce témoignage
&
la vocati<fn expreífe
du S. Efprit,
figregate mihi Saulum
&
Barnabam
ilz
OpllS ad quodaJlitmpJi eos;
il
ajollta encore la miffion
ordinau·e
&
légitime qtú vient de l'Eglife , par la
priere
&
l'impofition des mains des prophetes
&
des
doéteurs c¡tÚ compofoient celle d'Antioche.
Aa.
chapo
xiij. verf.
2.
&
3.
On repréfente ordinairement les
12.
apótrts
avec
leurs fymboles ou lenrs attributs fpécific¡ues;
&
c'efi
pour chacun d'eux, a I'exception de S. Jean,
&
de
S. Jacqtles le majeur, la marque de leur dignité, Ol!
l'in!trument de leur martyre. Ainfi S. PielTc a les
clefs pour marque de fa primauté; S. Paul un glai–
ve, S. André ume croix en fautoir ; S. Jacc¡ues le mi–
neur une perche de foulon; S. Jean une coupe d'oll
s'envole un ferpent ailé; S. Bdrthélemi un cOllteau;
S. Philippe un long baton, dont le bout d'enhaut fe
termine en croix;S. Thomas une lance; S. Matthien
une hache d'armes;
S.
Jacques le majeur un bour–
don de pélerin
&
une gourde; S. Simon une fcie,
&
S. Jude tme maífue.
On fait par les aétes des
apótres,
par leurs épltres •
par les monumens de l'hiíloire eccléfiaílique,
&
en–
fin
par des traditions fondées, en c¡uels lieux les
apó–
tres
ont
pr~ché
l'Evangile. Quelques auteurs ont
douté s'ils n'avoient pas pénétré en Améri9ue ; mais
le témoignage conil:ant de ceux qtú ont eCI·it
l'hif~
toire de la découverte du nOllveau monde, prouve.
qtl'il n'y avoit dans ces vaíles contrées nulle trace
du Chriílianifme.
Yoye{
ACTES DES ApOTRES.
On donne communément le nom d'
apótre
a
celui
qui le premier a porté la foi dans un pays: c'efi
ainfi que S. Denys, premier éveque de Paris, qu'on
a long-tems confondu avec S. Denys l'aréopagite •
eíl appellé
I'apótre
de la France ; le moine S. Au–
guíEn
l'apótre
de l'Angleterre;
S.
Boniface
l'apotrede
I'AlIemagne
;.S.
Fran<;ois Xavier l'
apótre
eles Jndes: on
donne auffi le meme nom aux Miffionnaires J '{uites,
Dominicains,
&c.
répandus en Améric¡ue
&
dans les
Indes orientales.
Voye{
MISSIONNAIRE.
n
y a eu des tems OLt I'on appelloit fpécialement
apótre,
le Pape, a caufe de fa fur-éminence en qtlalité
de fucceífeur du Prince des
apÓtres. Yoye{ Jídoine
Apollin. Liv. VI. epít.4- I/oye{
auffiPAPE ,
&
Apos–
TOLIQUE.
ApOTRE, étoit encore
un
nom pour défigner des
miniftres ordinaires de l'Eglife, qui voyageoient
pour fes intér&ts. C'eíl ainfi que S. Paul dit dans fon
épltre aux Romains,
chapo xv}.
veif.
:J.
Snlue{
AIl–
droníclIs
&
lunía, mes parens
&
compagnons de ma cap–
tivitl,
qui font diflingués parmi les apótres.
C'étoit
auffi le titre clu'on donnoit
a
ceux qui étoient en–
voyés par quelques églifes , pour en apportcr les
colleétes
&
les aumones des fide!es defrinées a fub–
venir alL'{ befoins des pauvres
&
du clergé de quel–
ques autres églifes. C'eíl pourqtlOi S. Paul écrivant
aux Philippiens leur dit, qu'Epaphrodite leur
apótre,
avoitfQurniHes befoins.
ch. x}. verf.
2.5.
Les Chré–
tiens avoient empmnté cet u[age des fynagoglles qtli
donnoient le
m~me
nom a ceux qu·elles chargeoient
d'un pareil [oin ,
&
celui
d'apojlotat
a
I'oflice chari–
table qu'ils
exer~oient.
















