
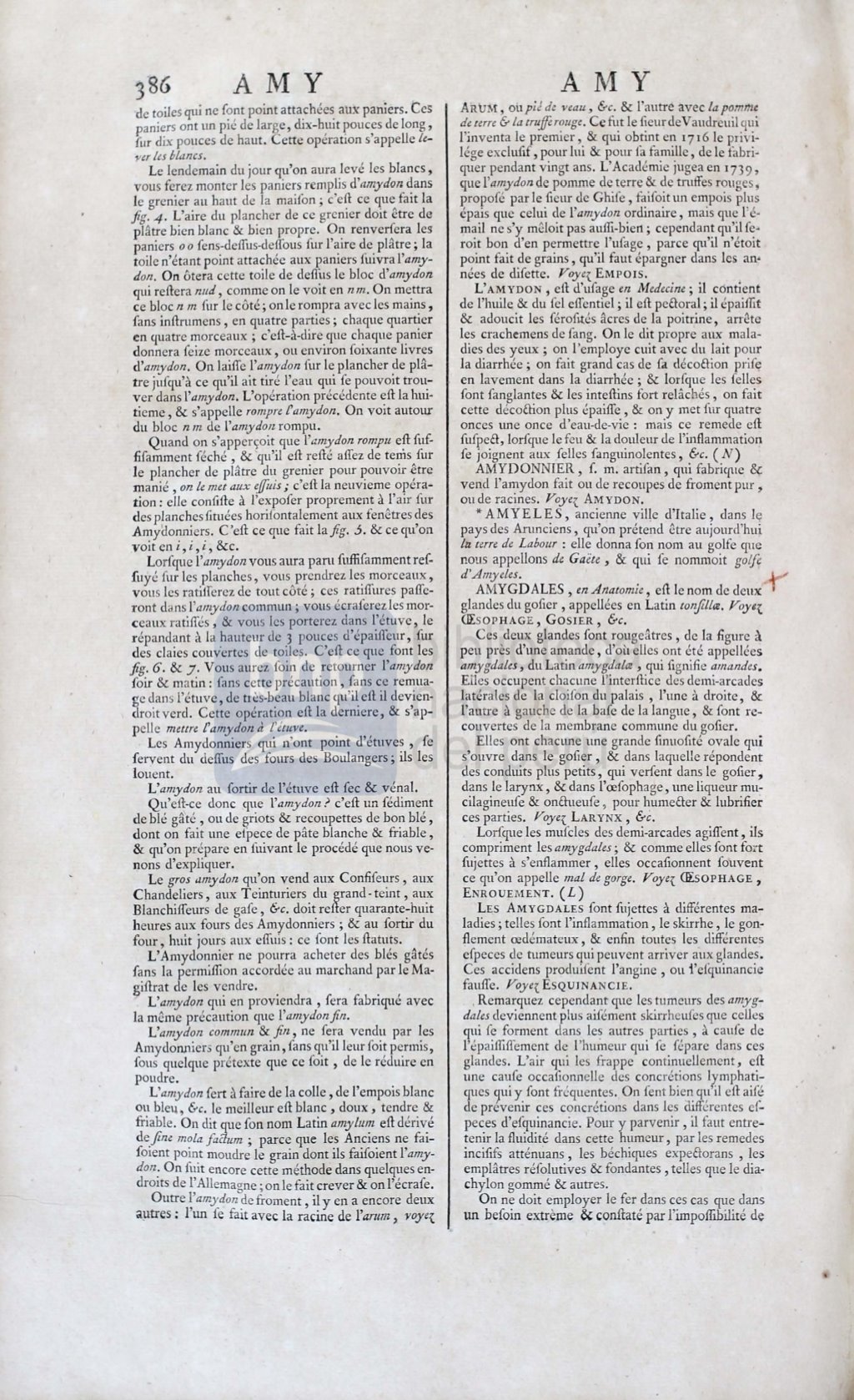
386
A M Y
de toiJesqui ne font pointattachées aux paniers. tes
paniers ont un pié de large,
dix-h~ut
pouc;s de long,
{ur dLX pouces de haut. Cette operaBon s appelle
ü –
per
les blancs.
Le lendemain du jour qu'on aura levé les blancs,
vous fcrez monter les paniers remplis
d'amydon
dans
le grenier au haut de la maifon; c'efi ce que fait la
jig.
4. L'aire du plancher de ce grenier doit etre de
platre bien blanc & bien propre. On renverfera les
paniers
oo
fens-delfus-delfous fur l'aire de pHltre ; la
toile n'étant point attachée aux paniers fuivra l'
amy–
don.
On otera cette toile de deílus le bloc d'
amydon
qlU
refiera
nad,
comme on le voit en
nm.
On mettra
ce bloc
n m
fur le coté; onle rompra avec les mains,
fans infimmens , en quatre parties; chaque quartier
en quatre morceaux ; c'efi-a-dire que chaque panier
donnera feize morccaux, ou environ foixante livres
d'amydon.
On lailfe
I'amydon
fur le plancher de pUI–
tre jufqu'a ce qu'il ait tiré l'eau qui fe pouvoit trou–
ver dans l'
amydon.
L'opération précédente efi la hui–
tieme,
&
s'appelle
rompre tamydon.
On voit autoUl"
du bloc
n m
de
l'amydoll
rompu.
Quand on s'appen;oit que
I'amydon rompa
efi fuf–
fifamment féché ,
&
qu'il efi refié alfez de tenis fur
le plancher de pHltre du grenier pour pouvoir etre
manié
on le met allX iffllis;
c'efi la neuvieme opéra–
tion: ehe confúl:e a l'expofer proprement
a
I'air fur
desplanches/ituées horifontalement aux fenetres des
AmyClonniers. C'eíl: ce que fait la
jig.
.5.
&
ce qu'on
voit en
i,i,i,
&c.
Lorfque l'
amydon
vous aura pam fuffifamment ref–
fuyé fur les planches, vous prendrez les morceaux,
vous les ratilferez de tout coté; ces ratilfures palfe–
ront dans
l'
amydolL
commun ; vous écraferez lesmor–
ceaux ratilfés , & vous les porterez dans I'étuve, le
répandant
a
la hauteur de 3 pouces d'épailfeur, fur
des claies couvertes de toiles. C'eíl: ce que font les
jig.6.
&:J.
Vous aurez foin de retourner
l'amydon
foir
&
matin : fans cette précaution, fans ce remua–
ge dans I'énlve, de tres-beau blanc qu'il efi il devien–
droitverd. Cette opération efi la derniere, & s'ap–
pelle
mettre tamydon
ti
l'üz¿ve.
Les Amydonniers C[lú n'ont point d'étuves, fe
fervent du delfus des fours des Boulangers; ils les
louent.
L'amydon
au fortir de I'étuve di fec
&
vénal.
Qu'eíl:-ce done ,que
\'amydon?
c'eíl: un fédiment
de blé ga'té , ou de
~riots
&
recoupettes de bon blé ,
dont on fait lUle etpece de pate blanche & friable,
& qu'on prépare en ftúvant le procédé que nous ve–
nons d'expliquer.
Le
gros amydon
qu'on vend aux Confifeurs , aux
Chandeliers, aux Teinturiers du grand · teinr , aux
Blanchilfeurs de gafe,
&c.
doit reíl:er qllaraote-huit
heures allX fours des Amydonniers ;
&
au fortir du
four, huit jours aux elfuis : ce font les íl:atuts.
L'Amydonnier ne pourra acheter des blés gatés
fans la permiílion accordée au marchand par le Ma–
giftrat de les vendre.
l'
amydon
C[lIÍ en proviendra , fera fabriqué avee
la meme précaution que
l'amydonjin.
L'amydon commun
&
jin,
ne fera vendu par les
Amydon¡tiers C[ll'en grain, fans C[ll'illeur foit permis,
fous quelque prétexte C[lle ce foit , de le rédUÍl"e en
poudre.
L'amydon
fert
a
faire de la colle, de I'empois blanc
ou blel!,
&c.
le meilleur eíl: blanc , doux, tendre &
friable. On dit C[lle fon nom Latin
amylllm
efidérivé
dejine
mola faélnm ;
parce que les Anciens ne fai–
fOlent point moudre le grain dont ils faifoient l'
amy–
dOIl:
On fllit encore cette méthode dans quelC[lles en–
drOlts de l'Allemagne ;on le fait crever& on l'écrafe.
Outre
!'
am)'don
,de fToment , il Yen a encore deux
a).ltres; 1
tUl
fe falt avec la racine de
l'amm, voye{
AMY
Ai1.i.JM,oilpil de vean, &c.
&
I'autre avec
/apomltU
d<terr.
&
la troffi rouge.
Ce fut le fiellrdeVaudreuil qlli
l'inventa le premier, & quí obrint en
1716
le privi–
lége excluiif, pour lui & pour
fa
famille, de le fabri–
quer pendant vingt ans. L'Académie jugea en
1739,
que l'
amydon
de pornme de terre & de truffes rouges,
propofé par le /ieur de Ghife , faifoit un empois plus
épais que ce/ui de l'
am)'don
ordinaire, mais que l'é–
mail ne s'y meloit pas auffi-bien; cepcndant C[ll'il fe–
roit bon d'en permettre I'ufage, parce C[ll'il n'étoit
point fait de grains , qu'il fam épargner dans les an'
nées de difette.
Yoye{
EMPOIS.
L'AMYDON
j
efi d'túage
en Medecine;
il cóntient
de I'huile & du fel e{[enriel ; il eíl: peéloral; il épaiflit
&
adoucit les férofLtés acres de la poitrine, an'ete
les crachemens de fango On le dit propre anx mala–
dies des yeux ; on l'employe cuit avec du lait pour
la diarrhée ; on fait grand cas de fa décoélion prife
en lavement dans la diarrhée ;
&
lorfc¡ue les felles
(ont fanplantes
&
les inteilins fort relachés, on fait
cette deco&on plus ¿pailfe , & on y met fllT quatre
onces une once d'eau-de-vie: mais ce remede eíl:
fufpeél, lorfque le feu & la douleur dI! I'inflammation
fe joignent aux felles fanguinolentes,
&c. (N)
AMYDONNIER, f. m. artifan, qui fabrique
&
vend l'amydon fait ou de recoupes de froment pur ,
oude racines.
Yoye{
AMYDON.
*AMYELES, ancienne vil!e d'Italie, dans
I~
pays des Arunciens, C[ll'on prétend etre aujourd'hui
In.
terre de Labour
:
elle donna fon nom au golfe que
nous appellons
de Gaiite ,
& qui fe nommoit
golfe
d'Amyeles.
AMYGDALES ,
en
Anatomie
,
eíl: le nom de deux
glandes du go/ier ,appellées en Latin
ton}lllI!. Yoy.{
(lESOPHAGE, GOSIER,
&c.
Ces deux glandes font rougdtres , de la figure
a
peu pres d'une amande, d'on elles ont été appellées
amygdales,
du Latin
amygdalll!
,
qui fignifie
amalldes.
Enes occupent chacune I'interilice des demi-arcades
latérales de la doifon du palais , l'une a droite,
&
l'autre
a
gallche de la bafe de la langue, & font re–
couvertes de la membrane commune du go/ier.
Elles ont chaclUle une grande finuofité ovale qui
s'ouvre dans le go/ier,
&
dans laquelle répondent
des condlúts plus petits, C[lti verfent dans le gofier,
dans le larynx,
&
dans
l'
oefophage , une liqueur mu–
cilagineufe & onélueufe , pour humeéler & lubrifier
ces parties.
Yoye{
LARYNX ,
&i:.
Lorfque les mufcles des demi-arcades agilfent, ils
compriment les
am)'gdales;
&
cornme elles font fort
fujettes
a
s'enflammer, elles oeca/ionnent fOllvent
ce qu'on appelle
lTlal degorge. Yo)'e{
(lESOPHAGE ,
ENROUEMENT.
(L)
LES AMYGDALES font fujettes a différentes ma–
ladies ; telles font l'inflammation , le skirrhe , le gon–
flement oedémateux, & ennn toutes les différentes
efpeces de nlmeurs qui peuvent arriver ailx glandes.
Ces accidens produifent I'angine, ou i'efqllinancie
faulfe.
Yoye{
ESQUINANCIE.
.Remarquez cependant C[lle les tllmeUTS des
amyg–
dales
deviennent plus aifément skirrheufes que celles
qui fe forment dans
le~
autres parries ,
a
caufe de
l'épaifTilfement de I'humeur qui fe fépare dans ces
glandes. L'air qui les frappe continuellement, eíl:
une caufe occa/ionnelle des concrétions Iymphati–
qlles 911i y font fréc¡uentes. On fent bien qll'il efi aifé
de prevenir ces concrétions dans les aifférentes ef–
peces d'efC[ltinancie. Pour y parvenir , il faut entre–
tenir la fluidité dans cette humeur, par les remedes
incififs atténuans, les béchiC[lles expeélorans , les
emplatres réfolutives
&
fondantes , telles C[lle le dia–
chylon gommé
&
autres.
On ne doit employer le fer dans ces cas que dans
un befoin extreme
&
confiaté par l'impoilibilité de
















