
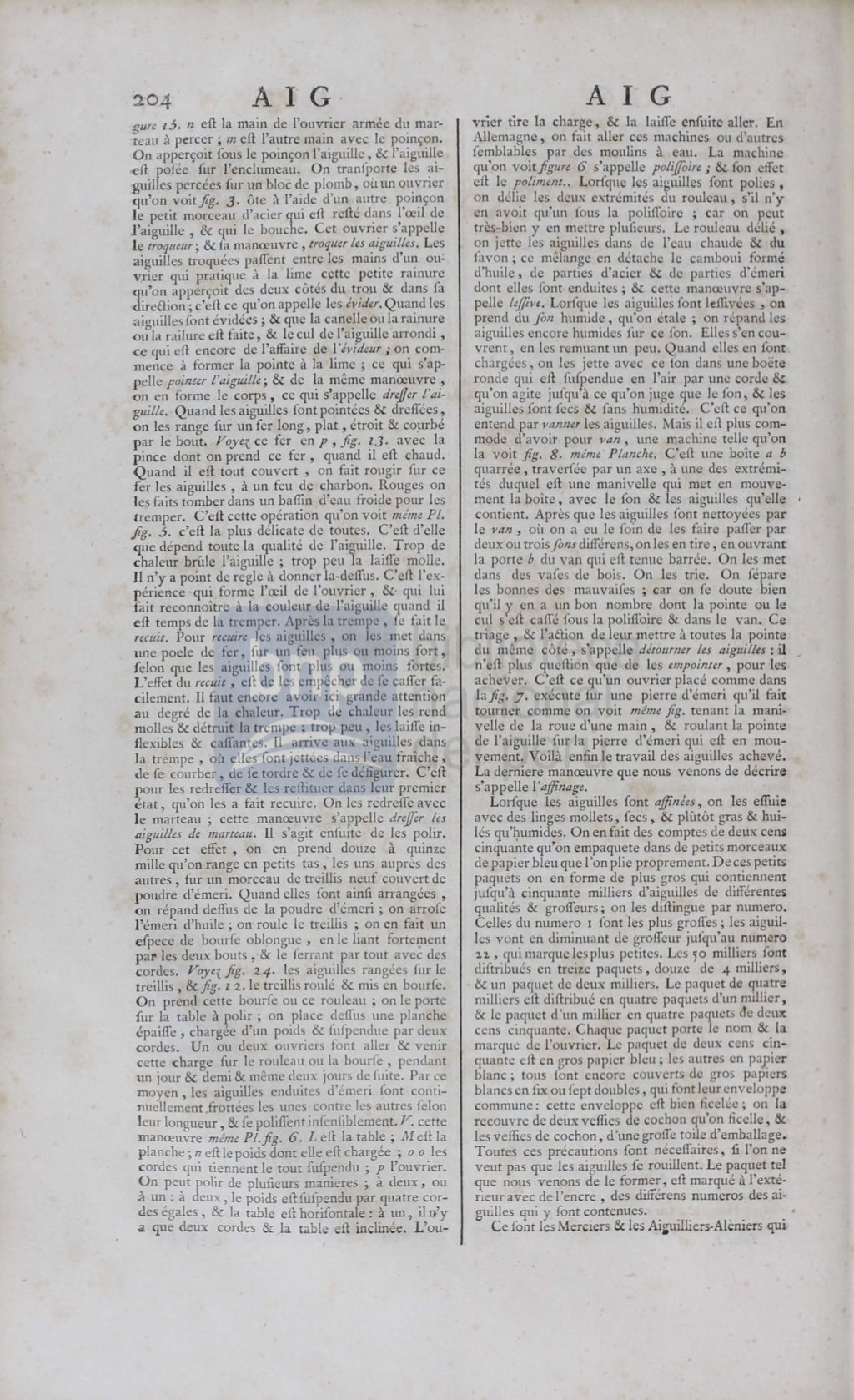
AIG
gure
d.
n
en la main de l'ol1vrier armée au mar–
teau
¡\
percer ;
m
eíl: l'al1tre main avec le poin<;on.
On apper<;oit fOl1s le poin<;on l'aiguille,
&
l'aigl1ille
-eíl: pofée fm l'enclumeau. On tranfporte les ai–
guilles percées
[w·
un bloc de plomb, Ol! un ouvrier
<¡u'on voitfig. 3. ote
a
!'aide d'un autre poin<;on
le petit mOlceau d'acier
qui
eíl reílé
d~ns
l'ceil de
l'aiguille ,
&
qw le bouche. Cet ouvner s'appelle
le
troqueur;
&
fa manceuvre ,
troquer ús
~guiLLes.
Les
aiguilles troquées paifent .entre les
ma¡¡~s
d'ul? ou–
vrier qw pratique
a
la lime cette petlte ramure
<¡u'on apper<;oit des deux cotés du
t~ou
&
dans fa
direétion; c'eíl ce qu'on appelle les
éVlder.
Quand les
aiguilles font évidées ;
&
que la canelle oula rainure
oula railme eíl faite,
&
le
cul
de I'aiguille alTondi ,
ce
qui
cíl encore de I'affaire de
l'évideur;
on com–
mence
a
former la pointe
a
la lime; ce qui s'ap–
pelle
pointer l'aiguiLLe;
&
de la meme manceuvre ,
on en forme le corps, ce qui s'appelle
drefJer l'ai–
guille.
Quand les aiguilles font pointées
&
dreifées,
on les range fur un fer long, plat , étroit
&
courbé
par le bout.
Voye{
ce fer en
p
,
fig.
13. avec la
pince dont on prend ce fer , quand
iI
eíl: chaud.
Quand
iI
eíl tout couvert , on fait rougir [m ce
fer les aiguilles ,
a
un feu de charbon. Rouges on
les faits tomber dans un baffin d'eau froide pour les
tremper. C'eft cette opération qu'on voit
mime Pl.
fig.
.s.
c'eíl: la plus delicate de toutes. C'eíl: d'elle
que dépend toute la qualité de I'ai&uille. Trop de
chaleur brole I'aignille ; trop peu la laiife molle.
n
n'y a point de regle
a
donner la-detrus. C'eíl: l'ex–
périellCe
qui
forme I'ceil de l'ouvrier,
&.
qui lui
fait reconnoltre
a
la couleur de I'aiguille quand
il
eft temps de la tremper. Apres la trempe, fe fait le
recuit.
Pour
recuire
les aiguilles , on les met dans
tUle poele de fer, [ur un feu plus ou moins fort,
felon que les aiguilles font plus ou moins fortes.
L'effet du
recuil
,
eíl de les empecher de fe caifer fa–
cilement. 11 fam encore avoir ici grande attention
au degré de la chalellf. Trop de chaleur les rend
molles
&
détruit la trempe ; trop
p.eu, les laiife in–
flexibles
&
catrantes. II arrive aux aiguilles dans
la trempe , OLl elles font jettées dans l'eau fraiche,
de fe courber, de fe tordre
&
de fe déflgurer. C'efl:
pour les redretrer
&
les reilituer dans leur premier
état, qu'on les a fait recuire. On les redretre avec
le marteau ; cette manceuvre s'appelle
drelfor les
aiguilles de martea/l.
II s'agit enfuite de
les
polir.
Pom cet effet, on en prend dome
a
quinze
mille
cru'on range en petits tas,
les
uns aupn!!s des
autres , fm un morceau de treillis neuf couvert de
poudre d'émeri. Quand elles font ainú anangées ,
on répand deifus de
la
poudre d'émeri ; on arrofe
l'émeri d'huile ; on roule le treillis ; on en fait un
efpece de bourfe oblongue, en le
liant
forteI?ent
par les deux bouts ,
&
le ferrant par tout avec des
cordes.
Voye{ fig.
24- les aiguilles rangées fur le
treiLlis,
&fig.
Z
2.letreillis roulé
&
mis en bourfe.
On prend cerre bourfe ou ce rouleau ; on le porte
[ur la table
a
polir ; on place deifus une planche
épaiife, chargee d'un poids
&
fufpendue par deux
cordes. Un ou deux ouvriers font aller
&
venir
cette charae fur le rouleau ou la boude , pendant
tUl jOllf
&
"demi
&
meme deux jours de fuite. Par ce
moyen , les aiguilles endllites d'émeri font conti–
nuellement .frottées les unes contre les autres felon
leur longuellf ,
&
fe poliifent infenfiblement.
V.
cette
manceuvre
méme PL.fig.
6.
L
eíl: la table ;
M
eíl: la
planche;
n
eíl: le poids dont elle eíl: chargée ;
o o
les
cordes qui tiennent le tout fufpendu ;
p
I'ouvrier.
On peut polir de plufiems manieres ;
a
deux, ou
a
un :
a
deux , le poids eíl: fu[pendn par quatre cor–
des égales,
&
la table eft horifontale :
a
un,
il
n'y
a que deu;'{ cordes
&
la table eíl: inclin 'e. L'ou-
AIG
vner tire la charg¡e ,
&
la laiife enfuite aller. En
AlIemagne, on fan aller ces machines on d'autres
femblables par des monlins
¡\
eau. La machine
qu'on
voitfigur~
6 s'appelle
po/iffoire;
&
fon effet
eíl: le
polimene..
Lorfque les aiguilles font polies ,
on délie les deux extrémités du roulean, s'il n'y
en avoit qu'un fous la poliffoire ; cal' on pent
tres-bien y en mettre pluúeurs. Le roulean délié ,
on jette les aiguilles dans de l'eau chaude
&
du
favon ; ce melange en détache le camboui formé
d'huile> de parties d'acier
&
de parties d'émeri
dont elles font enduites ;
&
cette manceuvre s'ap–
pelle
le.f!iv,.
Lorfque les aiguilles font leiflVées , on
prend du
fon
hunúde, qu'on étale ; on répand les
aiguilles encore humides fur ce fono Elles s'en cou–
vrent, en les remuant un peu. Quand elles en font
chargées,
011
les jette avec ce fon dans une boete
ronde qui eíl: fufpendue en l'air par une corde
&
qu'on agite jufqu'a ce qu'on juge que le fon,
&
les
aignilles [ont fecs
&
fans h'tmlÍdité. C'eíl: ce qu'on
entend par
'Vaflner
les aiguilles. Mais il eíl: plus com–
mode d'avoir pour
'Van,
lUle machine telle qu'on
la voit
fig.
8.
mime Planche.
C'eíl: une boite
a
b
qtlarrée, traverfée pat· un axe ,
a
une des extrémi–
tés duqtlel eíl: une manivelle qui met en mOllve–
ment
la
bOlte, avec
le
fon
&
les
aiguilles qu'elle '
contient. Apres que les aiguilles [ont nettoyées par
le 'Van,
ol! on a eu le {oin de
les
faire paifer par
deux ou trois
follS
différens,
onles
en tire, en ollvrant
la porte
b
du van qtti eíl: tenue barrée. On
les
met
dans des vafes de bois. On
les
trie. On fépare
les bonnes des mallvaifes ; car on fe doute bien
qu'ill en a un bon nombre dont la pointe ou
le
cul s eíl: caifé fous la politroire
&
dans le van. Ce
u-iage ,
&
l'aaion de leur mettl'e a toutes la pointe
du mcme coté, s'appelle
délOumer les aiguilles
:
il
n'eíl: plus queilion que de
les efllpointer ,
pOllf les
achever. C'eíl: ce qu'un ouvrier placé comme dans
lafig. .7. exécute ÍLlf W1e pierre d'émeri
qll'il
fait
tourner comme on voit
méme fig.
tenant la mani–
velle de
la
roue d'une mam,
&
roulant la pointe
de l'aiguille {¡lf la pierre d'émeri qui eíl en mou–
vement. Voila enfin le travail des aiguilles achevé.
La derniere manceuvre qtle nous venons de décrire
s'appeLle
l'affinage.
Lorfc¡ue
les
aiguilles font
affiflées,
on les etruie
avec des linges mollets, fecs,
&
pllltot gras
&
hlli–
l~s
qtl'l¡lllmides. On en fait des comptes de deux ceni
cmquante qtl'on empaquete dans de petits morceallx
de papier
bleu
que
1
'on plie proprement. De ces petits
paquets on en forme de plus gros qui contiennent
jllfqtl'a cinquante milliers d'aiguilles de différentes
qualités
&
grotreurs; on les diíl:ingue par numero.
Celles du numero
1
font les plus grotres ; les aiguil–
les vont en diminuant de grotreur jufqu'au numero
21. ,
qui marque les plus petites. Les 50 milliers font
diftribués en treize paquets, douze de 4 milliers ,
&
un paquet de deux miLliers. Le paquet de qtlatre
milliers eíl: diíl:ribué en quatre paquets d'un millier,
&
le paquet d'un millier en quatre paqtlets de denJe
cens cinquante. Chaque paquet porte le nom
&
la
marque de l'ouvrier. Le paquet de deux cens cin–
quante eíl: en gros papier bleu ; les autres en papier
blanc; tollS [ont encore couverts de gros papiers
blancs en fIX ou fept doubles , qtli font leurenveloppe
commune: cette enveloppe eíl: bien flcelée; on la
recouvre de delIX veffies de cochon qu'on flcelle,
&
les veffies de cochon, d 'une groife toile d'emballage.
Toutes ces précautions font nécetraires, ú 1'0n ne
veut pas que les aiguilles fe rouillent. Le paquet tel
que nous venons de le former, ea marqué
a
l'exté–
rieur avec de l'encre , des différens numeros des ai–
guilles qtti y font contenues.
Ce [ont les Mer iers
&
les Ai¡1.1illiers-Aleniers
qui
















