
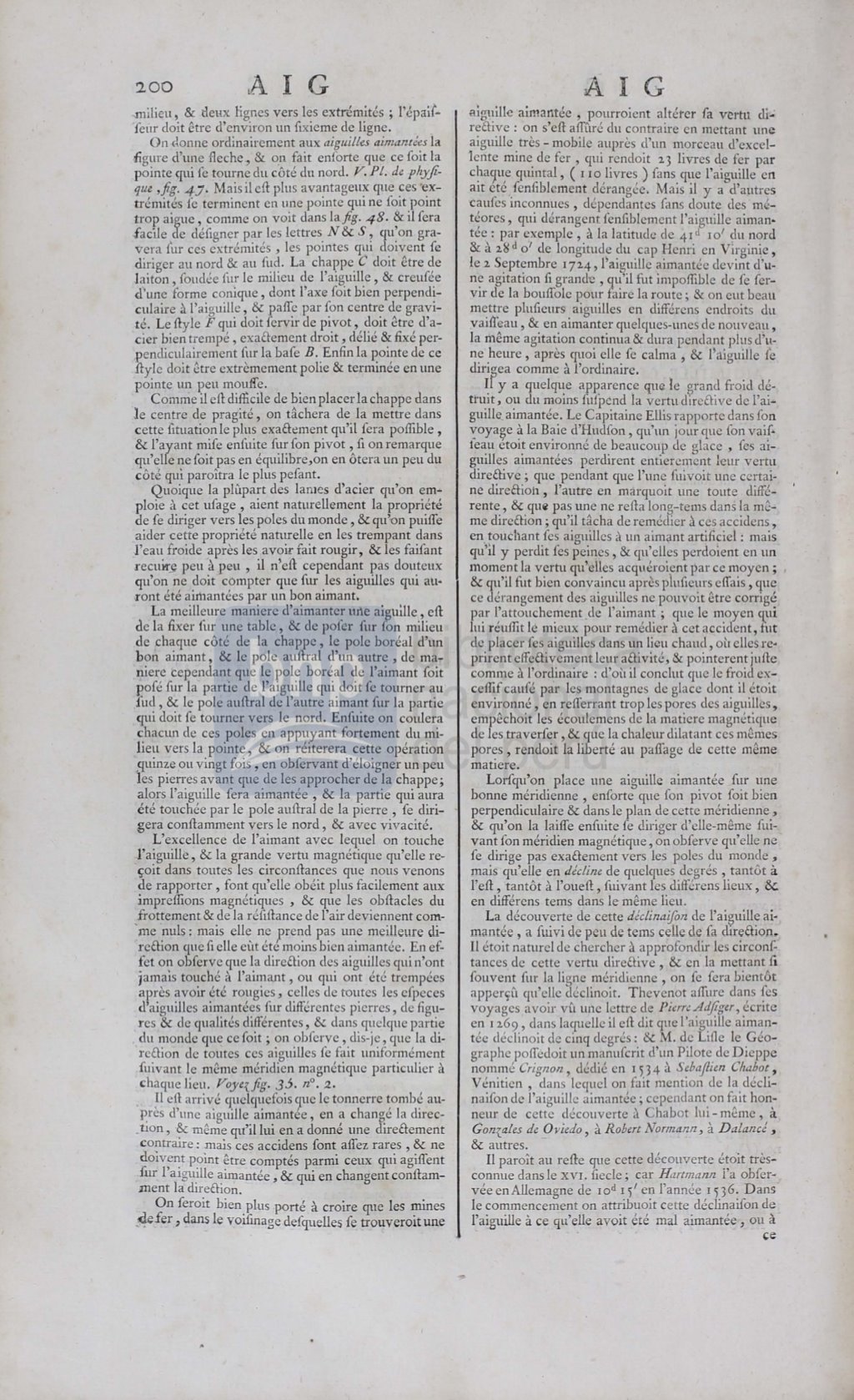
200
A IG
..rnilieu,
&
cleux lignes vers les extremités ; l'épaiC–
[em doit etre d'environ un /ixieme de ligne.
On (¡onne ordinairement aux
aiguilles aimantées
la
Jigure d'une fleche,
&
on fair enforte que ce [oir la
pointe qui fe toume du coté dn nord.
V.
Pl. de
p"yji–
que
,fg.
4.7. Mais il eíl: plus avantagell:' que
~es '~x
trémités
ú:
terminent en une pointe qUl ne [Olt pomt
trop aigue, comme on voit dans lafig·
48.
&
il fera
.facile de dé/igner par les lettres
N
&
S,
'fu'on gra–
vera (m ces extrémités , les pointes qui doivent fe
diriger au
n~rd
&
au
(~~.
La ch,appe
C
doit etre
~e
laiton {oudee {ur le miheu de I algUllle ,
&
creu{ee
¿' une forme conique , dont I'axe {oit bien perpendi–
culaire
a
l'ai"uille,
&
paíl"e par Con centre de gr-avi–
t~. L~
íl:yle
F
~i
doit {ervir de pi.vot "
~~it
etre, d'a–
Cler bIen trempe , exaél:ement drOlt, dehe
&
nxe per–
pendiculairement {ur la ba{e
B.
Enlin la pointe de ce
.íl:yle doit @tre extremement polie
&
terminée en une
pointe tm peu moutfe.
Comme iI eíl: dilllcile de bien placer la chappe dans
l e centre de pragité , on tachera de la mettre dans
cette /ituationle plus exaél:ement qu'il {era po/lible,
&
l'ayant
mire
enCuite
(ur
ron pivot ,
fi
on remarque
qu'elle ne (oit pas en équilibre,on en otera un peu du
coté qUl paroitra le plus pefant.
Quoique la plapart des lames d'acier 'fu'on em–
ploie
a
cet ufage , aient naturellement la propriété
de (e d1.riger vers les poles du monde,
&
'fu''On puiíl"e
aider cette propriété natmelle en les trempant dans
l'eau troide apres les avoic fait rougir,
&
les fallant
recuYrj; peu
a
peu , iI n'eíl: cependant pas douteux
qu'on ne doit compter que {m les aiguilles qui au–
-ront été aimantées par un bon aimant.
La meilleure maniere d'aimanter ttne aiguille, eíl:
de la nxer fur une table,
&
de po(er {ur ron milieu
de chaque coté de la chappe , le pole boréal d'un
bon aimant,
&
le pole auil:ral d'un autre , de ma–
niere cependant que le pole boréal de l'aimant {oit
pofé {m la partie ele I'aiguille qui doit fe toumer au
{ud,
&
le pole auíl:ral de l'autre aimant ftu la partie
'fui do1.t {e tomner vers le nord. En(uite on cculera
chacun de ces poles en appuyant fortement du
rni–
lieu vers la pointe,
&
on réiterera cette opération
,quinze ouvingt fois, en ob[ervant d'éloigner un peu
les pienes avant que de les approcher de la chappe;
alors l'aiguille {era aimantée ,
&
la partie qui aura
été touchée par le poIe auil:ral de la pien'e , {e diri–
gera coníl:amment vers le nord ,
&
avec vivacité.
L'excellence de I'aimant avec leque! on touche
l'aiguille,
&
la grande vertu magnéti'fue 'fu'elle re–
~oit
dans toutes les circonil:ances que nous venons
de rapporter, font qu'elle obéit plus facilement aux
impreffions magnétiques ,
&
que les obíl:acles elu
frottement
&
de la réCtíl:ance de l'air deviennent com–
'me nuls : mais elle ne ,rrend pas une meilleure di–
reél:ion que /i elle eút éte moins bien aimantée. En ef–
fet on obferve que la direél:ion des aiguilles qui n'ont
jamais touché
11
I'aimant,
01.1
qui ont été trempées
apres avoir été rougies, celles de tQutes les e{peces
d'aiguilles aimantées {ur différentes pien'es, de figu–
res
&
de qualités différentes,
&
dans que!'fue partie
du monde que ce{oit ; on ob[erve, dis-je, que la di–
reél:ion ele tomes ces aiguilles fe fait uniformément
fuivant le meme méridien magnétique particulier
11
chaque lieu.
Voye{fg.
3.5.
nO.
2.
Il
eíl: arrivé c¡uelc¡uefois 'Fe le tonnerre tombé au–
~res
el'une aigtúlle aimantee, en a changé la direc-
11on,
I?'
meme qn'illui en a donné une direél:ement
contraue: mais ces accidens {ont aíl"ez rares ,
&
ne
doive~t
P?int erre comptés parmi ceux c¡ui agiíIent
fiu
¡'algu~lle
aimantée,
&
qui en changent conftam–
ment la direél:ion.
On feroit bien plus porté
a
croire que les mines
~defer
, dans
le
voi/inage de{quelIes [e trouveroit une
AIG
aiguüle aimantée , pomroient altéter fa vertu
di–
reél:ive : on s'eíl: a/Ulré du contraire en mettant une
aiguille tres - mobile aupres d'un morceau d'excel–
lente mine de fer , c¡ui rendoit
2.3
livres de fer par
cha9ue qlúntal, (
110
livres ) fans c¡ue l'aiguille en
ait eté fen/iblement elérangée. Mais il y a d'autres
caufes inconnues , dépendantes fans doute des mé–
téores, 'fui dérangent fenftblement I'aiguille aiman–
tée: par exemple,
a
la latinlde ele
41d lO'
du nord
&
a
2.8
d
o' de longitude elu cap Henri en Virginie,
le
2.
Septembre
1724,
I'aiguille aimantée devint d'u–
ne agitation /i grande , qu'iI nlt impoffible de [e [er–
vir ele la bouíl"ole pour faire la route;
&
on eut beau
mettre plu/ieurs aiguilles en différens endroits du
vaiíreau,
&
en aimanter quelques-unes de nouveau,
la
m~me
agitation continua
&
dura pendant plus d'u–
ne heure, apres quoi elle [e calma,
&
I'aiguille (e
diriaea comme
11
l'ordinaire.
Ir
y a quelque apparence que le grand froid dé–
truit, ou du moins (ufpend la vertu
d
lreél:ive de I'ai.
guille aimantée. Le Capitaine Ellis rapporte dans fon
voya~e
a
la Baie d'Hudfon, qu'un jour que {on vaif·
feau etoit envirolmé de beaucoup de glace , {es ai–
gtti![es aimantées perdirent entierement Icur vertu
direél:ive; que penelant que l'une {uivoit une ccrtai–
ne direél:ioh, I'autre en marc¡uoit une toute diffé–
rente,
&
quO! pas tU1e ne reíl:a long-tems dans la me–
me direél:ion ; c¡u'iI tacha de remédier
11
ces accielens,
en
touchant {es aiguillcs aun aimant artificie1 : mais
qL;'il y perdit {es peines,
&
qu'elles perdoient en un
moment la vertu c¡u'elles acquéroient par ce moyen;
&
c¡u'iI nlt bien convaincu apres pluCtems e{fais ,que
ce dérangement des aiguilles ne pouvoit etre conigé
par I
'attouchement.deI'aimant; c¡ue le moyen c¡ui
lui réuffit le mieux pour reméelier
11
cet accident, fut
de placer fes aiguilles dans un lieu chaud,
011
elles re·
prirent effeél:ivement leur aél:ivité,
&
pointerent juil:e
comme
a
l'ordinaire : d'oll il conclut c¡ue le froid ex–
ceilifcaufé par les montagnes de glace dont il étoit
environné, en reíl"errant trop les pores des aiguilles,
empechoit les écoulemens de la matiere magnétic¡ue
de les traverfer
,&
c¡ue la chaleur dilatant ces memes
pores , rendoit la liberté au paíl"age de cette
m~me
matiere.
LOI{c¡u'on place une aigtúlle aimantée fur une
bonne méridienne , enforte que Con pivot foit bien
perpeneliculaire
&
dans le plan de cette méridienne ,
&
qu'on la lai1fe enCuite {e diriger
d'clle-m~me
fui–
vant (on méridien magnétique, on ob(erve qu'elle ne
[e dirige pas exaél:ement vers les poles du monde,
mais qu'eUe en
décline
de c¡uelques degrés , tantot
a
I'eil: , tantot
11
l'oueíl:, fuivant les différens lieux,
&
en différcns tems dans le meme lieu.
La découverte de cette
déclinaifon
ele l'aiguille ai·
mantée, a ftúvi de peu ele tems celle de {a direél:ion.
Il
étoit naturel de chercher
a
approfonelir les circonf–
tances de cette vertu direél
:1.ve,
&
en la mettant
íi
[ouvent fur la ligne méridienne , on {e fera bientot
appeflrll c¡u'elle déclinoit. Thevenot aíl"me dans {es
voyages avoir vll une lettre de
Pierr~A4figer,
écrite
en
12.69,
elans lac¡uelle il eíl: dit que l'aiguille aiman–
tée déclinoit de cinc¡ elegrés:
&
M.
de Li{]e le Géo–
graphe poíl"edoit un manu{crit d'un Pilote de Dieppe
nommé
Crignon,
dédié en
1534
a
Sebaflien C/ulbot,
Vénitien, dans lequel on fait mention de la décli–
nai{on de l'aiguille airnantée ; cependant on fait hon–
neur de cette découverte
a
Chabot lui-meme,
a
Gontales de Oviedo,
a
Robert Normann,
a
Dalancé,
&
autres.
Il
paroit au reíl:e c¡ue cette découverte étoit tres–
connue dans le
XVI.
/iecle; car
Harlrnann
i'a
obfer–
vée en AlIemagne de
IO d
15'
en I'année
1536.
Dans
le cornmencement on attribuoit cette déclinaifon de
I'aiguille
a
ce c¡u'elle avoit été mal aimantée ,
01.1
a
ce
















