
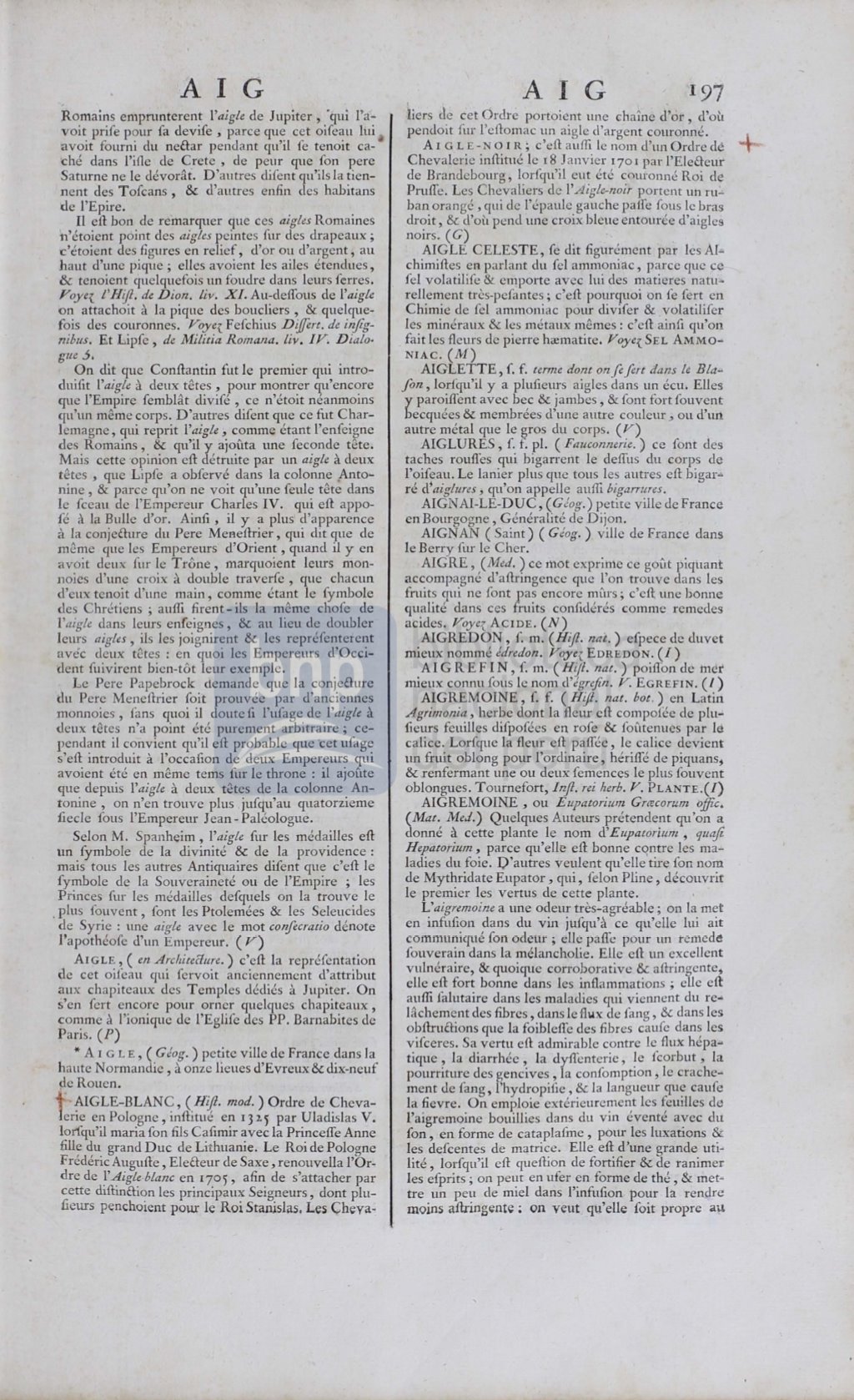
AIG
Romains empmnterent
I'aigle
de Jupiter, 'qui I'a–
voit prife pour [a devi[e > paree que cet oi[ean !tú
avoit fourni du nefrar pendant qu'il [e tenoit ca- •
ché dans I'i{le de C.rete, de peur que [on pere
Sahlrne ne le dévodit. D 'autres cü[ent qu'ilsla tien–
nent des To[cans, & d'autres enfin des habitans
de l'Epire.
n
eíl: bon de remarquer que ces
nigles
Romaines
n'étoient point des
aigles
peintes [ur des drapeaux;
c'étoient des figures en relief, d'or ou d'argent, au
haut d'une pique; elles avoient les ailes étendues,
&
tenoient quelquefois un foudre dans leurs [erres.
roye{ I'Hifl. de D ion. tiv. Xl.
Au-de{[ous de
l'aigle
on attachoit
a
la pique des boucliers ,
&
quelque–
fois des couronnes.
Vl.!Ye{
Fe[chius
Di/fert. de infig–
nihlls.
Et Lipfe, de
Militia Romana. liv.
IV.
Dialo·
gue
.5.
On dit que Confiantin fut le premier qui intro–
dnifit
l'aigle
a
denx tetes, pour montrcr Cfl'encore
que l'Empire [emblat cüvi[é , ce n'étoit neanmoins
qu'un meme corps. D'autres difent que ce nlt Char–
lemagne, qui reprit
I'aigle>
comme étant
I'en[ei~ne
des Romains, & ql.1'il Y ajolha une [econde tete.
Mais cette opiruon eíl: détmite par un
aigle
a
deux
tetes> que Lip[e a ob[ervé dans la colonne .Anto–
nine,
&
parce qu'on ne voit qu'une [eule tete dans
le [ceau de l'Empereur Charles IV. qui eíl: appo–
fé
a
la Bulle d'or. Ainfi, il Y a plus d'apparence
a
la conjefrure du Pere MeAefl:rier, qui eht que de
meme que les Empereurs d'Orient, quand il y en
avoit deux
[tu'
le Trone, marquoient leurs mon–
l10ies d'une croix
a
double traverfe, que chacun
d'eux tenoit d'une main, comme étant le [ymbole
des Chrétiens ; auffi firent-ils la meme chofe de
I'lLigle
dans leurs enfeignes, & au lieu de doubler
leurs
nigles,
ils les joignirent & les repré[enterent
Ilvéc deux tetes : en quoi les Empereurs d'Occi–
dent [uivirent bien-tot leur exemple.
Le Pere Papebrock demande que la conjefrure
du Pere Meneí!:rier [oit prouvée par d'anciennes
monnoies , fans quoi il donte fi l'u[age de
I'aigle
a
deux tetes n'a point été purement arbitraire; ce–
pendant il convient qu'il eí!: probable que cet u[age
s'eí!: introduit
a
l'occafion de deux Empereurs qui
avoient été en meme tems [ur le throne : il ajollte
que depuis
l'aigle
a
deux
t~tes
de la colonne An–
torune, on n'en trouve plus jufqu'au quatorúeme
íiecle fous l'Empereur Jean - Paléologue.
Selon M. Spanheim,
l'aigle
fur les médailles eí!:
un fymbole de la divinité & de la providence:
mais tous les autres Antiquaires difent que c'eí!: le
fymbole de la Souveraineté ou de l'Empire ; les
Princes [ur les médailles de[quels on la trouve le
.plus [ouvent, [ont les Ptolemées
&
les Seleucides
de Syrie : une
aigle
avec le mot
eonfeeratio
dénote
l'apothéo[e d'un Empereur.
(V)
AIGLE, (
en Are/'iteélure.)
c'eí!: la repré[entation
de cet oi!eau (Jui [ervoit anciennement d'attribut
aux chapiteaux des Temples dédiés
a
Jupiter. On
s'en [ert encore pour erner quelques chapiteal.1x,
comme
a
I'ionique de l'Egli[e des PP. Barnabites de
París.
(P)
*
A
1
GLE, (
Géog.
)
petite ville de France dans la
haute Normancüe ,
a
onze lieues d'Evreux & cüx-neuf
de Rouen.
t
AIGLE-BLANC,
(Hifl· modo
)
Ordre de Cheva–
erie en Pologne, infutué en 132.5 par Uladislas V.
lorfqu'il maria ron fils Cafimir avec la Prince{[e Anne
filie du grand Duc de Lithuarue. Le Roi de PoloO'ne
Frédéric Auguí!:e , Elefreur de Saxe, renouvella l'Or–
dre de
.l'",!igle Mane
en 1705, afin de s'attacher par
cette dlíl:mfrion les principaux Seigneurs, dont plu–
fieurs penchoient pour le Roi Stanislas. Les Cheya-
A I
G
197
iiers de cet Ordre portoiént une chalne d'or, d.'oll
pendoit fur I'eí!:omac un aiglc d'argent couronné.
Al
G
LE -N
01
R; c'eíl: auffi le nom d'un Ordre dé
Chevalerie iní!:itué le 18 Jallvier 1701 par l'Elefreur
de Brandebourg, lor[c¡u'il eut été cOt!ronné Roi de
Pm{[e. Les Chevaliers de
l'Aigle-noir
portent un m –
han orangé >c¡ui de l'épaule gauche paífe [ous le bras
droit, & el'Oll pend une croix bleue entourée d'aigles
noirs.
(G)
AIGLE CELESTE, [e dit figurément par les
Al–
chirnií!:es en parlant du [el amll1oniac, parce que ce
[el volatili[e
&
emporte avec luí eles matieres natu–
rellemem tres-pe[antes; c'eí!: pomquoi on [e [ert en
Chimie de [el ammoniac pour cüvi[er
&
volatilifer
les minéraux & les métaux memes : c'eí!: ainfi qu'on
fait les f1ems de pierre ha::matite.
Yoye{
SEL AMMO–
NIAC.
(M)
AIGLETTE,
f.
f.
terme dont onfl flrt dans
le
Bla..
Ion,
loríqu'il y a plufieurs aigles dans un écu. Elles
y paroiírent avec bec & jambes,
&
[om fon [ouvent
becquées & membrées d'une autre couleur, Oll d'un
autre métal que le gros du corps.
(Y)
AIGLURES,
f.
f.
pI.
(Faueonnerie.)
ce [ont des
taches rou{les qui bigarrent le de{[us du corps de
l'oi[eau. Le lanier plus que tous les autres eí!: bigar–
ré
ellaiglllres>
qu'on appelle auffi
bigarrllres.
AIGNAI-LE-DUC,
(G.!og.)
petite viUe deFrance
en Bourgogne, GénéTabté de Dijon.
ArGNAN ( Saint) (
Géog.
)
ville de France dans
le Berry
[tU'
le Cher.
ArGRE,
(Med.)
ce mot e>-llrime ce goút piqllant
accompagné d'aíl:ringence que I'on trouve dans les
fmits qui ne [ont ras encore mllrs; c'eí!: une bonne
qualité dans ces fmits confidérés comme remedes
acídes.
Voye{
ACIDE.
(N)
AIGREDON,
f.
m.
(Hifl. nat.)
e[pece de duvet
mieux nommé
édredon. Voye{
EDREDON.
(1)
Al G R E FIN, f. m.
(Hifl. nato
)
poi{[on de
tnér
mieux connu [ous le nom
d'égrefin.
V.
EGREFIN.
(J)
AIGREMOINE,
f.
f.
(Hifl. nato hot. )
eh Latin
Agrimonia,
herbe dont la fleur eí!: compoíee de plu–
fieurs feuilles di[po[ées en rore & [olltenues par le
calíce. Lorfc¡ue la f1eur eí!: pa{[ée, le calice devient
un fmit oblong pour I'orcünaire, hériíré de piquans,
& .renfermant une
Ol!
deux [emences le plus [ouvent
oblongues. T ournefort,
Infl.
rei herh. Y.
PLANTE.(I)
AIGREMOlNE,ou
Eupatoriltlll Grtlieorum
iJffic.
(Mat. Med.)
Quelques Auteurs prétendent qu'on a
donné
a
cette plante le nom
d'Ellpatorium , <Jllrifi
HepatoriwTl>
parce qu'elle eí!: bonne cqntre les ma–
ladies du foie. 1)'atmes "eulent qu'elle tire ron
110m
de Mythrídate Eupator >qui, [elon Pline, découvrit
le premier les vertus de cette plante.
L'aigremoine
a une odeur tres-agréable; on la met
en infufion dans du vin ju[qu'a ce c¡n'elle ltú ait
communiqué ron odeur ; elle pa{[e pour un remede
[ouverain dans la mélancholie. Elle eí!: un excellent
vulnéraire,
&
quoique corroborative &
aíl:rin~.ente;
elle eí!: fort bonne dans les inflammations ; elle eft
auffi [alutaire dans les maladies qui viennent du re"
lachement des fibres, danslefllolx de [ang, & dans les
obfuuilions que la foible{[e des fibres cau[e dans les
vi[ceres. Sa vertu eí!: admirable contre le flux hépa"
tique, la diarrhée, la dy{[enterie, le [corbut > la
pourriture des nencives , la con[omption, le crache–
mem de [ang,
1
hydropifie, & la Iangueur que cau[e
la fievre. On empIoie extérieurement les fetúlles de
l'aigremoine bouillies dans du vin éventé avec du
[on, en forme de catapla[me, pomo les llL"\,:ations
&
les de[centes de matrice. Elle eí!: d'une grande tlti·
lité, lor[qu'il eí!: queilion de fortifier & de ranimer
les e[prits ; on peut en ufer en forme de thé ,
&
met–
tre un peu ele miel dans l'inndion pour la rendTe
moins aíb-ingente; on veut qu'elle [oit propre au
















