
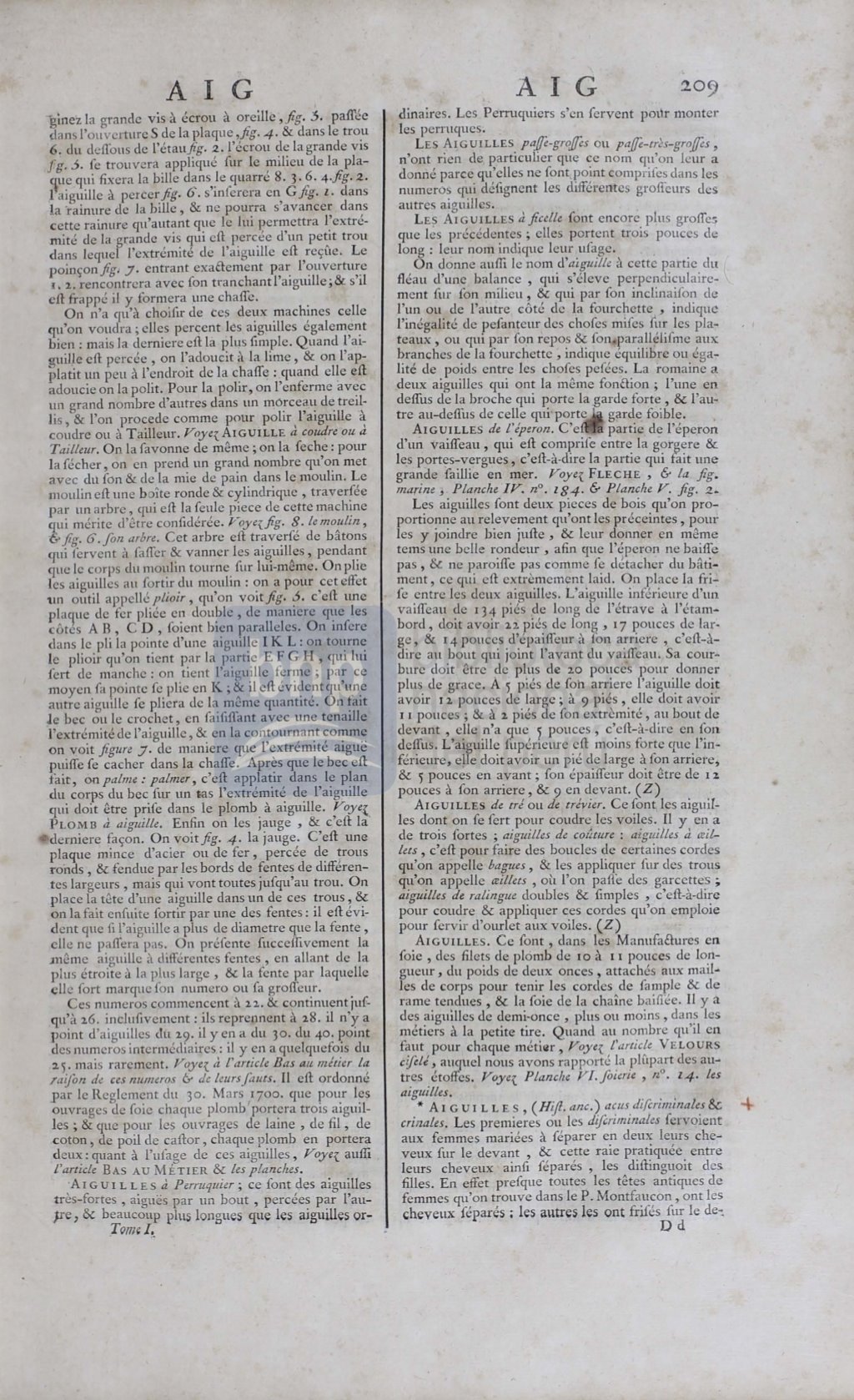
AIG
ginez la grande vis
a
écrou
a
oreille
,fig.
.7.
pa1rée
dans I'ouvcrture
S
de la plaque
,fig·
4.
& dans le trou
6. du dellous de
l'étaufig.
2.1'écrou de la grande vis
Jlg.
J.
fe trouvera appliqué fur le milieu de la pla–
~u~ q~lÍ
fL'(era la bille dans}e quarré
8. 3· 6.
4·fig.
2.
1
algllllle
a
percer
jig.
6.
s m(erera en
G
fig.
l.
dans
la 'rainure de la bille, & ne pourra s'avancer dans
cette rainure qu'autant que le lui pemlettra l'extré–
mité de la grande vis c¡.ui cíl: percée d'un petit trou
dans lequel I'extrémite de I'aiguille e1l res:CIe. Le
poins:onjig,
.7.
entrant exaé.l:ement par I'ouverture
I.
2.
rencontrera avec (on tranchantl'aiguille;& s'il
eft frappé il y formera une chalfe.
On n'a qu'a choi(rr de tes deux machines cdle
(Iu'on voudra ; elles percent les aiguilles également
bien: mais la derniere eíl: la plus íimple. Quand I'ai–
guille eíl: percée , on l'adoucit a la lime, & on l'ap–
platit un peu
¡\
I'endroit de la chalfe : quand elle eíl:
adoucie on la polit. Pour la polir, on l'enferme avec
un grand nombre d'autres dans un mórceau de treil–
lis, & l'on procede comme pour polir l'aiguille a
condre ou
¡\
Tailleur.
Voye{
AIGUILLE
a
coudre ou
a
Tailleur.
On la (avonne de meme; on la feche: pour
la [écher, on en prend un grand nombre qu'on met
avec da ron & de la mie de pain dans le moulin. Le
moulin eíl: une bOlte ronde & cylindrique , traverfée
par un arbre, qui eíl: la [eule piece de cette machine
<¡ui mérite d'erre coníidérée.
Voye{fig.
8.
le moulin,
&
jig. 6.fon "rbre.
Cet arbre eíl: traver(é de batons
'lui (ervent a falfer & vanner les aiguilles, pendant
que le corps du moulin tourne fur lui-meme. On plie
les aiguilles au [ortir du moulin : on a pour cet €lfet
1.1n outil
appelléplioir,
qu'on
voitfig.
6.
c'eíl: un€
placlue de fer pliée en double, de maniere que les
cotes A
B,
C
D ,
(oient bien paralle!es. On in(ere
dans le pli la pointe d'une aiguille
1K
L : on tourne
le plioir qu'on tient par la partie E F G H , qui lui
{ert de manche: on tient l'aiguille ferme; par ce
moyen fa pointe fe plie en
K;
& il eíl:évidentqu'une
autre aiguille [e pliera de la meme quantité. On fait
Je bec oule crochet, en (aifúfant avec une tenaille
l'extrémité de l'aiguille, & en la contournant comme
on voit
figure
.7.
de maniere que l'extrémité aigue
puiífe (e caeher dans la chalfe. Apres que le bec eíl:
fait,
oopalme: palmer,
c'eft applatir dans le plan
du corps du bec fur un
~as
I'extrémité de l'aiguille
qui doit etre prife dans le plomb
a
aiguille.
Voyei
PLOMB
a
"iguille.
Enfin on les jauge , & c'eft la
derniere fas:on. On
voitfig.
4.
la jauge. C'eíl: une
plaque mince d'aejer ou de fer, percée de trous
ronds ,
&
fendue par les bords de fentes de
dilf~ren
tes largeurs , mais qui vont toures jufqu'au trou.
011
place la t&te d'une aiguille d<lns un de ces trous,
&
on la fait enCuite forrir par une des fentes: il eíl: évi–
dent que íi I'aiguille a plus de diametre que la fente ,
elle ne palfera paso On préfente [ucceffivement la
l11eme aiguille
a
différentes fentes , en allant de la
plus étroite
a
la plus large,
&
la fente par laquelle
elle fort marque ron numero Otl [a grolfeur.
Ces numeros commencent
a
22.
& continuentjuf.
qu'a
26.
incluíivement: ils reprennent
a
28.
il n'ya
point d'aiguilles du
2?
il yen a du 30. du 40. point
des numeros intermédlaires : il yen a qllelquefois du
25.
mais rarement.
Vcry-e{.i ['artide Bas au métier la
raifon
d~
ces nllfntros
&
de
leursfauts.
1I
eíl: ordonné
par le Reglement du
3
o. Mars
1700.
que pour les
ouvrages de foie chaque plomb'portera trois aiguil–
les; & que pour les ouvrages de laine
>
de fil, de
coton , de poil de caíl:or, chaque plomb en portera
deux: quant a l'ufage de ces aiguilles ,
Vcry-e{
auiIi
['anide
BAS AU
MÉTIER
&
les planches.
Al GU
1
LLES
a
Perruqllier;
ce [ont des aiguilles
tres-fortes , aigues par un bout , percées par I'au–
¡re,
&
beaucoup plus longues que les ¡¡iguilles or–
TQ¡¡¡,¡•.
AIG
dinaires. Les Permqlúers s'en [ervent potlr montel'
les penllques.
, LES
~IGUILLES.
pa.ffe-groffis
ou
paj{e-tr¿s-groj{es,
n
O)1t nen ele. partJcuher que ce nom qu'on leur a
dOllné parce qu'elles ne font.point compriCes d<lns les
numeros qui déíignent les dilférentes grolfeurs des
atltre aiguill€s.
LES Al GUILLES
dficelle
[Ol1t encore plus gl'olfe:¡
que les précédentes; elles portent trois pouces de
long: leur nom indique leur u[age.
On donne auffi lenom
d'aiguille
a cette partie du
f1éau d'une balance, qlÚ s'éleve perpendiculaire–
ment fm ron milieu,
&
qui par ron inclinai[on de
I'un Ol! de l'autre coté de la fourchette , indique
l'inégalité ele pe[anteur des cho[es mires
[m
les pla–
teaux,ou qui par fon repos
&
[on.paralléli[me aux
branches de la fourchette
>
indique équilibre ou éga–
lité de poids entre les chofes pe(ées. La romaine
a
deux aiguilles qui ont la meme fonaion; l'tme en
def[us de la broche qui porte la ,garde forte ,
&
I'au-
tre au-deíltls de celle quí porte garde foible.
AIGUILLES
de L'éperon.
C'e
partie de l'éperon
d'un vaiífeau, qui eíl: compri(e entre la gorgere
&
les portes-vergues, e'eíl:-a·dire la partie qui fait une
grande faillie en mer.
Voye{
FLECHE,
&
la jig.
marine> Planche IV. nO.
z84.
&
Planche V. fig.
2.
Les aiguilles [ont deux pieces de bois qu'on pro–
portionne au relevement qu'ont les préceintes , pour
les y joindre bien juíl:e
>
&
leur donner en meme
tems une belIe rondeur
>
afin que l'éperon ne bailfe
pas ,
&
ne paroilfe pas comme fe elétacher du
bati–
ment, ce 'Lui eíl: extremement laidoOn place la fri–
fe entre les deux aiguilles. L'aiguille inférieure d'un
vailfeau de 134 piés de long de l'éu'ave
a
I'étam–
bord, doit avoir
21.
piés de long,
17
pouces de lar–
ge, &
14
pOllces d'épailfeur a ron arriere , c'eíl:-a–
dire au bout quí joint l'avant du vailfeau. Sa cour–
bure doit etre
~e
plus de
20
pouees pour donner
plus de grace. A
5
piés de foh arriere I'aiguille doit
avoir
12
pouces de large;
a
9
piés , elle doit avoir
11
pOllces ; & a
2
piés de (on eJo..'tremité, au bout de
devant , elle n'a que
5
pouces, e'eíl:-a-dire en fon
delfus. L'aiguille fupérieme eíl: moins fOrte eme I'in–
férieure, e)le doit avoir un pié ele large
a
fon
~rriere,
&
5
pouces en avant; fon épailfeur doit
~tre
de
12
pouces
a
fon arriere,
&
9
en devant.
(Z)
AIGUILLES
de tré
ou
de trévier.
Ce
[on~
les
ai!rrlir–
les dont on (e [ert pour coudre les voiles.
Il
y
~n
a
de trois fortes ;
aigllilles de coucure
:
aiguilles
a
teil–
lees,
c'eíl: pour faire des boudes de certail1es cordes
qu'on appelle
bagues,
& les appliquer [ur des trous
qu'on appelle
alillets
,
oh l'on palIe des garcettes;
aiguilles de ralingue
doubles
&
fimples , e'eft-a-dire
pour coudre
&
appliquer ces cordes qu'on emploie
pour fervir d'ourlet aux voiles.
(Z)
AIGUILLES. Ce font , dans les Manufaétures en
foie ,des filets de plómb de
10
a
11
pouces de lon–
gueur, du poids de deux onces , attachés aux mail–
les de corps pour tenir les cordes de fample
&
ele
rame tendues ,
&
la [oie de la chalne bailfée.
Il
ya
des aiguilles de demi-once , plus ou l110ins , dans les
métiers
¡\
la petite tire. Quand au nombre Cju'il en
faut pour chaque métitlr,
Voye{ l'arcide
VELOURS
cifelé>
auque! nous avons rapporté la plflpart des au–
tres étolfes.
Voye{ Planche VI.foierie
,
n.o.
l4.
les
aiguilles.
*
Al
G U 1 L L E S ,
(Hij!. anc.) aws di{criminales
&:
-+
erinales.
Les premieres ou les
d!{criminales
[ervoient
aux femmes mariées
a
féparer en deux leurs che–
veux
[m
le devant ,
&
cette raie pratiqllée entre
lenrs cheveux ainíi féparés , les dillinguoit des.
filIes. En elfet pre(que toutes les tetes antiques de
femmes qu'on trouve dans le P. Montfaucon , ont les
cheveux féparés ; les
a~ltres
les ont frifés ftrr le de,:
Dd
















