
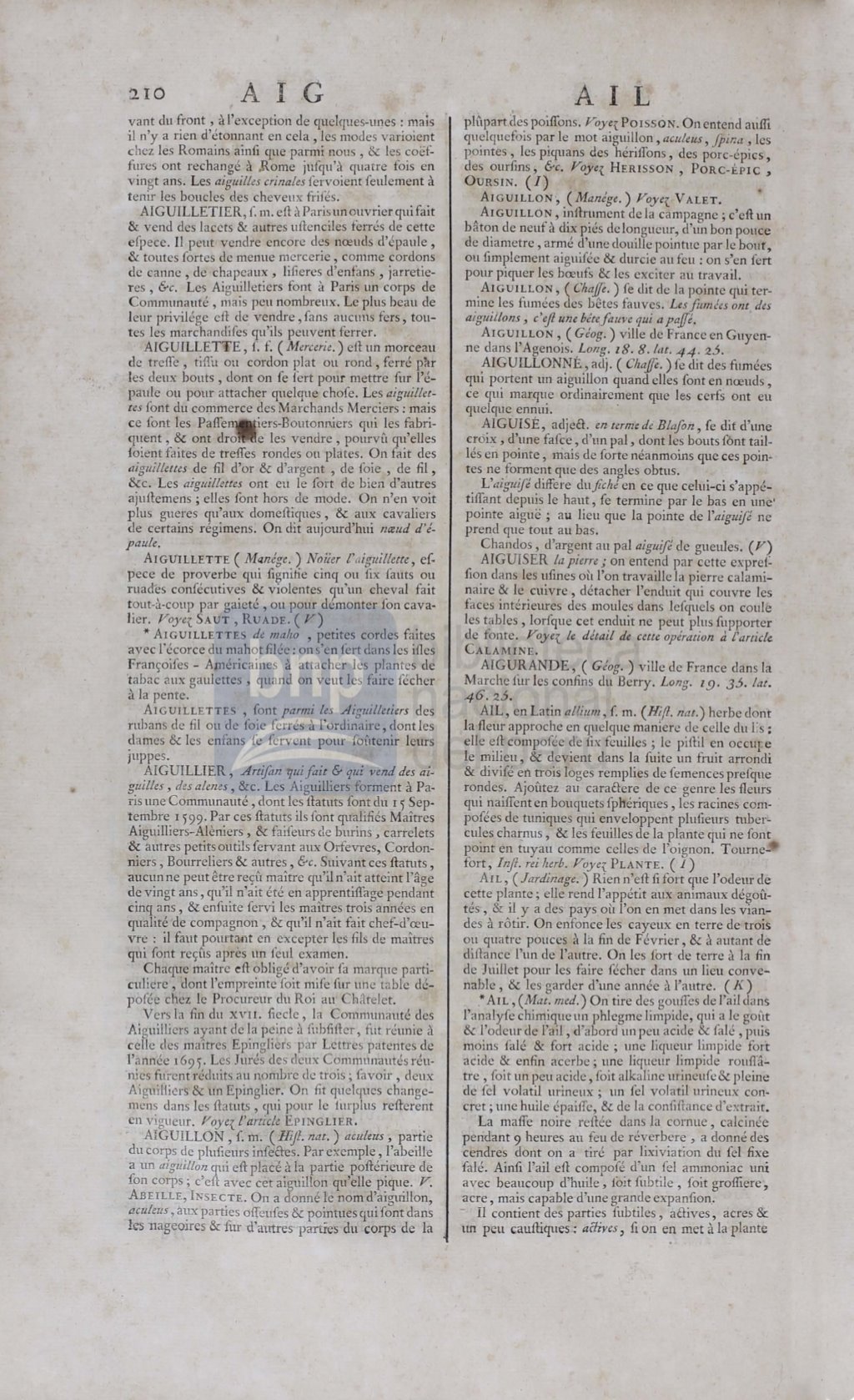
210
AIG
vant du front , al'exception de qllelques-unes : mais
il n'y a rien d'étonnant en cela,
les
modes varioient
chez
les
Romains ainfi que palmi nous ,
&
les coef–
fures ont rechangé a .Rome jufqu'a quatre fois en
vingt ans. Les
aiguiLLes erinales
fervoient feulement a
tenir les boudes des cheveux frifés.
AIGUILLETIER,
C.
m. eíl: a Paris un ouvrierc¡ui fait
& vend des laccts & autres uíl:enciles felTés de cette
ef¡)ece. Il peut vendre encore des nreuds d'épaule ,
& (Qutes fortes de menue mercerie , comme cordons
de canne , de chapeaux, lifieres d'enfans , jarretie–
res,
&c.
Les Aiguilletiers font
a
Paris un corps de
Coml11unauté , mais peu nombreux. Le plus beau de
lem privilége eíl: de vendre ,fans aUCUllS fers, tou–
tes les marchandifes c¡u'ils peuvent ferrer.
AIGUILLETTE,
e
f.
(Mercerie.)
eH un morceau
de trelfe, tiilü OH cOl'don plat ou rond, ferré par
les deux bouts , dont on fe /Crt pour mettre (ur I'é–
paule ou pour attacher
quelq1.lechofe. Les
aiguilla–
tes
lont du commerce des Marchands Merciers ; mais
ce font les Palfe
iers-Boutonl'.iers qui les fabri–
quent,
&
ont dro e les vendre, ponrvll c¡u'elles
faient faites de tre1fes rondes on plates. On fait des
aiguilleues
de
ni
d'or
&
d'argent , de foie , de
ni,
&c.
Les
aigllilleues
ont eu le fort de bien d'alltres
ajufl:emens; elles font hors de ruode. On n'en voit
plus gueres c¡u'allx domefl:iques,
&
aux cavaliers
de certains régimens. On dit aujcurd'hui
n«md d'é–
paule.
AIGUILLETTE
(Manége.) Noüer l'aiguillette,
ef–
pece de proverbe qui fignirie cinc¡ ou fix fauts ou
ruadés confécutives
&
violentes 9u'un cheva! fait
tout-a-coup par gaieté , ou pour demonter fon cava–
lier.
Voye{
SAUT , RUADE. (
V)
*
AIGUILLETTES
de malLO
,
petites cordes faites
avec récorce du mahot filée: on s'en lert dans les i{les
Frans:oifes - Américaines
a
attacher
les
plantes de
tabac aux gaulettes , 'luand on veut les faire fécher
a la pente.
AIGUILLETTES , font
parmi les AiglliLLetiers
des
rllbans de fil ou de foie ferrés
a
I'ordinaire, dontles
dames
&
les enfans fe fervent poar fOlltenir leurs
juppes.
AIGUILLIER,
Artifan t¡ui faie
&
qui vend des ai–
guilles, des alenes
,
&c. Les Aiguilliers forment a Pa–
ris une Cornrnunauté , dont les íl:atuts font du
15
Sep–
tembre
1599.
Par ces fl:atuts ils font qualifiés Maí'u'es
Aiguilliers-Aleniers,
&
faifeurs de burins, carrelets
&
autres petits outils fervant aux Orfevres, Cordon–
niers , Bourreliers
&
autres,
&c.
Suivant ces íl:atuts ,
aucun ne pent &tre reC;ll maltre c¡u'il n'ait atteint nlge
de vingt ans, qu'il n'ait été en apprentilfage pendant
cinq ans ,
&
enfuite fem les maltres trois années en
qualité de compagnon,
&
'lu'il n'ait fait chef:'d'reu–
vre : il faut pourtaflt en excepter les fils ele maitres
qui fOllt reS:lls apres un feul examen.
Chaque maltre eft obligé d'avoir fa marque parti–
culiere , dont I'empreinte foit mife fur une table dé–
pofée chez le Procureur du Roi au Chatelet.
Vers la fin du
XVII.
fieele , la Communauté des
Aiguilliers ayant de la peine
a
{i¡bfiíl:er , fut réunie a
celle des ma'itres Epingliers par Lettres patentes de
I'année
1695.
Les Jllrés eles denx ComnmmlUtés réu–
nies furent réelllits au nombre de trois ; favoil' , denx
Aigllilliers
&
un Epinglier. On {jt quelqucs change–
mens dans les fl:atllts , c¡ui pour le lürplus refl:erent
en vigueur.
I/oy e'{ l'arúe/¿
EPINGLlER.
AIGUILLON, f. m.
(Htjl.
nato
)
awleus,
partie
du corps de plufieurs infeé.tes. Par exemple, l'abeille
a un
aiguillon
qui eft placé
a
la partie pofl:érieure de
fon corps ; c'eft avec cet aiguillon qll'elle pique.
V.
ABEILLE, INsEcTE. On a donné le nom d'aiguillon,
awferts,
3:L'(
parties olfeufes
&
pointues (Iui font dans
les nageOlres & (m d'mltres partres elu corps de la
AIL
pll¡partdes poi1fons.
Voye{
POI
SON.
On entend auffi
quelquefois par le mot aiguillon,
aeuleus
,
/pina,
les
pointes, les piquans des hérilfons, des porc-épics,
des oUIfins,
&c. Voye{
HERISSON , PORC-ÉPIC
~
OURSIN.
(I)
.
AIGUILLON',
( Manége. ) Voye{
VALET.
AIGUILLON, infl:mment dela campagne; c'eftun
baton de neufa
dix
piés delonglleur, d'un bon pouce
de diametre ,armé el'une douiUe pointlle par le bou!,
ou fimplement aiguifée
&
durcie au fen ; on s'en fert
pour piquer les brellfs
&
les exciter au travail.
AIGUILLON, (
Chafo.
)
fe dit ele la pointe qui ter–
mine les fumées des betes fauves.
Les fmnées ont des
aiguiilons,
e'
efl
une beeefauye qui a paJJé.
AIGUILLON,
( Géog. )
ville de France en Guyen–
ne dans l'Agenois.
.
Long.
18.
8.lat.
44. 2.5.
AIGUILLONNE, adj. (
Chaffo.)
fe dit des fumées
qui portent nn aiguillon quand elles font en nreuds ,
ce c¡ui marque ordinairement que les celfs ont en
quelque ennui.
.
AIGUISÉ, adjeél:.
en terme de BlaJon,
fe dit d'une
crdix, d'une fafce, d'un pal, dont les bollts f6nt
tail–
lés en pointe, mais de forte néanmoms que ces poin.
tes ne forment que des allples obtuso
L'niguiJé
dilfere
dufiehe
en ce que celui-ci s'appé–
tillant elepuis le haut, fe termine par le bas en une'
pointe aigue ; au lieu que la pointe de
I'aiguifl
ne
prend que tout au bas.
Chandos, el'al'gent au pal
aiguiJé
de gueules.
(1/)
AIGUTSER
la pierre;
on entend par cette exprel:
fion dans
les
tmnes 0\1 I'on travaille la pierre calami–
naire
&
le cllivre, détacher I'enduit c¡ui couvre les
faces intérieures des moules dans lef'luels on coule
les tables , lorfque cet enduit ne peut plus fupporter
de fonte.
Voye{ le détail de eme opératÍon
a
fartick
CALAMINE.
AIGURANDE, (
Géog.
)
ville de France dans la
Marche Jiu' les conhnS dll Berry.
Long.
19,
3.5.
lato
4
6
.2.5.
AIL, en Latin
alliulIl,
f.
m.
CHiflo nat.)
herbedont
la fleur approche en quelc¡ue maniere de celle du lis :
elle eíl: compofée ele fLX feuilles ; le pifl:il en occure
le milieu,
&
devient dans la fuite un fruit arrondi
& divifé en trois loges remplies de femences prefqlle
rondes. Ajofttez au caraél:ere de ce genre les fleurs
'lui nailfenten bOllc¡uets fphériqnes, les racines com–
pofées de tuniques qui enveloppent plufteurs ttlber–
cules charnus,
&
les feuilles de la plante qui ne fom
point en ttlyau comme celles de I'oignon. TClUne–
fort,
Inji. reí Iterb. Vaye'{
PLANTE. ( 1 )
A1L,
(Jardinage.
)
Rien n'efl: fi fort que I'odeur de
cette plante; elle rend l'appétit aux animaux dégoft–
tés, &
il
Y a des pays 0\1 I'on en met dans les vian–
des a rotir. On enfonce les cayellx en terre de trois
ou quatre pouces
a
la
fin
de Février,
&
a autant de
diíl:ance I'un de l'autre. On les
lart
de terre
a
la fin
de Juillet pour les faire fécher dans un lieu conve–
nable,
&
les garder d'tme année a I'autre.
(K)
*
AlL ,
(Mat. medo
)
On tire des g01l1Tes de l'ail dans
I'analyfe chilT\ique un phlegme limpide, c¡ui a le gOllt
&
I'ocleur de I'ail, d'abord un peu acide
&
falé , puis
moins falé
&
fort acide ; une liqueur linlpide fOft
aciele & enfin acerbe; une lic¡ueur limpide rouím–
tre, foit un peu acide, foit alkaline urineufe& pleine
de fel volatil urineux; un fel volati1 urineux con–
cret ; une huile épaiífe,
&
de la conftfiance d'extrait.
La malfe noire refl:ée dans
la
cornue, calcinée
penelant
9
heures au feu de réverbere , a donné des
cendres dont 011 a tiré par lixiviarion du fel ¡¡xe
falé. Ainfi I'ail eíl: compofé el'un fel ammoniac
uro
avec beaucoup d'huile, Jait lllbtile , foit groiliere,
acre, mais capable d'une grande expanfion.
Il conrient des parries fubtiles, aél:ives, acres &
1m
peu caufuques :
afliyes,
fi
on en met
a
la plante
















