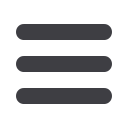
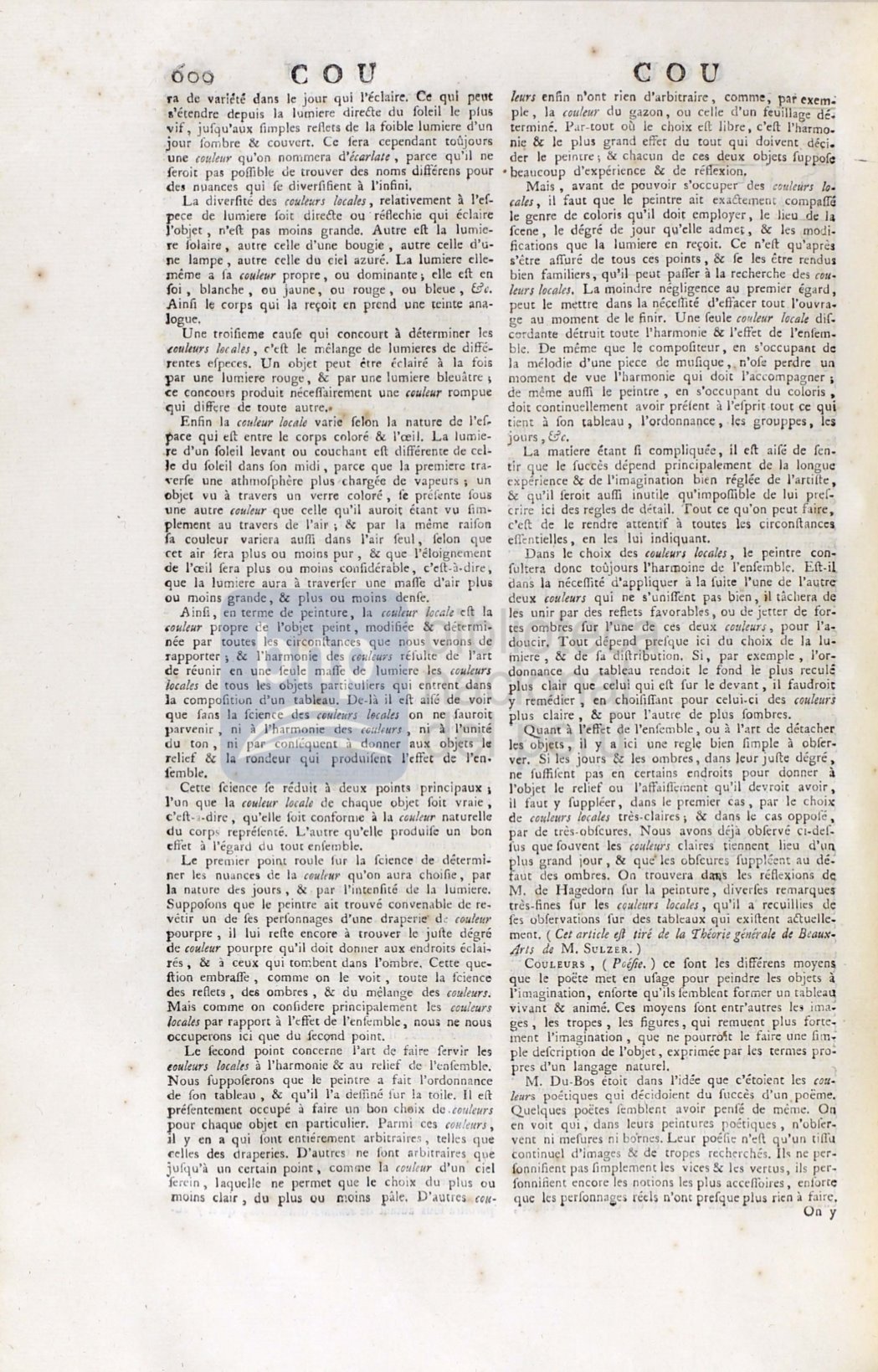
ooo
cou
ra de
varl~tc
dans lo jour qui 1•i:claire.
ee
qui peut
g'etendre depuis la Jumiere directe du foleil le plus
vif, jufqu'aux !imples reflets de
1<!
foible lumiere d'un
jour fombre
&
couvc:n. Ce fera cependant toiljours
·une
co11leur
qu'on nommera
d'icarlate,
parce qu'il ne
foroit pas poffible de trouver des noms di(forens pour
d es nuances qui fe diverfifient
a
l'infini.
La diver!ite des
couleurs locales,
relativement
a
l'ef–
pece
de lumiere foit directc ou . reAechie qui eclaire
)'objct , n'ell: pas moins grandt1. Autre ell:
1<1
lumie–
re folaire, autre celle d'une bougii! , autre celle d'u–
flC
lampe, autre celle du ciel azure. La lumiern clle.
meme
a
fa
co11leur
propre,
OU
dominante; elle ell: en
foi , blanche , ou jaune, ou rouge , ou bleue,
&c.
,Ainli
I<;
corps qui
Ii!
re<;oi~
en prend une teinte ;ina–
Jogue,
Une troifiemti caufe qui concourt
a
detenniner
Jes
~oult11rs
locales.
c'efl:
le
melange de lumieres de diffc–
rentes efpeces. Un objet peut ctre eclaire
a
la fois
Far une lumier-o rouge,
&
par une lumiere bleuittre
1
ce concours produit
n~celfairement
une
couleur
rompue
«1ui
diff~re
de route autre.•
Enfin la
cottleur locale
varie felon la nature do l'ef,
pace qui ell: entre
le
corps colon\
&
l'c:eil. La lumie–
re d'un foleil levant ou couchant ell: differente de cel–
)e
du foleil dans fon midi , parce que la premiere tra.
,-erfe une athmofphere plus -chargec de vapeurs ; un
objet vu
a
travers un verro colore ,
(~
prffrntt: fous
une autre
couleur
que celle qu'il auroit etant vu fim•
plement au travcrs de !'air ;
&
par la meme raifon
fa couleur variera auffi dans l'air feul, folon que
ret air fera plus ou moins pnr,
&
quc: l'eloignement
<le l'c:eil (era plus ou moins conliderable, c'ell:-3-dirt: ,
que la lumiere aura
a
traverkr une malfo d'air plus
ou moins grande,
&
plus ou mo ins denfe.
A
infi , en tcrme de peinture, la
coulmr locale
ell: la
,011/mr
propre de l'objet
p~int,
modifiee
&
determi–
nee par toute11 les circonfbnces quc nous venons de
rapporter ;
&
l'harmonie des
co:deurs
rtfulce de !'art
<le rcunir en une feule malfe de lumiere les
couleurs
locales
de tous ks objets panicu
lir.rsqui entrent dans
la compofition d'un tableau. De-la ii ell: aif6 de voir
que fans la fcience des
couleurs locales
on ne fauroit
parvenir ' ni
a
l'harmonie des
co11!t11rs
~
ni
a
!'unite
<lu ton , ni par conlcquent
a
donner aux objets le
relief
&;
la rondeur qui prodt1ifent l'cffet de
!'co.
fem
bk
Cette fcience
fe
redult
ii
deux
point~
principaux
I
l'un qt1e la
couleur locale
de chaque objet foit vraie,
c'e!l:-a-dire, qu'elk foit conforme
a
la
couleur
naturelle
du corps reprc!fentb. L'autre qu'elle produifo un ban
cffct
a
l'egard du tom enfemblc.
Le premier point roule fur la fcience de determi–
ner k s nuances de la
couleur
qu'on aura choifie , par
la nature des jours,
&
par l'intenfite de la lumiere.
Suppofons que le peintre ait trouve convenabk de re–
vetir un de fos perfonnages d'une draperie·
d~
couleu1·
pourpre , ii lui refle encore a rrouver le jufle degre
<le
couleur
pompre qu'il doit donner aux endroits eclai.
res ,
&
a
ceux qui tombent dans l'ombrc, Cette que–
ftioo embralfe , comme on le voit , toute la fcience
des reAets , des oinbres ,
&
du melange des
fottleurs.
Mais comme on confidere principalement Jes
couleurs
locales
par rapport
a
l'cffet de l'enfemble, nous ne nous
occuperons ici que du .fecO'lld point.
Le fecond point concerne !'art de faire fervir Jes
touleurs locales
a
l'harmonie
&
au relief de l'enfemble-.
Nous fuppoferons qut: le peintre a fait l'ordonnunce
<le fon tableau ,
&
qu'il l'a deffi nc for la toile. II efl:
prffentemer.t occupe
a
faire un bon cheix de
.co11leurs
pour chaque objet en parciculier. Parmi ces
co11le11rs ,
ii
y
en a qui font entierement arbitraires , telles que
celles des draperies. D'autres ne font arbitraires q11e
jufqu'a un certain point, comme la
coule11r
d'un ciel
ferein, laqudle ne permet que
le
choix du plus ou
moins clair , du plus ou moins
pale.
D'autres
co11-
cou
leurs
enfin n'ont rien d'arbitraire, comme;
par
exem~
pie , la
couleur
du gazon, ou celle d'un feuillage de.;
termine.
P
Jr-tout
0\1
le choix efl: libre, c'e!l: l'harmo.
nie
&
le
plus grand effer du tout qui doivenc
d€<;i.
dcr le peinm:;
&
chacun de ces deux objets foppofa
• peaucoup d'experience
&
de reflexion,
Mais , avant de pouvoir s'occuper des
eouleurs lo.
r:ales,
ii faut que le peintre air exaCl:ernent compalfe
k
genre de coloris qu'il
doi~
employer,
le
lieu de la
fcene, le degre de jom qu'elle adme;:,
&
Jes modi–
fications que la lumiere en
re~oit.
Ce n'efl: qu'apres
s'etre alfure de tous ces points,
&
fe Jes etrc rendui
bien familiers, qu'i} peut palfc:r
a
la rccherche des
COii•
/um
locale/.
La moindre negligence au premier egard,
peut
le
mettre clans la neceltte d'effacer tout l'ou vra.
ge au moment de
k
finir. U ne feule
couleur locale
dif–
cordante detruit tout<: l'harmonie
&
l'cffet de l'enfem–
ble. De meme que
le
compo!ireur, en s'occupant de
la melodie d'une piece de mulique' n'ofo perdre \ln
moment de vue l'harmonie qui doit l'accompagner ;
de meme auffi le peintre , en s'occupant du coloris •
doit continuellement avoir prelent
a
l'efprit tout ce qui
tiC'.nt
a
fon t4bleau
I
l'qrdonnapce,
ies
grouppes
1
ics
jours
, &c.
La matiere etant
fi
compliquee ,
ii
efl:
aifci de fen.
tir que le fucces depend principalement de la longuc
experience
&
de !'imagination bien reglee de l'artifl:c:.
&
qu'il feroit aum inutile qu'impoffible de lui pref–
crire ici des regles de detail. Tout ce qu'on peut faire,
c'c!l: de
le
reridre atrencif
a
routes
ks
circon!l:ances
effcntiel)es, en !es lui indiquanr.
Dans
le
choix des
couleuri lo<ales,
le
peintre con–
fultera done toujours l'harmoine de l'enfernble. Ell:-il.
Clans la neceffite d'appliq\ler
a
la fuire l'une de l'autre
deux
couleurs
qui ne s'unilfent pas \lien, ii tachera de
les unir par des reflets
favorabl~s,
ou de jetter de for–
tes ombres fur l'une de ces deux
co11/eurs,
pour l'a.
doucir. Tout depend prefque ici du choix de la Ju.
fniere ,
&
de
fa
difl:ri bution. Si, par exemple , l'or–
donnance du tableau rendoit le fond
le
plus
recul~
plus clair que celui qui ell: fur le devant, ii faudroit
y remedier , en choi!ilfant pour celui-ci des
co11le111'S
plus claire ,
&
pour l'autre de plus fombres.
~ant
a
}'effh de l'enfcmble,
OU
a
!'art de detacher
ks objecs ,
ii
y
a
ici une regle bien fimple
a
obrer–
ver. Si lc:s jours
15?
!es ombres, dans Jeur j ufl:e degre,
ne fuffifent pas en cercains
en~roits
pour donner
a
l'objet le relief ou l'affailfement qu'il devroit avoir ,
ii
faut
y
fuppleer, dans
le
premier cas, par
le
choii.:
de
c011leur1 lofales
tres-claires ;
&
dans le cas oppofe ,
par de cres-obfrures. Nous avons deja obferve ci-def–
fus que fouvent !es
(Ottlettrs'
claires tiennent lieu d'u:ii
plus grand jour,
&
que' les obkures
fuppl~ent.
au de–
faut des ombres. On trouvera d<lll·s !es reflexions de
{\1.
de Hagedorn fur la peinture, diverfes remarques·
tres-fines fu.r les
coule11rs locales,
qu'il
a
recuillies <le
fes obfervations fur des tableaux qui exi!l:ent actudle–
ment. (
Cet article eft
tire
de la Tbeorie genira/e de
Beau.~-.
4rtJ
de
M.
SuLZER.)
CouL£URS , (
Poi.fie.
) cc font Jes differens moyens ·
que le poece met en ufage pour peindre les objets
ii
!'imagination, enforte qu'ils femblent former un
tablea~
vivan t
&
anime. Ces moyens font entr'autres Jes
ima~
ges , les tropes, !es figures , qui remuent plus force–
ment !'imagination, que ne
pomro~t
le faire une !im:
pie ddcri ption de l'objct, exprim€e par !es termes
pro~
pres d'un langage nature!.
M. Du-Bos etoit dans l'idee que c'etoient !es
cou–
leurs
poeciques qui decidolent du fucces d'un poeme.
Quelques poeres f'em b\em avoir penfe de meme. On
en voit qui, dans leurs peintures poetiques , n'obler.
vent ni mefures ni bo'rnes. Lcur poe!it: n'efl qu'un tilf1.1
continue] d'images
&
de tropes recherches. Ils ne per–
fon nifient pas !implement les vices
&
ks vertus, ils per–
fonniflent encore les notions !es plus accelfoires , enforte
que lcs perfonna(.;eS reels n'ont prefque plus ricn
a
faire,
·
Onj
















