
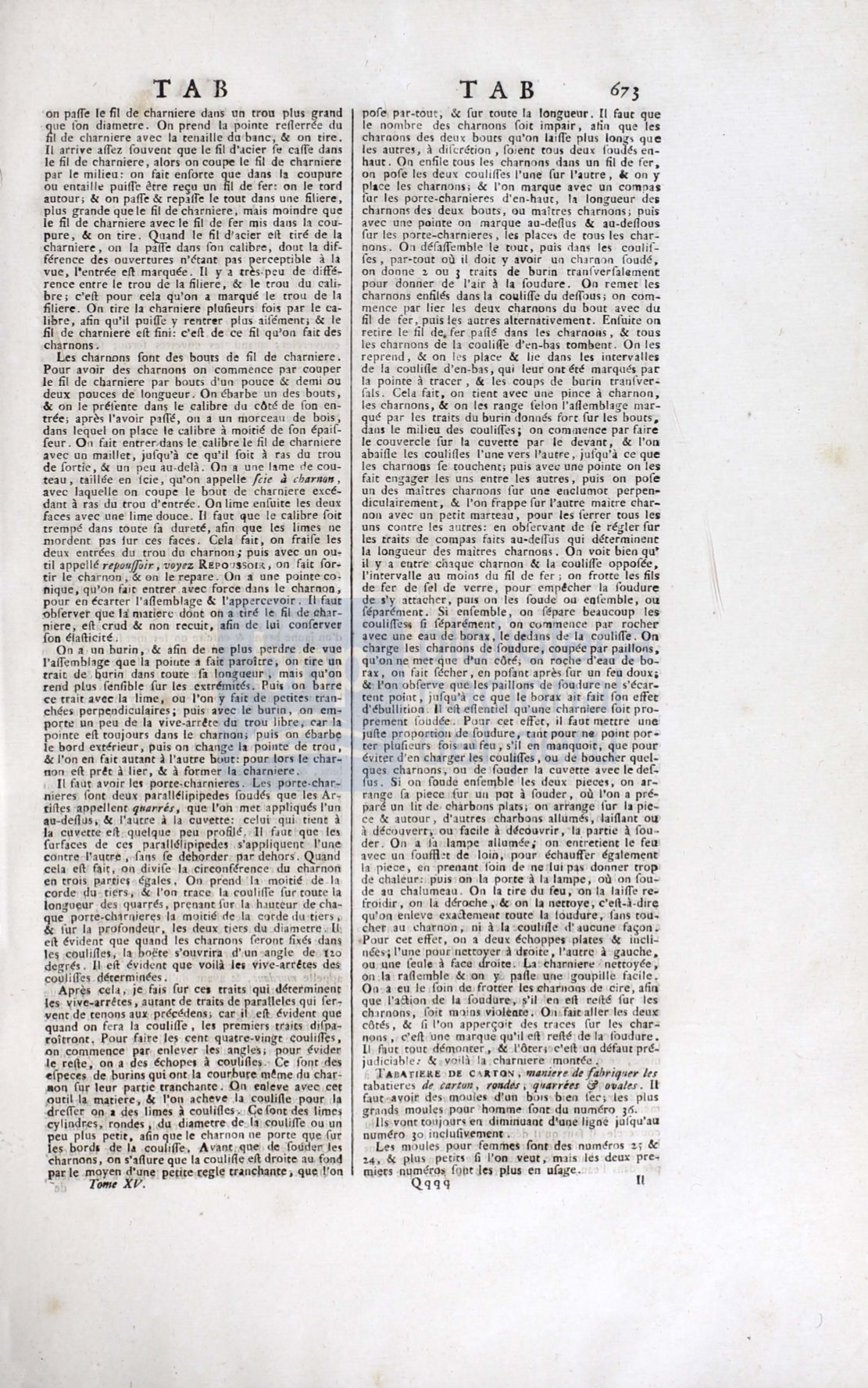
TAB
on patre fe fit de charniere dans un trou plus grand
que fon diarnecre . On prend la poince rellerrée du
fil de cliarniere avec la cenaitle du banc,
&
on tire.
Il arrive atrez fouvem que le fil d'dcier fe catre daos
le fil de charniere , alors on coupe le fil de charniere
par le milieu: on fait enforce que dans
13
coupure
ou entaitle puilfe erre
re~u
un fil de fer: on le tord
autour;
&
on patre
&
rep3tre le tour daos une filiere,
plus grande que le fil de ch1rniere, mais moindre que
le fil de charniere avec le fil de fer mis dans la cou–
pure ,
&
on tire . Quand le fit dlacier en tiré de la
charniere, on la p:ilre dans fon calibro, done la dif–
férence des ouvertures n't'tant pas percepti ble
a
la
vue, l'entrée en marquée . Il
y
a tres-peu de diffé–
rence entre le erou de la filie re,
&
le trou du cali–
bre; c•en pour cela qu'on a marqué le erou de
1~
filierc:. On tire la charniere plufieurs fois par le ca–
libre, afio <J.U'il puiíre
y
reAtrer plus aifément;
&
le
fil de charmerc en fini : c·en de ce fil qu'on fa it des
cha,rnons .
Les charnons fom des bouts de lit de charni.ere.
Pour avoir des charnons on commence par c;ouper
le lil
d~
cbarniere par hours d'un pouce
&
demi ou
deux pouces de longueur . On éha rbe un des bouts,
&
on le prétente dan$ le aalibre du c6té de fon en–
trée; apres l'avoir palfé, on a un morceau de bois,
dans lequd on place le calibre
a
moitié de fon épaif–
feur . O n fait entrerAlans le calibre le fil de charniere
avec un maill et, jufqu'a ce qu'il fo it
~
ras du rrou
de fortie,
&
un peu au -delil. On a une lame ele cou–
teau, uitláe en lcie. qu'on appetle
fcie
a
cbamon .
avec laquelle on coupe le bout de charniere excé–
dant
a
ras du trou d'enrrée. On lime enfuire les deux
faces avec une lime douoe..
U
faut que le calibre foi t
crempé dans roure fa dureté, alin que les limes ne
mordenr pas lur ces faces . Cela fait, on fraife les
dem entrées du trou du charnon; puis avec un ou–
til appcllé
rtpor1Joir,
v~yez
REPoussoJR, on faic for–
t ir le charnon ,
&
on le repare . On a une pointe co–
nique, qu'on
fai~
entrer avec force dans le oharnoo,
pour en écarcer l'allemblage
&
l'appercevoir . ll fauc
obfervet que l:t matlere dónt oh a tiré le fil de char–
niere, en ·crud
&
non recuit, afin de lui conferven
foo élallicité .
,
On a . un burin,
&
afin de ne plus
pe~dre
de vue
l'alfemblag.e que la poiute .a fait paroicre, on tire
Ul\
trai~
de l¡urin dans rouce
fa long-ueur , mais qu'on
rend plus fenGble fur les- extrémltés. P.uis on barre
ce trait a"ec la lime, ou l'on
y
fair de perites• tran–
chées perp¡;ndiculaires; puis avec le burin , on em–
pare.: un peu de la
vive-arr~ce
du rrou libre, car la
pointe en toujours dans le oharnon ; puis on
ébarb~
le bord extérieur, puis on ehange la pointe de erou,
&
l'on en fait autant
~
l'autne bout: pour lors le char–
non en
pr~r
a
lier.
&
a
former la charniere.
Il faut avoir les porce-charnieres . Les porte-char–
.nieres fon t deux parallélipipedes foudés que les Ar–
.till~s ~ppellent
qttanrh ,
que L'on mer appliqués l'un
au-deflús,
&
l'alttte
a
la cuvette: celui qui
ti~m
a
J.
CU~~tte
el\ quelque peu profllé,
11
fdUt que les
fu rfaces de ces parallálipipedes .s'applique•Jt !'une
concre~l'·aqtr1!'
, fa ns (e deborder par dehors·. Q uand
cela en
fai~.
011
divi[e la circonférence du oharnon
en trois
Rar~ie$ ~gafes,
On prc¡nd la moitié de la
~orde
¡fu ti!!'rs,
&
l'on trace la coulitre fur touce la
longuQUr des quarrés,
pr~nant
fu' la hJuteur de cha–
que porte-charqieres la moirié de la curde du riers,
&
titr la profonde[\r, les deux riers du dia metre .
U.
en évident que quand les charnons
feron~
lixés
dan~
te~ co[\lilles, la
bo~te
s'ouvrira d' un angle de t2o
degr.és.ll en évident
qu~
voila les vive-arréces des
coúliffes Q.écerminées .
"
Apres cela , je
f~is
fur ce¡ traits qui décerminent
les l(iv'e-arréces, aucant de traits de pauatleles qui fer–
·vent de tenons aux
pré¡:éden~;
car i\ e!l évident que
quand on fera la coulille , les premiers u•aits
dj[pa–
roitrqnt , Pour faite
le~
ceno quatre-vingc
~oul ilres ,
.on commence par enle"er 1les
an¡¡l~;
pour
~viden
.te
ré~e,
on a des échopCJ
a
COU!Jiles.
Ce
fonc des
~[peces
de -burins qui ont la cour)lllre
111~¡ne
clu char–
aon C.¡r leur partie, tranchante . :Un
~olev<:
aveq cet
ouril la rnaciere,
~
l'on
acl:t~ve
la CQ¡¡tifle pour 11a
_drelfer op ·a J]es limes
~
coulilles-...
~e
font des
lim~j
cylindr¡es, rondes
1
du diametre de) a couliJre ou un
peu plus petit. aun que le charnon ne porre q\Ie fur
les bordf de la coulilre, ·A vaot r,qu •de 'foúden)es
cliarnons, on s'allure que la collli({e eJI; droire. au, fond
par te moyen d'une· pe¡ice
c¡;gl~
trancltaJttl: -¡
qu~
<!
on
' -.
Tom~
Xf?.
·T A B
pofe par-tout ,
&
fur toute la longueur . Il fa ut que
le nombre des charnons foic impair, atin que les
charnons des deu x boucs qu'on la itre plus longs que
les aueres ,
~
di fcrécion , foient rous deux !oudés en–
haut . On enfil e rous les charnons dans un fil de fer •
on pofe les de u' coulitres l'une fur l'aurre,
¡¡
on
y
place les charnons;
&
l'on marque avec un campas
fur les porre-charniercs d'en-hauc,
la
long ueur de;
charnons des deux boucs, eu maitrcs charnons ; puis;
avec une pointe on marque au-dellus
&
au-dellous
fur les r on e-charnieres, les
plac~;
de rous les char–
nons. O n défalrernbte le tour, puis c!ans les coulif–
fes, par-rouc ou il doit
y
avoir un charnon fo uclé ,
on doone
2.
ou
3
traits de burin tranfver fa lament
pour donner de
l'air
~
la foudure . On remer les
charnons enlilés dans la co11liffe du detrous ; on com–
mence par lier les deux charnons du bout avec du
fil de fer , puis les autres alcernacivement. Enfuice on
retire le lit ele. fer paflé dans les charnons,
&
rous
les charnons de
la
cou li!fe
d'~n-has
tomllenr . On les;
reprend,
&
on les place
&
líe dans les intervalles
de la coulifl., d'en-bas, qui
l~ur
ont été marqués par
la poime
a
tracer ,
&
les aoups de
l>urin
tranfver–
fals. Cela fait, on tiene avec une pince
a
charnon,
les charnons,
&
on le5 range !elon l'a llemblage mar–
qué par
l~s.
traics du bu_rin donnés forr
[ur
les bours.
dan5 te m•l•eu des couhtres; on commence par fa ire
le couvercle fur la cuvett<O par le devane,
&
l'on
abaille les coulilles l'une vers l'autre , julqu'a ce que
les charnoos fe rouchent; puis avec une poinre on 'les
fait engager les uns entre les autres, puis on pofe
un des maitres charnons fur une e11clumot
perpen~
diculaireme11t,
&
l'on frappe fur Palltre mairre Ghar–
noll avec un petic maneau, pour les fcrrer rous les
uns concre
l~s
autres : en obfervant de fe régler fur
les traits de campas fai ts au-detrus qui décerminene
la longueur des maltres charnoas , O n voir bien qu'
il
y
a euere duque charnon
&
la coulilfe oppofée.
l'intervalle au moins du lit de fer ; on frorte les ñls
de fer de fel de verre, pour
emp~cher
la foudure
de 5'y attaoher, pn1s on les foude ou eofemble, ou
féparément. Si enfemble, on fépare beaucoup les
coulitrcs4
fi
féparément, on comme11ce par rochel"
avec une eau de borax, le dedans
d~
la coulilfe. On
charge les oharno11s de foudure, coupée par paillons,
qu'on ne met qne d'un coté; on ro,he d'eau de ho–
ra~,
011 fai c fécher, en pofanc apres fur un feu doux¡
&
L'on obferve que les paillons de fo udure ne s'écar–
cent poinc, jufqu'a ce que le borax ait fair fon effee
d'ébullition .
11
en ellentiel qu' une charniere foit pro–
prement foudée.. Pour
cct
etfet , il faut ntetcre une
juRe proponrion de foudure, tar\t pour ne point por·
ter plufieurs fois au feu, s'il en manquoit, que pour
évir~r
d'en charger
l~s
coulilfes, ou de boucher quel–
ques charnons, ou de fouder.
la cuvecre avec le
def~
fus . Si on foude enfemble les deux pieces, on ar–
range fa piece (ur un pqt a fouder, ou l'on a pré–
paré un lit ele charbons
plat~;
on arbnge fur la pie–
ce
&
aucour, d'autres charbons allumés, laillant ou:
a
découverr-; o u· facile
a
Mcóuvrir, la parcie
3.
fou
der. O n a la
lampe allumée
~
on enrr<Otient le fe u
avec un fouf!hr de loiil, pour échauffer également
la piece, en prenanc !oin dt> ne 'lui pas donner trop
de ohaleur: puis on ,la porte
·a
la lampe, ou on fou–
de au chalumeau . On la tire du feu, on la la ilfe re–
froidir, on la déroche
,.&
on la nettoye, c'ell-ii-dire
qu7on enieve el(aélement cauce la !oudure, fans rou:
cheu au
~harnon,
ni
a
-la .coulille d' aucune
fa~on ~
Pour cet elfer, 011 a deux échopp<>s piares
&
i11cli-
11ées·; !'une pour\nettoyer
a
"dfoite. l'aucrc
a
gauche.
ou une [eulc
a
face dro.ite .
~a
chaonier" necroyée,
on la rafiemble
&
on
Y'-'
palie
u.negoupille facile _
On a eu le foin de
frot~er
les .charnons de cire, alin
que
l'a~ion
de la
foudur~,
'il en efl veRé fur les
charnons, foit m<lins vioH,nt.e. ÜJ1.Tait alter les deux;
cotés,
&
jj
l'on
apper~oit
des traces fur les char–
IIOIIS,
c'el\ ·une mar.que qu'i( el\ rel\é de la loudure.
11
fauc rpu t démonrer,
&
l' llcer;' C'e!b
UfJ
défauc pré–
judiciable:
&
voi la la charniere montée,
;r~BA
TJI':KE D! CH Jt TON,
'11/ZnÍtr,•
d• fobriquer /u
tabarieres
de tartoll, rollliN , qilarriu
&
O'llale.s .
U
faut ~avoic
des otou les d'un bo•s b1en
!é~;
Les plus
grnl)ds maules pour ho.mme font du numéro
36.
l is vonr coujour< en diminuanc d•une ligne jufqu'au
, mrméro
30
incln!ivement .
r
"
Les
moule~
pour
femm~s
fonr des numéros
2.;
&
l.<l-.
&
p.lus petirs
fi
l'on veut, mais les deux pre–
(ll.i~rs m1méro~
fgllt les pJus en ufage .
Qqqq
ll
















