
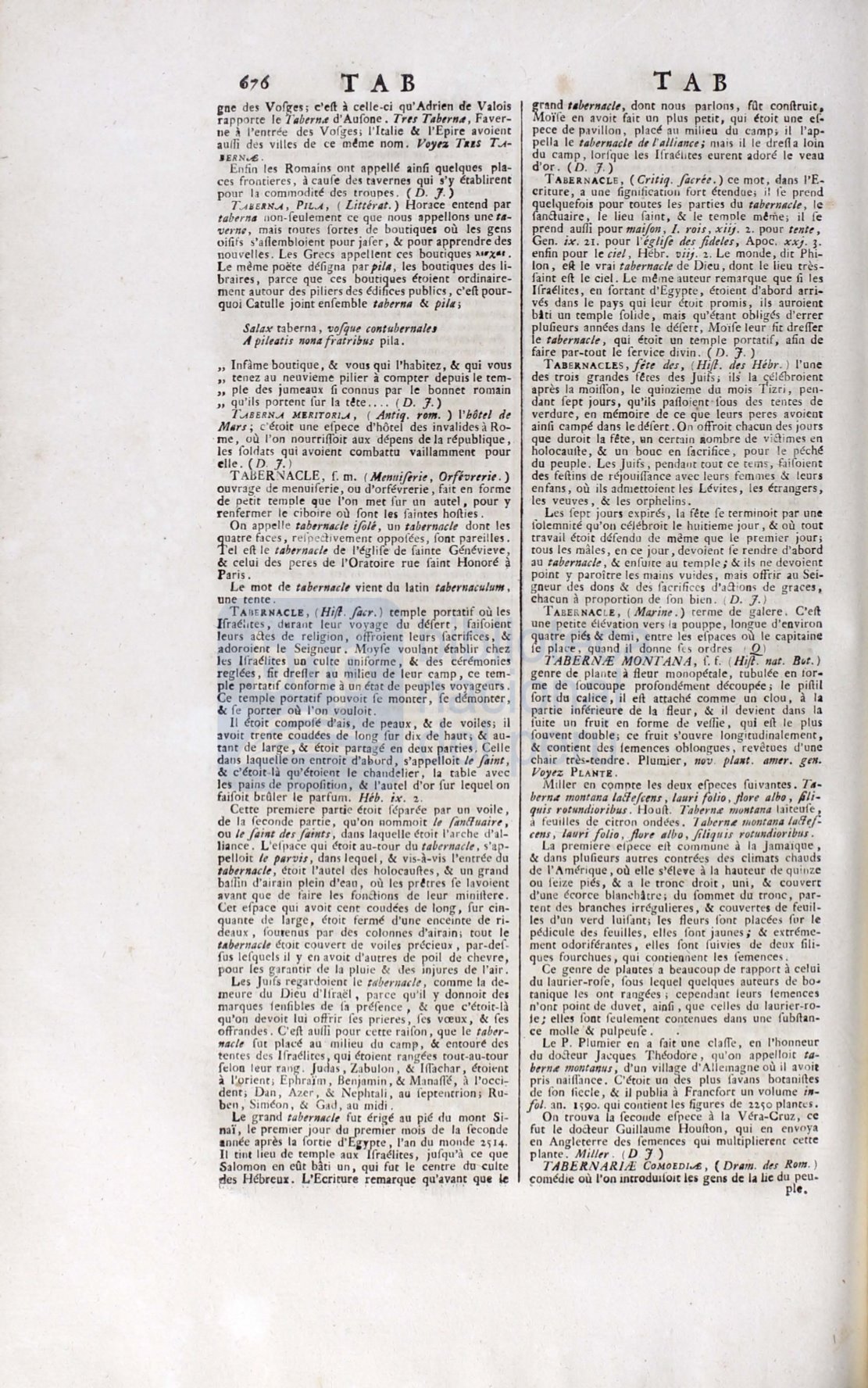
TAB
¡ae
des
Vo(¡~es;
c'eft
~
celle-ci qu'Adrien de
:V
alois
rapporte le
111bern.t
d'Aufone .
Tru T11btrn11 ,
Faver–
ne
a
l'enrrée des Vofges; l'Italie
&
l'Epire avoient
aulli des
vil
les de ce
m~me
nom .
Voyt:r. Tus T
..A–
J ERN~ .
Enfin les Romains ont appellé ainfi quelques pla–
ces frontieres ,
a
caufe des tavernes qui s'y établirent
pour la commodité des troupes .
(D.
J. )
T..AB6ItN.A , PJL.A,
(
Littérat. )
Horace entend par
taberu
uon-feu lement ce que nous appellons une
t.r–
vernr,
mais
rour~s
fo rres ile bouriques ou Jes gens
oifi fs s'afl embloient pour jafer,
&
pour apprendre des
nouvelles . Les Grecs appellent ces boutiques
>~•x•• .
Le mi!me r oete déligna par
¡i/11 ,
les boutiques des li–
braires , paree que ces boutiques étoient ordinaire–
menr autour des piliers eles éd ifict:s publics, c'eft pour–
quoi Catulle joint enfem ble
tabern11
&
p;¡,,;
S11/ax
taberna,
'VIlj(¡ue Gontubernalu
A
pilutis
nona
f ratribus
pila.
,
I nfame boutique ,
&
vous qui l'habitez,
&
qui vous
, tenez au neu vieme pilier
a
compter depuis le tem–
" pie des jumeaux fi connus par le bonnet romain
,. qu'ils pon enr fur la
t~te
.. . .
( D.
J.)
T...<BERN..A Ml.RITORI.A , ( Antiq. rom.
)
l'b8td de
M 11rs;
c'éroít une efpece d'hótel des invalides
a
Ro–
.me, o
u
l'on nourri(foit aux dépens de la république ,
les fo ldats qui avoient combattu vaillamment pour
~lle .
(D.
J.)
TABER . ' ACLE, f. m.
r
Menuifirie , Orfívrtrit.)
ou vrage de menuiferie , ou d'orf.!vrerie , fait en forme
d e
p~tit
temple que l'on met fur un autel, pour
y
r enfermer le ciboi re o\l font les fain tes hofiies .
O n appelle
tabtrnllcle
i.foü ,
un
tabtrllnGÜ
dont les
quarre faces , rei'peti•vemenr oppo(ées, font pareilles .
Tel en le
tabernad t
de l'églife de fain te Génévieve ,
&
celui des peres de I'Oratoire r ue fai nt Honoré
~
P aris .
Le- mot de
t&bern~t&le
vient du latin
tabeYIIaculuiH ,
une ten te .
T AIIEilN.,.CLE , (
Hifl.
jiur. )
temple pormif ou les
l fraé:.res ,
d~rant
leur voyage du défert , faifoient
leurs aéles de religion, offroient leurs facrilices, &
adoroienc le Seigneur. Moyfe voulan t
~tablir
chez
les lfraélites uo culee uni forme,
&
des cérémonies
r eglées, fit drefl e-r au milieu de leur camp, ce tem–
ple pertatif conforme
a
un état de peuples voyageurs .
Ce temple portatif pouvoit fe momer , fe démonter ,
&
fe porter ou l'on vouloi t .
Il étQit compofé d'ais, de pea ux ,
&
de voiles; il
:tvoit trente coudées de long fur dix de haut ;
&
au–
tant de large , & étoit panagé en deux parties , Cell e
dans laquelle on entroit d'abord, s'appelloit
le foint ,
&
c'étoit-13 qulétoient le chandelier , la table avec
les pains de propofi tiun,
&
l'au tel d'or fu r lequel on
faifoit bcGier le parfum.
Héb.
ix.
2..
Cette premiere partie étoic féparée par un voile ,
de la feconde parrie , qu'on nommoit
le (iwfltJaire ,
ou
le foint des foints,
dans laquelle étoir
1'
arche d'al–
liance . L'ef'pace qui étoit au-tour du
tabernncle,
s'ap–
pelloir
le p11rvis ,
dans lequel ,
&
vis-a-vis l'enrrée du
tabernacle ,
étoit l'autel des holocaunes, & un grand
baflin d'airain plein d'eau , ou les prl tres fe lavoient
avanc que ,de faire les foncrions de leur minitlerc .
Cec efpa ce qui avoit cenr coudées de long , fur cin–
quante de large , étoit fermé d't,me enceinte de ri–
dea ux , fou,renus· par des colonnes d'airain; tour le
t.rbem acü
étoit cquvert de voil es précieux, par-def–
fus lefquels il
y
en avoit d'a ucres de poil de chevre,
poar les ¡prantir de la pluie
&
des injures de l'air.
L es J u•fs
reg~ t·doi:nc
le
triQtl'l¡acle ,
comme la de–
meure du Dieu d' lfrllel, paree qu'il
y
donnoit des
n1arques lenfibles de fn préfence
1
& que c'étoit-h\
qu'on devoi t lui offrir fes prieres , fes vce ux ,
&
fes
offrandes. C' e¡t aufli pour cette raifon, que le
tabcr–
nacle
fue placé au mi lieu du camfl,
&
entoure des
ten res des l fraélitcs
1
qui étoient rangées rout-au-tour
ftl on leur rang . J ana s, Zabulon ,
&
Hfachar, t'toient
a
l'orient ; Ephrai'm, Benjnmin,
&
Manafle ,
i\
l'occi
7
dent; Dan , Azer ,
&
Nephtali, au feptentrion; Ru–
b~ n ,
Si méon,
&
Gad , au midi .
Le grand
tabern~ule
fu e éri¡:é au pié du mont Si–
na'i, le prem1er jour da _premter mois de la feconde
année apres la fortie d' E¡n-pre , l'an du monde
:z.;14.
I l tint lieu de templ e aax lfraélites , jufqu 'a ce que
Salomon en efit batí un, qui fue le centre
ctu~c.ulte
(!~s
Hébreux :
~·Ecricure Fe~~rqu~ ~u·~v~.nF
que
~
TA:B
g rand
t.r!Jtrnlltle,
dont nous parlons , fat contlruit •
MoiTe en avoi t fa ir un plus petit, qu i
~toit
une ef·
pece de pavillon, placé pu mil ieu du camp' il l'ap–
pella le
tAbtrnacle dt l'11llianu;
ma is il le drefl a loin
du camp , lorfque les l fraéhtes eurent adoré le vea
u
d'or .
(D.
J. )
TABERNACLE, (
Critiq. fi¡Gr(e. )
ce mot , dans I'E–
criture , a une fignificacion fort étendoe; ;:
(e
prend
quclquefois pour
ro
ures les partíes du
tabern11de ,
le
fanéluaire' le lieu fa int,
&
le temole m!<ñe ; il re
¡>rend aufli pour
maijo11, l. ¡·oís,
xiij.
2.
pour
ttnte ,
Gen.
ix.
21.
pour
l'églifi des fideles,
Apoc.
xxj.
¡.
enfin pour le
del ,
Hébr.
viij.
2..
Le monde, dit Phi–
Ion , ell: le vrai
tabernacle
de D ieu , done le lieu tres–
lai nt eft le ciel . Le meme auteur remarque que
íi
les
l fraélites, en fortant d' Egypte , étoient d'abord arri–
vés dans le pays qui leur étoit promis, ils auroient
blti un temple folide , mais qu'étant obligés d'errer
plufieurs années dans le défert , Mo'ife leur fit drell'er
le
tabern.rcle,
qai étoit un ternple portatif, afin de
faire par-tout le ferviee divin .
( D .
J.
)
TABERNACLES,
fete
des , (Hifl. des H(br.
)
(' une
des trois g randes feres des J uirs¡ ils' la célébroient
apres la moifl'on, le quinzieme du mois Tizri, pen–
ddnt fept jours, qu'ils pafloient · t'ous des tentes de
verdure, en mémoire de ce q'ue leurs peres avoicnt
ain(j ca mpé dans le défert. On offroit chacun des jours
que duroit la féte , \ln certl in aombre de vié\i mes en
holocautle, & un bouc en facrifice , pou r le péché
du peuple . Les Juifs , pendant tout ce tems-, faifoient
des feni ns de ré¡ouilfance avec leurs femmes
&
leurs
enfans, ou ils aclmettoient les Lévites , les étrangers,
les veuves, & les orphelins .
L es fept jours expirés, la fe te fe terminoit par umt
i'olemnité qu'on cé)ébroit le huicierne joor,
&
ou toat
travail étoit défendu de meme que le premier jour;
tOUS
les males, en ce jour , devoient fe rendre d'abord
au
tabernacl~,
&
enfuJte
a
u remple ; & ils ne devoient
point
y
paroitre les mains vu ides, mais offri.r au Sei–
gn~ur
des dons & des f'acri ficcs d'aélions de graces,
ehacun
i\
proportion de fon bien . ( D.
J.)
T ABERNACLE,
(
Mwin<. )
terme de galere . C'en
une perite élévation vers la pouppe, long ue d'environ
quatre piés
&
demi, entre les efpaces ou le capitaine
fe place , qu:111d il donne
f~s
ordres ' Q.l
1'A BE 8.NJE MONTANA,
C
f. (
Hijf. nat.
B~t.
J
gen re de plante :\ tleur monopétale , rubulée en lor–
me de foucoupe profo ndément découpée ; le pifiil
fort du calice,
il
eft attaché comme un cloo ,
a
la
partie inférieure de la t!eur , & il deviene dans la
!'uite un fru it en forme
d~
veflie . qui en le plus
fo uvent double ¡ ce fruit s'ouvre longitudinalement,
&
contiene des lemences ohloogues , reverues d'unc
chair tn!s.-tendre . Plutnier ,
11ov . pla11t.
nf1ltr.
g en.
Voyez
PLANTE .
MJI Ier en CQmpre les deux etj>eces fuivanees.
111-
bern~L
montn11a latlejcens , lauri folio, flo re albo, jiti–
quis rottmdioribus .
1-Joun.
Tnbem<e moHtana
laiteur~ ,
a
feuilles de citron ondées .
Tabernlt mo11fa11a laflif–
UIJS ,
ltwd
folio ,
flurt
alb·o, jiliqu
is
rotmu(ioriblls .
La premiere ef'pece ell commune
a
la Jama'ique,
&
daos plufieurs aucres contrées des climats chauds
de 1'
hm~rique'
o\l elle s'éleve
a
la hauteur de quinze
ou f'eize piés , & a le tronc droit , uni, & cou vert
d' une
écorce
blanchhrc ¡ du fommet du tronc, par–
rene des branches irrégulieres,
&
couvertes de feuil–
les d'un verd luifant; les tleu rs f'onr placée.> fur le
pédicu lc de.> feui lles, ell es font jaunes ;
&
extréme–
ment odoriféranres , elles fo nt fuivies de deux li li–
ques fourchues, qai conciennent les femences .
Ce genre de plaotes' a beaucoup de rapport
a
celui
du laurier-rofe, fous lequel quelques aureurs de bo•
tanique les ont rangées ; cependant leurs femences
n'ont point de duvet , ainfi , que celles J u laurier-ro–
Je; elles font feulement contenues tlam une fubnan-
. 'ce molle '& pulpeufe .
.
Le P. Plumier en a fai t une
el
alfe , en l'honneur
du dofreur J acques T héodo're , qo'on appelloi t
ta–
bertu mo11tamu ,
d' un village d' Allemagne ou il avoit
pris naiflance . C'étoi t un iles plus favdns botanines
de fon liecle'
~
il publia
a
Francfort
UJI
volume
¡,_
fol.
an.
1190.
qui contiene les figures de
2.210
planr s.
O n trouva la fecoude efpece
a
la V éra-C ruz, ce
fue le docreur Guillaume Houfion, qui en envoya
en Angleterre des fe mences qui multiplierenr cette
plante .
Miller . ( D
1)
TABE RNARJ.¡[j CoMOEDI.d'. ,
(
Dram. du Rom. )
comédie ou l'on incrodui(Ol[
le&
gens de la lie du
1
peu.
,
.
p e.
















