
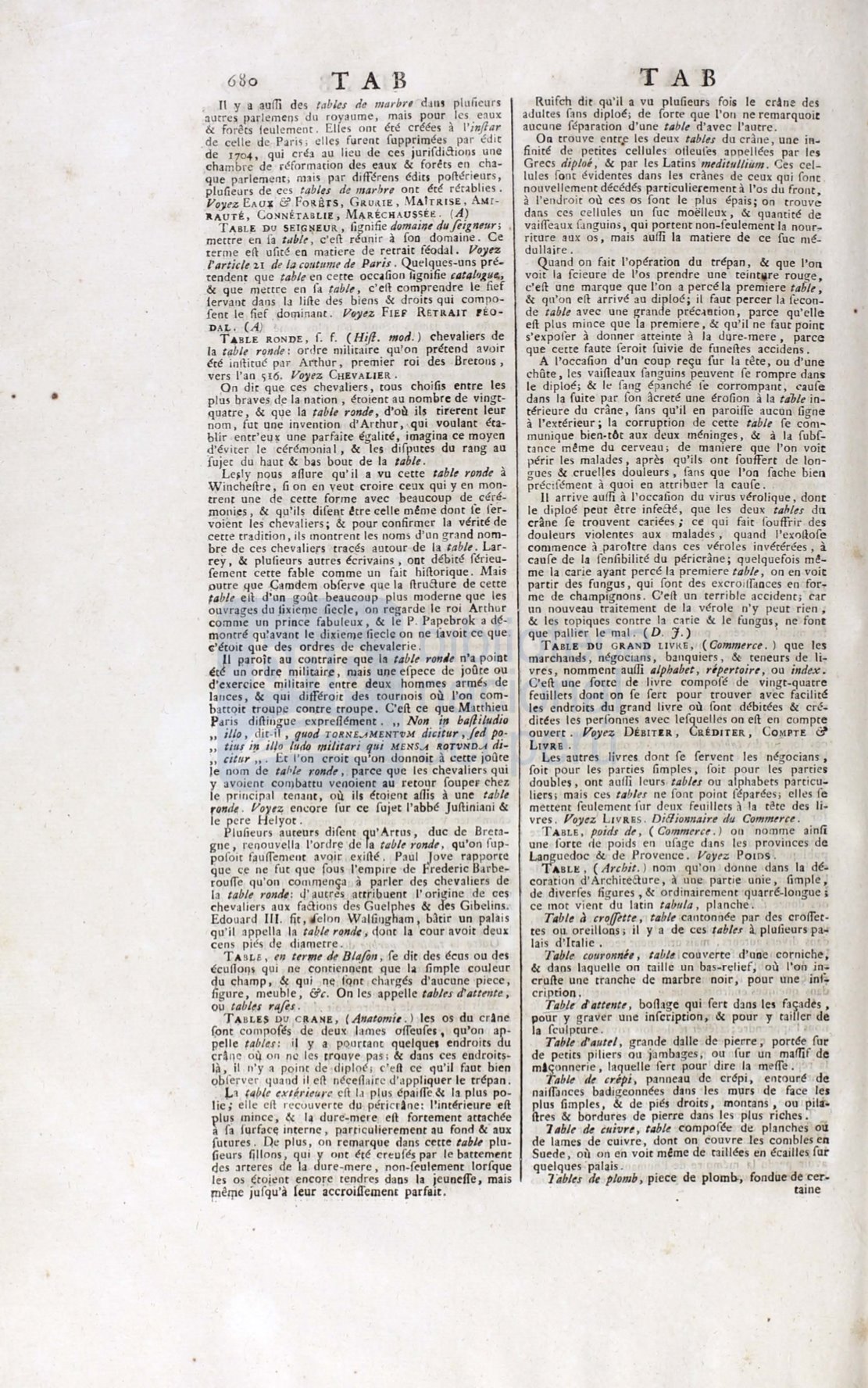
•
68 o
TAJ)
•
1\
y
a auffi des
tab/es de
marb~e
dms pluficurs
~utres
parlemeqs du roya ume, mats pour les enux
&
fon!cs fe ulemenc . Elles onr éré créées
a
l'inftar
. de celle de París ; el les furenc fupprimées par édi c
de
1704,
qui cnh a.u lieu de ces jurifdiéiions une
chambre de réformacrqn des
eau~
& forecs en cha–
que parlcmenr; mais par différens édies poflérieurs ,
plulieurs de ces
eablu de marhre
onc
éeé rérablies .
Voyez
EA lJ1t
&
Fo~ftrs,
GRut\11!, MAITRtSE ,
A~ou
llAUTÉ, Co:<NÉTABtre, M!l-1\tCHAUSSÉI! .
(A)
T ABt ,E
D U
SEIP!IEUR , fi¡¡nifie
domai11e t/ufiign•ur;
meerre en fa
t11ble,
c'efl reunir
a
foo domaine . Ce
cerme efl ufieé eo maciere de reeraic féodal .
Voyez
l'article
2.1
de la couttmu de París .
~elques-uns
pré–
cendenr qu e
tableen
cene occafion hgnilie
catalugu«.,
&
que' meerre en fa
¡ab/e'
c'efl comprendre le fief
iervant dans la lifle des biens
&
droics qui compo–
fenc le fief . dominanc .
V~"jez
FtEF RETili\IT PÉO–
DAl. .
(A )
T
_.BLE RONDE , f. f. (
Hift.
moti. )
chevaliers de
la
table ronde:
on!re milirarre qu on précend avoir
écé inflicué par Archur , premier roí des Brerons ,
vcrs l'an
S
16.
Voyez
CHEVALIER .
On die que ces chevaliers, cous choifis entre les
plus braves d.e la oacion , écoieoc au nombre de vingc–
~.uatre ,
& qt¡e la
¡able ronde,
d'ou
il$
tirerent leur
nom, fue une in venrion d'Archur, .qui voulant éca–
blír encr'et¡
~ un~!
parfaice égalicé, imagina ce moyen
~·~vicer
le cérémonia
1,
&
le5 difpuces du rang au
fu1er du haue & bas bouc de la
table.
Le¡ly pous a!lure qu' il a vu cecee
table
rpnd~
a
W incl)eflre ,
fi
on en veut croire ceux qui
y
en mon–
trenc une de cecee forme avec beaucoup de céré–
monie~,
&
qp!il~
dife
m
~ere
aelle mc!me done le fer–
voi(mc les' chevaliers; & pour confirmer la véricé de
cene cradicion, ils moncrenc les noms d'un grand nom–
bre de ces chevaliers cracés aucour de la
table.
Lar–
rey,
&
plufieurs aucres écrivains , ont débieé férieu–
fem enc cene fable comme un
fa ir hiflorique . M ais·
pucre
~ue ~amdem
obfer ve que la flruaure de cecee
fable
eil d'un gouc beauaoup plus moderne que les
ouvrag~s
du jixieq1e íiec)c, on regarde le roi Archur
comme un prince fabuleux, & le
P.
Papebrok a
dé–
¡nonrré qu:avant le dixieme fiecle on oe lavoit ce que
<>'écoit qne des ordres de chevalerie.
J
I
P.aroit au concraire que la
table ronJe
o'a point
éc
un ordre n¡ilitair¡:, mais une efpece de joOte ou
d'exercice milicaire entre deux hommes armés de
iauces,
~
qui ditféroit des co urnois ou l'on com–
ban qic troup!! con¡re cr,oupe. C'elt ce que Macrhieu
París diflingue expre!lément. ,
Non
Í!l
baf/iltidio
,
il/o ,
dit-if,
(jfiOd
TORNE..AMENTVM
dicitur, (ed po–
"
tÍII{
Í!l
il/o /urfo t¡tilitari q11i
MENS..A RqTVNl!..A
di–
"
cit11r
, .
Ec l'on croit qu'on
donnoi~
a
cecee joilce
le nom de
talole ¡:onde,
paree que les chevaliers qui
y avoienc con¡barcu venoienc au reto4r foupeF chez
le principal tenant, ou ils écoi¡:nc allis
a
une
tab/e
rond~ .
Voyez,
encore fur ce fu jet l'abbé Julliniani
&
le pere H elyoc .
Plulieurs auceurs diíent qu' Arcus, duc de Brera–
gne , renou vella l'ordr¡: de· fa
tab/e ronde ,
qu'on fup–
pofoi c
f~u!femenc
avqir
e~iflé.
Paul Jove rapporce
que ce ne fue que fous l'empire de frederic Barbe–
rou!fe qu'Oil COntOlenc¡a
a
parler
de~
chevaliers de
la
tab/e
rond~ :
<l'
~ucres
anribuent
1'
origine de ces
chevaliers aux faétions des Guelphes
&
des Gibelins.
Edouard
lfl.
!ir, .felon W alíi.ugham, b3tir un palais
qu'il appella la
tab,/e rqnd',
~onc
la 'cour avoit deux
cens piés
d~ di~~1erre .
T
A BU ,
en terf11e de Blafim ,
fe die des écus ou des
écu!lot¡s qui ne
concienn~nt
que la
limpie cou)eur
<!u c;hamp,
6}
qui
r¡«;
tqnc chargés d'aucune piece,
figure, mcuble,
&c.
On 1¡:¡ appelle
tab/es tl'attmte. ,
011
tablrs rafis .
· .
·
T -"BLES o u CI!-1\!IE, (
Anptomi1. )
le~
os du crAne
(onc compofés de deux
lames o!feufes, qu'on ap–
t?elle
(qbl~s :
i!
y,
a pqurranc quelques endroics du
cr~IJ~
ol¡ o n nc
l~s
r.rqn ye pas; & dans ces
endroit~-
1~ ,
il
n'y a poin c de diploé¡ c'efl ce qu'il fauc biep
qbferve r
q uan~
i! efl néce!lairc d'appliquer le crépan .
~a
(qp/e
CXI~neúrc
cfl la p(us épai!fe.& la plus po–
líe; elle efl recouverce du péricr1ne:
l!inc~rieure
elt
\'tu~
mince ,
&
la dure-mere elt fortement attachée
a fa fqrfa c<: interne , parciculieremenc au fond & aux
furures .
Qe
plus, on remarque dans
c~tce
table
plu–
(Jeurs f!llons, qui
y
onc écé crt ufés par le bartement
qes :1rceres de la dure-mere, non-feulement lorfque
les os étojent eneore cendres daos la jeuoe!fe, mais
P.'leqte jufqu'a feur
acc~oilfemeoc
parfait.
T A B
Ruifch die qu' il a vu pluueurs fois
le cr!ne des
adulces fans diploé; de force que l'on ne remarquoit
aucu ne féparacion d' une
table
d'avec l'aucre .
On crouve encr.e les deux
tables
du crane une iR–
Iinicé de p; rices cellules o!leut'es
.app~llée;
par les
Grecs
dtplo•,
& par les Lacms
medttu/llúm.
Ces cel–
lules fonc évidenres dans les cranes de ceux qui font
nouvellemenc décédés parciculieremenc
a
l'os du fronc
a
l'enJ roi c ou ces os font le plus épais; on
crouv~
dans ces aellules un
fue moelleux, & quancicé de
vai!feaux fJ nguins , qui portenc non-feulemenc la nour–
ricure aux os, mais aulli la matiere de ce fue mé–
dullaire.
Quand on fait l'opéracion du trépan, & que l'on
voic la fci eure de Pos prenclre une reine¡¡.re rouge,
c'efl une marque que l'on a percé la premrere
talile
& qn'on efl arrivé au diploé; il fauc percer la fecon:
de
tab/e
ayec une grande
~céc~ncion, .
paree qu'elle
efl plus mtnce que la prem1ere,
&
qu' rl ne fauc point
s'expoter
a
donner
.accei.n~e
a
la dure-mere' paree
que cecee fauce ferott futvte de funeltes accidens.
A
l'occalion d'un coup re'iu fur la rece, ou d'une
ch&ce, les vai!leaux fanguins peuvenc fe rompre daos
le diploé; & le fang épanché le corrompanc, caufe
dans la fuice par fon
~crecé
une érotion
a
la
ta'ble
in–
térieure du crane, fans qu'il en paroi(fe aucun tigne
a
l'extérieur; la corrupcion de cecee
table
íe com–
munique bien-rOe aux deux
ménin~es,
&
a
la fubf–
rance
m~me
du cerveau ; de man1ere que l'on voit
périr les malades, apres qu'ils onc fouffert de lon–
g ues & crueljes douleurs ' fans que l'on rache biett
préctfémeoc
a
quoi en aecribuer la caufe .
11
arrivc aulli
a
l'occation du virus vérolique' dont
le diploé peuc erre iofeété ' que les deux
eal>!u
dt~
cr~ne
fe crouvenc cariées;
ce
qui fair fouf!rir des
douleurs violentes nux malades , quand
l'exnt1ofe
commence :\ parolere daos ces véro les invécérées '
a
caufe de la fenfibil icé du péricrane ; quelquefois
m~me la carie ayanc percé la premiere
tab/e,
on en voit
partir des fungus, qui fonc des excro•ffaoces en for–
me de champignons. C'efl un terrible accidenc ; cae
un nouveau traitement de la vérole n' y pt:ut rien,
& les ropiques conrre la carie
&
le fungus, ne font
que pallier le mal .
(D. '] . )
'
TABLE DU GRAND LJVK&, (
Oommerce .)
que les
marchamls , négocians, banquiers ,
&
ceneurs de li–
vres, nommenc auffi
alphabct, r;pertoiu,
o u
index.
C'efl une force de livre compofé de vingt-quarre
feuillets done on fe ferc pour crouver avec facilité
les endroits du graod livre ou fonc débirées
&
cré–
dic~es
les perfonnes avec lefquell es on elt en compre
ouverc .
Voyez
DÉBITI:R, CII.ÉDITER, CoMFTE
&
LtVR&.
Les aueres
livres done fe
fervenc
les négocians,
foic pour les parcíes fim ples , foic pour les parries
doubles, onc auffi leurs
tablu
ou alphabecs parcicu–
liecs; ma is ces
tables
ne fonc poinc féparées;
ell~s
fe
meecenc feulemenc fnr deux feu illers
a
la
rece des li–
vres.
Voyez
Lt VRES.
Difliomzaire du Commercc .
T AStE,
poids de,
(
Commerce .)
on nomme ain!i
une force ele poids en ufage dans les pcovinces de
Laoguedoc
&
de Provence .
Voyez
Poms .
TABLI! , (
Archit.)
nom qu'o·n donne dans la dé–
coracion d'Archiceaure ,
a
une
parci~
unie, fimple,
de diverfes fig ures , & ord inairemene quarré-long:ue;
ce mor vienr du lacio
tabu/a ,
planche . ·
T¡¡b/e
a
crtiffttt~,
table
canconnée par des
c~orrec
res ou. oreillons; il
y
a de ces
tablu
a
plufitmrs pa,
lais d'lcalie ,
,
r
.
'
Table couronn¿e, tab/6
1
couv.erte d'uoe corniche,
& dans laquelle on taille un bas-relief; ou l'an in–
crufle une cranche de marbre noir, pour une
int;
cripcioo.
Tab
r
ti'
atttnt~,
bo!lage qui fert daos les fac¡ades ,
pour
y
graver une iofcription, & pour
y
raifle~
de
la fculpcure .
'
.
Tab/e
á'
1Jt1te/ ,
gcande dalle de pie
ore,
porcée fur
de pecics piliers ou jambsg:es , ou fue un maffif de
mlc¡onnerie , laquelle ferc pour dire la
m~!fe
.
Table de cripi,
panneau de crépi, encouré de
nai!fances badige.onnées dans les murs de face les
plus limpies, & de piés droits, moncans , ou ¡>il:r–
ltres
&
bordures de pierre dans les plus riches.
14ále de euivre, table
compofée de planches ou
de lame5 de cuivre, done on couvre .les combfes en
Suede, ou on en voic m
eme
de raillées en écailles fur
quelques ·palais .
1
1 ilbles de plomb ,
piece de plomb., foodue de
.cer~
came
















