
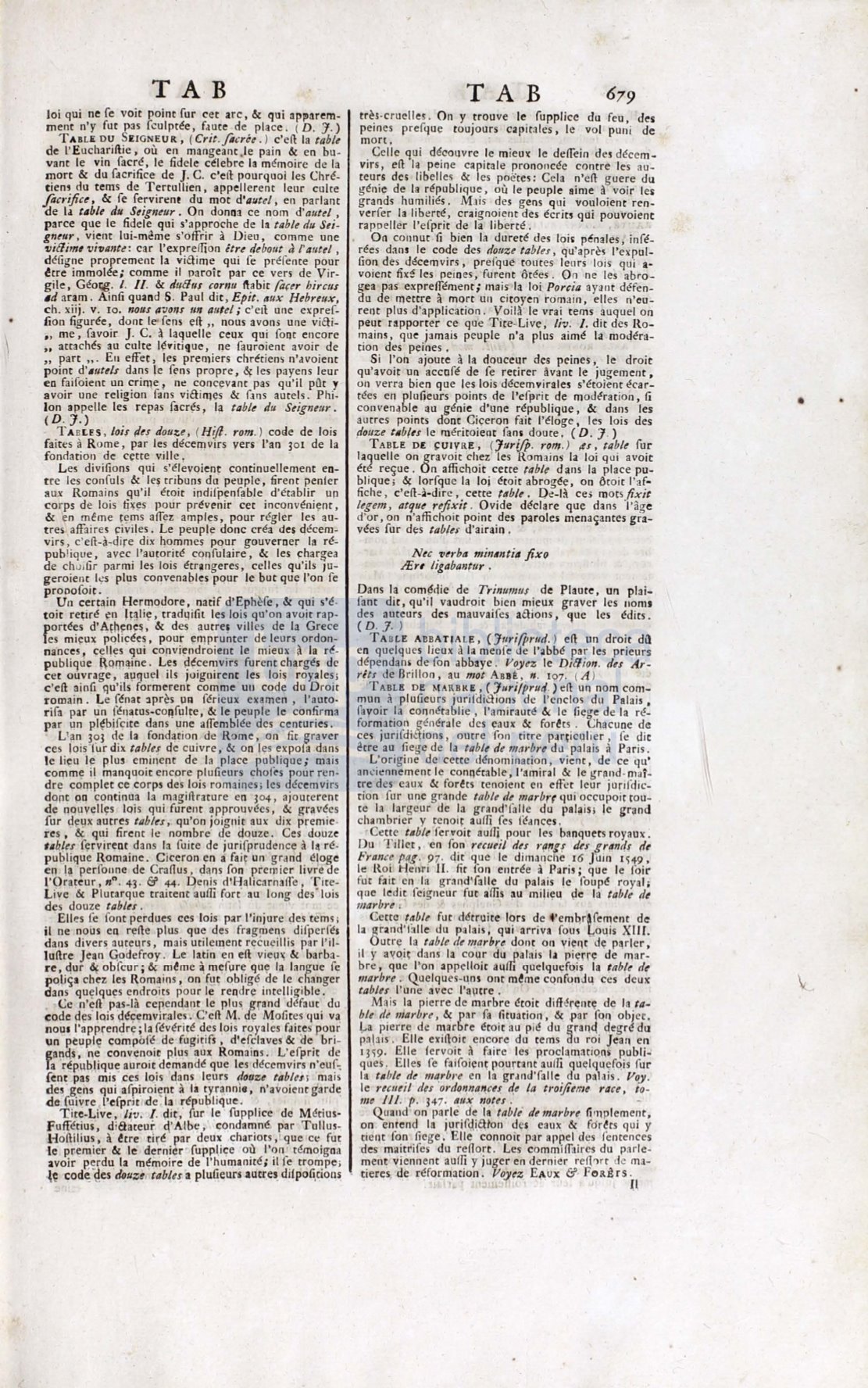
TAB
Joi qui ne fe voit point fur cet are,
&
qui apJ!larem–
menr n'y fut pas [culprée, fa ure de place . ( D .
J.)
TABLI!
ov
SI!IGNEIJR,
(Crit .focrée .)
c•en la
tabte
de l'E uchariftie, ou en
mangeanr.lepai n
&
en bu–
vanr le vin faeré, le fidele célebre la mémoire de la
mort
&
du facritice de J. C. c•en pourquoi les Chré–
tien! du tems de Terrullien, appellerene leur culee
focri.fice,
&
fe
fervir~nr
du mor
d'autel,
en parlanr
de la
t11blt du Seigt¡eur .
On donna ce nom d'
tmtd
,
paree que le fidele qui s'approche de la
table du
Sei–
gneur ,
viene
lui-m~me
s'otfrir
a
D ieu, comme une
viflimt ViVRIJU:
Car l'expre(fion
étre t/ebollt
a
/'atltt/,
défigne propremenr la viétime qui fe préfenre pour
~rre
immolée; comme il naroir par ce vers de Vir–
gile, Géor;g. /.
11.
&
dqflur COrl/11
ftabir
facer hircur
11d
aram . Ainfi quand
S.
Paul die,
Epit. ¡oux Hebre1¡x,
ch. xiij. v. ro.
nour ¡svotu un aufel;
c'etl une expref–
fton fig urée, done le fens eft , nous avons une viéti–
•• me, fgvoir
J.
C.
~
laquelll! ceqx qui [oqr encare
, arrachés au culee l\l•itigue, r¡e fauroienr avoir de
, pare , . En etfet,
l~s
pren1iers chrériens n'avoienr
point
d'lltltelr
dans le fens propre,
&
les payens leur
en faifoient un crin1e, ne concevanr pas qu'il pílr
y
avoir une religion fans viétinJeS
&
fJns aurels . Phi–
Ion appelle les repas
facr~s
1
líl
fable
ár•
Seigneur.
(D.
J.)
TuLES ,
/oir ¡/u
dout.e, {Hijl . rom.)
code de lois
faites
a
Rome, par les décell)virs vers l'an
301
de la
fonclation de
c~tte
ville,
·
L es divifions qui s'élevqienr ¡;ontinuellement en–
tre les confuls
&
le~
rribuns du peuple, lirenr penfer
aux
Romains qu'il étoit
iodilp~qf? ble
d'établir
un
corps de lois
tj~~s
pour prévenir cet
inconvéni~nr ,
&
~n
m
Eme
¡~ms aff~z ampl~s,
pour régler les au–
tres ,atfaires ¡:ivi!es. ¡_e peuple done créa
de~
qécem–
virs,
c' eft-~-c:lire
dix
~ommes
pqur geuveroer la ré–
publique, avec J!au¡orité
~QI]fulaire,
&
les
¡:hargea
de cho, fir parmi
les
lois
étr~ngeres,
celles qu'ils JU–
geroienr
I<;S
pl\15 !=OnvenabJes pqur \e but
QU\!
!'on fe
prooofoi¡.
·
Un
cerc~i11
Herll)odore , natif d'Ephefe,
&
qui s'é.
toit reciré ¡!n J¡ª lil!, crad9ifit les lois qu'on avqjr rap–
portées d'
A,¡h!!11~~,
&
de~
?Utre! vi!les de la Grece
les
mi~ux pqli¡:~es,
po\]r ell)prunter de leurs ordon–
nances,
~~~~~s
qui co¡JVi>ndroient le mieox
il
la ré–
publiqúe Ro!Jl:tine . Les ¡lécemvirs
furen~
chargés de
c et ouvrage , apq\lel ils joignirent les fois royales ;
c 'eft
ain~
IJU'ils formerent comme u11 code clu Droi r
romain. {.e fénat 1pres
\lR
férieux
ex~men
, !'auto–
rifa par \]n
(él]~tus-col!f!llfe,
&
le peuple le confirma
par ¡¡n
pl~bj[ci¡e
dans
un~
affembl ée des centuries .
L'ªn
303
de la
fond~!ion
de Rome, on fit graver
ces loif l'ur dix
tablef
qe cuivre,
&
on !es expofa dans
le lieu
1~
f!lus emiqept de la place
pu~lique;
mais
corp!J1~
i! manquoit encpre plu!ieurs
~hoks
pour ren–
dr~;
c
0
rp,plet ce corp! des
lois
romaiqes; les
~écemvirs
dqpt pn ¡:o!]tipua la magillrature en
304,
aJourerenr
de
!]q\lvell~s
lqis qui.furent approljvées,
&
gr~vées
fur
~~yx
autres
tabler ,
qu'on joignit aux dix prem ie–
res ,
~
qui firenr le nombre· de qquze. Ces douze
tll,k/rr
f; rvire!lt daos la fuire efe jur.ifprudence
a
1~
ré.
puqlique Romaine. C iceron
~n
a
fai~
un grand éloge
eq
'ª
·perfonne de Craflus, !ll\'IS fon premier livre de
1'9r~¡eur,
n".
43 ·
&
44· :qepls cllfialicarnafl'e,
Tir~Liye
&
Plurarque trairent auffi fort au long des lu1s
des douze
tab/u
.
'Elles
[e
font perques ces lois par l'injuTe !les tems;
il ne noils en l'l!fte plus que des frag!11e11s difperfés
dans di
ver~
aQ¡eqrs, mais uriletqent recueillis par l'il–
Iunre
Je~n
Godefroy.
Le
latin en
e~ viev~
&
barba–
re,
~uf ~
obfcur;
&-
m~me ~ m~(~~r~ qu~
la langue
f~
po,li~~
chez les
Rom~i~s ~
on
f!!~
obligé _de le_
~fianger
dans ·
qu~lqu~s ~~dror_rs
pour
1~
reqdre mce¡llgrble.
Ce n'eft pas-la
cer.~nda!lt
Le plus grand défaur do
co.de~~~s!oi~ M~~mvirale~.
C'c;ft
1\1.
~~
Mofites qui
v~
nousl'appfeQdr~;
la
fév~ri ¡é
!les \oís
r<~¡:ales fai~es
pour
un p!:l,lpiC<
co~pbf~
de·fugitifs , d•e(claves
&
de. bri–
gané\s,
'ne conveno19
Rl.us~u'\
Romarns. L'efprrt de
la
'ré(1Qblique auroit demandé que les décemvirs
n'euf~
fent' pas" mis ,ces
l~is
'dans
l~urs
douze tabler;
mais
de~· g~ÍlS
qui
afp¡roi~nt' ~
la.
rn~~ nle'
n'avoienc g'ardt;
d .e
Í\lÍ~re
[!efprit .deJ a républ1que.
Tite-Live,
tiv.
>[ .
die,' fur le ' fu pplice de M érius–
Futférius, dia áceur.
4'
Albe , co,ndamn6 par Tullus–
H cinílius.
a'
~ere
tiré par íleux chariots ,lque
Cl!
fue
Ie
pÍ'~mier
&
le
d~~nie~ fup~li~e o~
l'?n ' cémo,igna
avoir P.erdu la mémoire de 1 humamré; 11 fe trompe;
·\1:
¡;od~'Qes
'tiouz;$,·
table~
a plufieurs
~u~re~ dilpofi,tion~
TAB
tres-cruelles. On y trou ve le fupplice du feu, des
peines prefque toujours capitales , le vol pun r de
mort ,
·
Gel! e qui découvre le mieux le defl'ein des décem–
virs. en la peine capitale prononcée conrre les au–
teurs des libelles
&
les poeces : Cela n'eít guere du
génic de la république , oÍ! le peupie aime
~
voir les
grands humiliés . M .ds des gens qui vouloient ren–
verfer la liberté, craignoienc des écrits qui pouvoient
rappeller l'efprir de la liberté.
On
con nut fi bien la dureté des
lois
pénales, infé–
rées daos le code des
douze table1,
qu'apres l'expul–
fion des décemvirs, prelque routes leurs lois qui a–
voient tixé les peines, furent 6rées. O n ne les abro–
gea pas exprefl'ément; mais la loi
Porcia
ayanr défen–
Ciu de ll)ettre
a
more un cltoyen romain. elles n'cu–
rent plus
~·application . Voil~
le vrai
tems
auquel on
peur rapporrer ce que Tite-Live,
liv.
J.
die
des
Ro–
rmins,
que jamais peuple n'a plus aimé la modéra–
tiOn
des
pemes •
Si l'on ajoute
a
la douceur
des
peines, le droit
qu'avoi~
1111
accnfé de fe retirer dvant le jugement,
on verra bien que les lois décemvirales s'étoienr éca r–
tées en pluijeurs points eje l'efpl'i t de moMrarion, fi
conven4ble au génie d'pne république,
&
dans fes
autres points dom
Ci~eron
fait l'éloge , les lois des
{lo11ze t11b{n
le méritoient fa ns doure,
(D .
J.)
TABJ:.!!
D!:
t;UIYR!!,
(J urlfP.
rom.)
1
u,
tqble
fur
laquelle on gravoie chez ·les Romai ns la loi qui avoic
éré
re~ue .
On affichoit cerre
rabi~
d
~ns
la place pu–
blique ;
&
lorfque la loj étoir abrogée, on 6roir l'af·
fich e, c•en-ii-dire , cerre
ftlbl~
.
Oe-1~
ce.; mots
fixit
l~gem,
atr¡ue refixit .
O vide Melare que dans 'J•age
d'or, on n'aflicho ir point des
p~roles
menac¡antes gra–
vées fur
d~s
tab{u
d'airaiq.
Nec
'f~trba
mitt4nti4 fixq
.IEu
ligabantur
.
Dans la
com~cjie
de
Trinu{Jtltr
de l'laute , un plai–
fant die, qu'il vaudrpit bien
mieu~ ~raver
les uomJ
des auteurs des mauvaifes aétions
1
que les éd1ts.
(D.
J.)
TA U ~E
ABBATJAL¡!:, (
)11ri/]m11/.)
en Un droit dol
en quelques lieux
a
la menfe de l'abbé par les prieurs
dépendans
de
fo n abbaye.
Voyez
le
DiE!ion. ¡{u A.r–
rltr
de Brillan, au
mot
AsilÉ ,
n.
IQ7· (
4 !
· TABLI! D!!
HARBt<¡;:,(Jllrifim~t/. ) efluq nomcom
mun
a
plufieurs juri(diaions de l'enclos du Palais,
rayoir la connétablie. l'amirauré
&
le !iege de la ré–
formarion générale des eaux
&
for~rs
. Chacune da
ces ju rifdié\ions, ourre fon rirre parlicylier , fe die
erre au fiege de la
tqbie
de
111t1rbre
du palais
a
Paris.
L'origine de cecee dénominarion, viene, de ce qu'
an~icnnemenr
le connérable , l'amiral
&
le
gr~nd- rnai
rre
des
eaux
&
for~rs
renoient en etfet
le~r
jurifclic–
tion fur une grande
table
d~
mprbrr
qui oc¡:upqiccou–
re la largeur de la grand'falle qu palªis; !e ¡:rand
chambrier y tenoi¡ auflj fes lea nces ,
•Cene
t11ble
fervoi r aufii pour
les
banquecs rpyaux ;
Du Ti ller , ·en fon
rect~eil
du
t'(lll.f!
du
gr!!nth
¡{t
France
PM· 97·
qi r que ' le dimaqche
ró
Jui n
I )~9,
le Rot
t-{ci'n~i
II.
fir fon entrée
a
!lari!; que le lqir
fu e f-a ir e11 fa gra11d
1
falle tlu palais !e foupé royal;
qae
ledi~
feigneur fuo
af!i~
au
mi[i~ll
¡le la
table
r/t
marbn .
Cett<;
t'!ble
fue détruice lqrs de
4'e'1l~rArernent
de
la gcaJ]d'1311e du palais, q11i arriva fous (,.oqis
XIII.
Out
re
la
table de marbre.
done on yie11c
d~ p~rler ,
il
y
ayqi~
dans la ' coQr dupalais
1~ pierr~
de
m.ar–
bre ' que l'on appellnit aljffi quelquefQis la
rabie
dt
marb~e
.
Quelques-qns ont
m~
me cqnfqndq ces deu"
tab/er
!' une avec
1'~\Jtre .
Mais la pierre de marbre étoit
difiérr;nt~
de la
(a–
ble
d•
marbre,
~
par fa firuation ,
~
.par fqQ objet.
!-a pierre de n1arbre étoit
a
u pié du
graQ~
qegré du
pa,\ais·. Elle exinoi r
~ncore
du tems qu roi Jeaq en
r
JS9·
Elle íervoit
a
fai re les
p.rocl~rnatiO.I\1
p.ubli–
ques . Elles fe
faifoien~
pqurrant auf!i
qu~lqu~fqis
fur
la
t~tble
de
marb¡•e
en la grand'falle du palais .
Voy .
le
rec11eil
der
'ordqn.n~~:n.c~{
t(e (a
froijiem~.
race,
to-
me
111.
p.
347·
op.x;
~qfer .
-
_ Q u·and on
pa~le
de la
(a,bli tf.e marbn
fín¡plement,
on en!end la
¡urifc~i.éHon d~s
eaux
&
fdr~rs
qui y
c;ient fon íiege: Elh; CO(lnoir par
app.eld~s
fenrences
l:f·es
m~itrifes
du reflo,rt. Les commíffaires du parle–
mene viennent auffi y juger en dernier reí{rlrr de ma–
tiere' de réformation .
Poyez
E~ux
&·
F oR.Ers .
• •
••
'
,·
1
u
•
















