
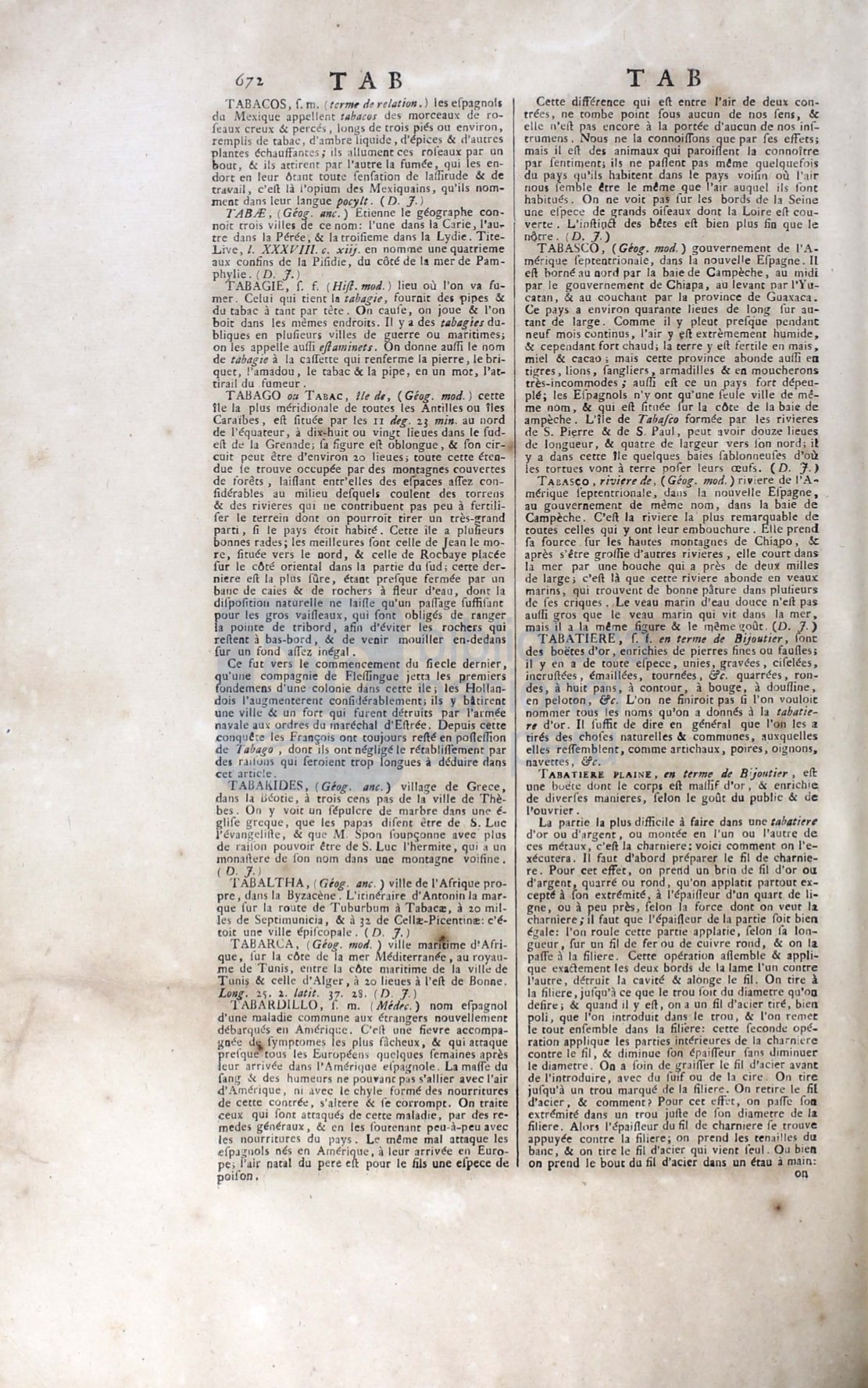
TAB
TABACOS ,
f.
m. (
tcrm~
de relatiun.)
les efpagnols
du Mexiquc appcllent
t~bncos
des morceaux de ro–
feaux creux
&
percés , longs de trois piés ou enviran,
remplis de tabac , d'ambre liquide, d'épices
&
cl'aucrcs
plantes échauffanres ; ils allument ces roCeaux par un
bour ,
&
ils attirent par l'autre la fumée, qui les en–
dore en leur ót:Jnt rourc fenfation de laffirude
&
de
trawail, c·en
lil.
l'opium des Mex iquains, qu'ils nom–
m
enr dans leur langue
po~'Jit .
(D .
J.)
TAB.IE,(
Géog.
~n,·. )
Ecicnne le géographe
con~
no
it erais vi lles de ce nom: !'une dans la Carie, l'au.
rre dans la Pérée,
&
la rroifieme dans la Lydie . Tite–
L ive, /.
XXXVII!.
c. xiij.
en nomme une quatrieme
aux coofins de la Pifidie, du coté de la mer de Pam–
phylie . ( D.
J.
J
TABAGIE, f.
f.
( Hijl.mod.)
lieu oill'on va fu–
mee . Celui qui tient la
enbagie,
fournir des vipes
&
du tabac
a
tane par tete. On caufe, on joue
&
l'on
boir dans les memes endroits. Il
y~
des
tiZÚIIglu
du–
bliques en plufieurs vill es de guerre ou maririmes;
on les appelle auffi
ejlamituts.
On donne aulli le nom
de
tabagi6
a
13 caifetre qui renferme la pierre ' le bri–
quet, l'amadou , le rabac
&
la pipe, en un mor, l'at–
tirail du fumeu r .
T AllAGO
o:•
TABAC ,
u~
dt,
(
Géog. mod.)
cette
!le la plus méridionale de roures les Antilles ou iles
Cara"ibes' en
íitUt~e
par les
II
d~g.
23
min.
au nord
de l'équateur '
a
dix-huir ou viogr lieues daos le fud–
ell de la Grenade; fa figure en obloogue,
&
f'on cir–
cuir pcut erre d'cnviron
10
licues ; coure cette éren–
due (e trouve occupée par des momagnes couvertes
de lorers , lai!lant entr'elles des er'paccs affez con–
lidérables au milieu defquels coulenr des
rorrens
&
des rivieres qui ne conrribuem pas peu
a
fereili–
fer le terrein dom on pourroie tirer un rres-..rand
parri, fi
le pays écoir habiré. Cetee !le a
plu~eurs
bonnes rades; les meilleures fonr celle de Jean le mo–
re, ficuée vers le nord,
&
celle de Rocbaye
p\ac~e
fur le cóté oriental dans la partie du fud; cerre der–
niere en la plus fare' étsot prefque fermée par un
banc de caies
&
de rochers
a
fleur d'eau ' done la
difpofieiou narurelle ne lai!le qu'un paffage fuflifanr
pcmr les gros vai!leaux, qui font obligés de ranger
la poinre de eribord, afio d'éviter les
rochers qui
renenr
a
bas-bord,
&
de venir mouiller en-dedans
[ur un fond affez inégal.
Ce fue vers le commencemem du fiecle dernier,
qu'une compagnie de Fleffingue jerc3 les premiers
fondemens d'une colonie dans cecre ile; les H al lan–
dais l'augmeneerem confitlérablemem ; ils
y
bl
tireneune villc
&
un fort qui furenr déeruirs par l'arm.ée
navale au • ord res du maréchal d' Enrée. Depuis cecee
,conq u ~ce
les
Fran~ois
ooc roujours rellé en po!leffion
d e
Tabag o
,
done ils onr négligé (e rérabli!lemenr par
des radons qui feraiene trap fongues
a
déduire clans
c et artJcle .
T ABAKIDES , (
G;ug. anc. )
village de Grece,
dans la
ll~atie,
a
rrois cens pas de la ville de The–
bes. On y voie on (épulcre de marbre dans uncc- é–
glife greque, que les papas difent eere de S. Luc
l'éva ngeline,
&
que M . Spon
foup~onne
avea · plus
de railon pou voir étre de S. Loe
l'h~rmice,
c¡ui • un
monanere de fon nom daos une monragne voifine.
( D.
J. J
TABALTHA, (
Géog. anc. )
ville del'Afrique pro–
pre , dans la llyzacene . L'ieinéraire d'Aneonin la mar–
que fur la rouee de Tuburbum
a
Tabacz,
a
2o mil–
les de Septimunicia,
&
a
32
de Cellz-Piceocinz: c'é·
toir une ville t!pifcopale. (D.
J.
J
TAllARCA ,
( Géog. mod. )
vílle mad'lime d•Afri–
que, fue la cóce de la mer Médirerranéc, au royau–
me de Tunis, entre la cóte maritime de la ville de
Tnni~
&
celle d:Alger,
a
20 lieues
a
l'en de Bonne.
Long.
2~.
1 .
latll.
37·
2 8.
( D .
J.)
TABARDILLO,
f.
m.
(
MMrc. )
nom efpagnol
<l'une maladie commune aux écrangers nauvellemeor
débarqués en Amériq•:c. C•rn une fievre accompa–
g née do¡
fymprome~
les plus facheux,
&
qui actaque
prefque tous les &uropécns qu clques femaines apres
aeur arrivée daos l' Amérique efpa"nale . La maffe du
fang
& .
des humenrs ne pou•anc
p~s
s'allier avec l'air
d 'Aménque , m avec le chyle formé des nourritures
de cecee concrée, s'altere
&
fe corrompe. On rraire
ceax qui fonc acraqués de cecee maladie, par des re•
medes généraux,
&
en les (ouccnane "peu-ii-peu avec
les nourricu rcs du pays. L(' meme mal atraque les
efpa~nols
nés en Amérique ,
/¡
leur arrivée en Euro–
pe; t'air nar"al du pere en poar le ñls une efpece de
pClifon .
'
TAB
Cecee dilférence qui en entre l'air de deux con–
trées , ne combe poinr fous aucun de nos
{ens,
&
elle n•en pas encare
a
la porrée d'aucan de nos inf–
rrumeos . Nous ne la connoiffons que par fes elfers;
mais il en
des
animaux qui paroillenr la conno1rre
par fencimenr; ils ne pal!enr pas
m~me
quelqnefois
da pays qu'ils habieent d3ns le pays voifin oil l'air
nous femb le
~tre
le
m~me
que l'air auquel ils font
habicués. On ne voir pas fur les bords de la Seine
une ei"pece de grands aifeaux done la Loire en cou–
vertc . L'inniva des
b~ees
en bien plus Jiu que le
ni)rre . ( D.
] .
)
TABASCO, (
Giog. mod. )
gouvernemenc de l'A–
mérique !epeenrrionale, daos la nouvelle Efpagne. ll
en boroé 3U oord par la baie de Campeche, au midi
par le gouvernement de Chiapa, au levanr par !'Yu–
catan,
&
au aouchanr par la province de Guaxaca_
Ce pays a enviran quaranre lieues de long fur au–
rant de
large . Comme il y pleur pref<jue pendant
neuf mois C00tinus, i'air
y
en extremement humide,
&
cependanr fort chaud; la terre
y
en fertile en mais.
miel
&
cacao ; mais cette province ahonde aulli ea
tig res, lions, fangliers, armadilles
&
ea moucherons
tres-incommodes; auffi ell
ce
un pays forr dépeu–
plé¡ les Efpagnols n'y onr 9u' une
r~u le
ville de mé–
me nom,
&
qui en licnée (ur la córe de la baie de
ampeche . L'1le de
Tabafio
formée par les rivieres
de S.
Pi~rre
&
de S. Paul, peut avoir douze licues
de longuenr,
&
quatre de largeur vers (on nord ; i!
y a dans cecee Jle quelques baies fablonneufes d'ou
les corcues vone
a
rerre pofer leurs ccufs.
(D.
J.)
T
A EAS~o,
rivitrt dt ,
(
Giog. mod. )
riv iere de
1'
A•
mérit]ue feprentrionale, dans
la nouvelle Efpagne,
au gouvernement de meme nom' dans la baie de
Campeche . C'ell la riviere la · plus remarquable de
cauces celles qui y onr leur embouchure . Elle prend
fa fourcc fur les hauces mooragnes de Chia,po,
&
apres s'écre groffie d'aurres rivieres, elle courr dans
la mer par une bouahe qui a pres de deux milles
de large; c'ell la que cecee riviere abande en veaux:
marins, qui rrouvent de bonne plture dans plulíeurs
de fes criques . Le veau mario d•eau douce n•en pas
aulli gros que le veau marin qui vir dans
la mer.
mais il a la
m~
me figure
&
le n¡eme goür .
(D.
}.
)
TABATI ERE,
f.
f.
m
termt
d~
8ijo11titr,
font
des boeres d'or, enrichies de pierres fines oa fa u!les;
il y en a de roure efpece, unies, gravées , cifelées,
iocrun~es,
émaillées, rournées ,
&c.
quarrées , ron–
des'
/¡
huir pans,
¡¡
aoncour'
a
bouge'
a
dou!line,
en pelaron,
&c.
L'on ne finiroir pas fi
l'on vouloit
oommer rous les noms qu'on a dcinnés
a
J.
tabatú–
rt
d'or. 11
tuflit de dire en général que l'oo les a
rirés des chafes naturelles
&
communes,
~uxquelles
elles reffemblenr. comme arrichaux' poires; oignons,
navecres,
&c.
·
TAllA
TI
ERE nAJNE,
tll
ttrmt
dt
J'1iott1Ífr ,
ell:
l!ne buece dont le corps en maf!if d'or,
&
enrichie
de di
ver
fes manieres, felon le goíle du public
&
de
i'ouvrier .
La patrie !a plus diflicile
a
faire dans une
t¡¡batitu
d'or ou d'a rgenr, ou moncée en l'un ou l'auere de
ces mécJux, c'ellla charniere: voici commenr on l'e–
xécurera . 11 faur d'abord préparer le fil de charnie–
re. Pour cer effe·r, oo preñd un brin de Ji! d'or
Oll
d'~rgen~,
qu3rré ou rpnd , qu'on applarir parrour ex–
ceprt!
a
fon extrémité'
a
l'épai!Teur d'an qu1rr de li–
gne, OU a
P.CUptb; , felan la force dant an veur la
charniere; ti faur que l'épai!leur de la pareie foir bien
égale: l'on roule cerre parrie applarie, Celan
(j¡
lon–
gueur, fur on fil de fer ou de cuivre rond,
&
on la
paffe
ii
la filiere . Cecee opéracion a!lemble
&
appli–
que exaélement les deux bords Je la lame l'un canrre
i'aurre , détruir la cavicé
&
alooge le fil. On rire
a
la filiere, jufqu'a ce que le rrou foJC du diameere qu'oa
defin:;
&
quaud il
y
el!, on a un fil d'ader ricé, bien
poli , que l'on ineroduie dJns le trou,
&
l'on remet
le rour enfemble dans la filiere: cerre feconde opé–
rarion applique les parries incérieures de la charniere
conrre le fil,
&
diminue fon, épaiffeur fans diminuer
le diamerre. Oo a foin de ¡¡-raiffer le fil d'acier avant
de l'inrraduire, avec du iutf ou de la cire . On cire
jufqu~a
un croo marqué de la filiere. On retire le fil
d'acier,
&
commenn Poor cer elfer, on paffc foQ
exrrémiré dans un rrou jalle de fon diamerre de la
fil iere. Alors p¿pai!leur du fil de charntere fe trouve
appuyée cotme la filiere; oo prend les tenail les du
banc,
&
on tire le fil d'acier qui viene feul . Ou bien
on prend le bout du fil d'acier dans un érau
a
mai n:
on
















