
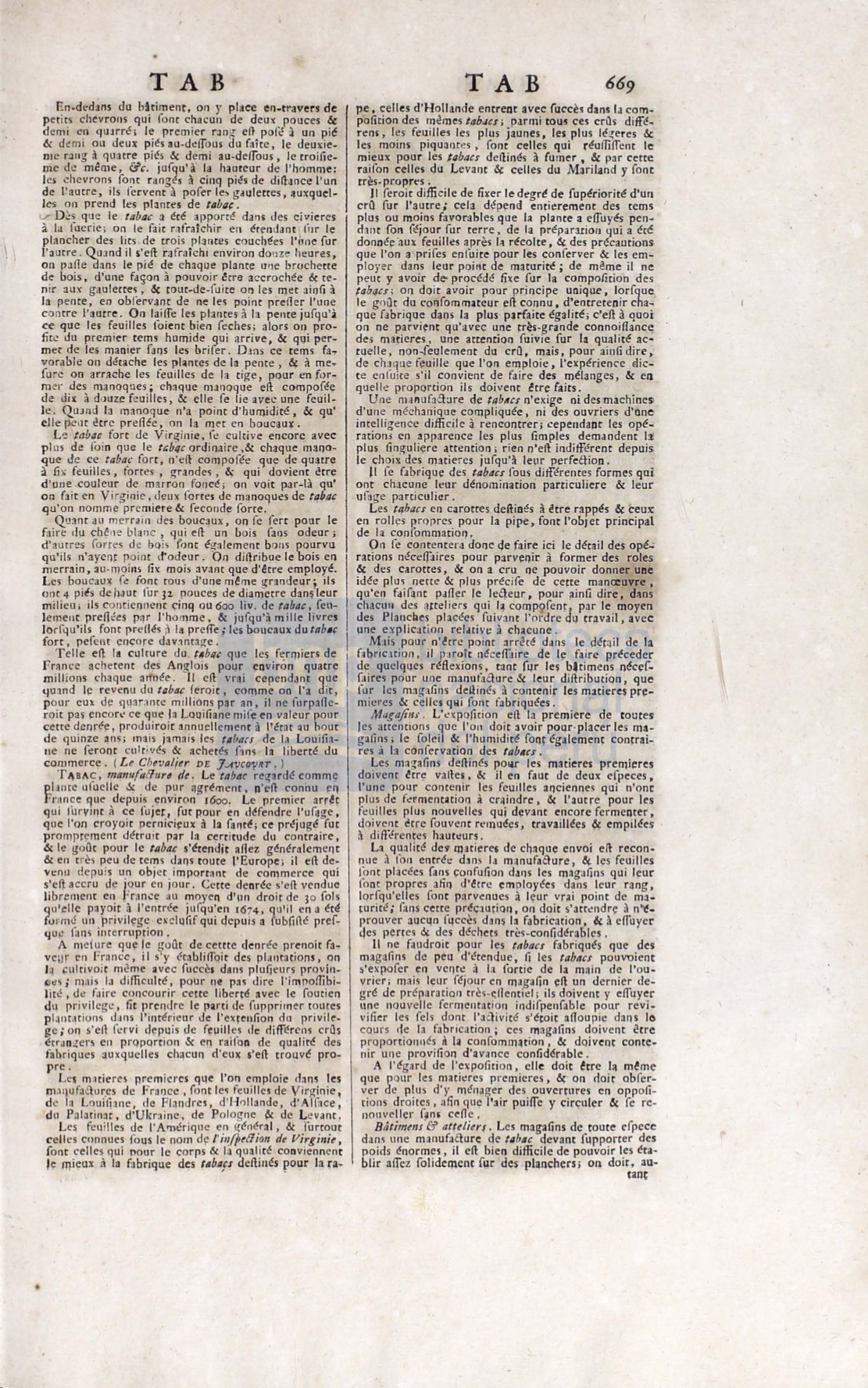
\ \
'
TAB
En-dedans du Mrimenr, on y place en-travers de
perics chevrons qui fonr chacun de deux pouces
&
demi en qulrré; le premier ran¡¡ el} poli!
a
un pi6
&
d~mi
ou deux piés au-de{fous
a
u faire, le deuxie–
me rang
~
quarre piés
&
demi au-de{fous,
le
rroilie–
me de
mEme,
&c.
jufqu·~·
la haureur de l'homn¡e:
les .:hevrons fonr rangés
a
cinq piés de dilhnce l' un
de l:aucre' ils rervenr
a
pofer le> gduletres'
~u:-¡quei
Jes on prend les plantes de
tab11c .
v-
D~s
que le
toba,·
a écé apporré dans des eivieres
a
la (ucrie; on le faic rafraichir en érendanr t'nr le
plancher des lirs de rrois planees
enucl¡~es
l'hne fur
l'aurre . Quand il s'eft rafra1chi environ douzr.
he
ures,
on pafle ilans le pié de chaque planc¡: une brochetre
de bois, d'une
fa~on
a
pouvoir
~era
accrochée
~
re–
nir aux gaulecres,
&
¡om-ile-fuire oo les mee aioíi
a
la J'lenre,
en
obl'ervar¡r de ne les poinr prefler Pune
conere l' aucre . On lailre les planees
a
la pence jufc¡u'a
ce
que les feuilles foient bien feches ; alors 01¡ pro–
tire du prem ier tems hurnide qui arrive,
&
qt¡i per–
mer de les maoier far¡s les brifer . 0 dns ce tems
fa~
vorable on dérache les planees de la penre,
&
a
me.
fu re on arrache les fí!uilles de la rige, pour
en
for–
mer des
m~
naques¡· chaqt¡e
manoqt~e
eft
compoíé~;
de Jix
il
douzc feui les,
&
elle íe lie avec une feuil.
le.
QuJnd la n¡anoque n'a poinr d'humi<lité,
&
c¡u'
elle ¡Jcur
~trc
preflée, on la mee en boucau;.
Le
rabilo
fort de V irginie,
fe
cultive encore avec
pl us de {oin que le
tt;bqc
or<!inaire ,& cnaque mar¡o–
que
de
ce
tabap
íort, n'eft compoíée c¡ue
ele
qu~tre
a
li• feuilles' forres ' grandes'
~
qui dovient erre
d'une .couleur
de
marron fon cé ; on voic par-la qn'
on
fait en Virginic, cleux forres
Je
manoques de
tq/¡pc
qu'on nomm e premiere
&
íeconde (orre.
Quanr
au
merrain des boucaux, on fe íerr pour le
fai re
du
chl!n e blanc ' qui
en
un bois
fans odeur;
d'aurre&
forr~s
de bois ·ronr égalemenr brms pourvu
qu'ils n'ayen¡ point ctodeur . On di(lribue le bois en
merrain, au-rnoins fix mois avanr que d'6tre employé.
Les boucau¡¡ fe fonr rous d'une
m~me
g randeur
¡
ils
onr
4
piés de
na
ue lür
j:Z.
pouces de diao¡crre
dan~
leur
milieu ; ils
conricnnen~
.;inq ou
6oo
liv. de
{obac,
fen–
Jemenr
preiJ~es
pqr l'homme,
&
jufqu'~
m ille livres
Jorfqu'ils fonr pr-e(fés
~
la prelfe;
l~s
boucaux pu
tnb•c
forr, pefenr
>n~ore
daunrage.
Telle
e~
la culture ilu.
t11bo;
que les ferr¡¡iers de
Frant·e acherenc des Anglois pour
~qviron
quªtre
millions chaque artnée.
11
cft vrai cependan,r que
quand
11!
revenu du
tabac
feroic, cornme on l'a die,
pour cux
d~
ql!aranre millions par. an, il ne furpafle–
roit pas
encor~
ce que la ¡..ouifiane
mil~
en 11aleur pour
cecee
denré~,
produiroir anqu¡:llement
a
l'érar
~u
hour
de quinze
~ns;
mais jamais les
f{lbo:s
de la Louifia–
ne ne feronr culcivés
&
acherés fans
la
liberté du
commarc~
. (
L~ Cb~va!itr
DE J.-tVCPi'RT
. )
T
<\B<\C,
1!1f!nu(ofluN
rl~,
Le
tabac
re!l'ardé
comrn~
piJnte ufuelle
~
de pur
~grémcnc,
n'ell
conil\l
~11
France que dept:!i6
~nviron
I6oo.
Le premier arr!!c
qu i l'urvil)c
a
ce fujer. fue pour en défendre
l'uf~ge'
que l'on croyoic pe·rnkicux
a
la
f~ljt~;
ce préjugt! fur
prompr~rnenc
dérru it par la
c~rricude
du conrraire,
&
le gour pour le
tabf!c
s'étepdic a(]ez généralemeqr
&
en eres peu de cems darJs rouce
~·Europe;
il ell de–
v~nJJ
depuis un objet Í!IJPQrtanc de cornmerce qui
s'e~ acc~u
¡l(! i_our en jour.
<;er~e
denrée s'efl vendue
librem~nr
en
tr~nce
au moyen d'pn droir de
30
fols
qu•.elle payoir
1i
l'encrée jufqu'en
1674,
qu'il en a été
fo r-mé un
privil~;ge
e•duíif qui <!epuis a tubfillé
pr~f
c¡u¡! tans inrerruprion.
A
me{ ure <¡U\! le gout de ceme denrée prenoit fa"
vcur en France, i
1
s' y
ét:~blilroir de~
planracior¡s, 011
Jq
¡;ultivoic rneme avec fucces dans plu{jeurs provln–
MS ;
mais la difficulté, pqur ne pas dire l'impoffibi–
liré , de fnire concourir cene liber¡t! avec le fourie11
<!u
privilege, lit
pr~11<lre
le parti qe fupprirner tomes
plq nt~rions
dans
l'inré~ieur
de l'exreníion du privile.
ge; Ol) s'ell fervi Q(!puis de feuilles de diffl!rens cr(\s
écr;~neers
en prqpqrrion
&
e11 railbn de qualicé des
fabriques auxquelles
c~~cuq d'eu~
s'ell
trouv~
pro-
pre.
·
Le1 rn:
Hieres
p~emieres
que l'on emploie dans les
PJ3t!Uf;tél
:ur.esde FraQCC, Íbnt le• feuilles de Vivginie
1
de la Lo
uif!ane,
de
Flandres, d'H nllandc, d' Al f.1ce,
du
P~larinar,
d'Ukraine, de Pologne
&
de Levanr .
Les feu illes de I'Aroérique en ({énéral,
6t
furcout
cell es connues lous le norn
d~
finfi¡rflion
d~ Virgini~,
font celles qui pour le corps
&
lá qual icé cooviennent
~~ JI)Í~UX
a
la f3brique d¡;s
(llbll¡!
deftinés pour la ra.
TAB
pA:, celles d'Hollaode entrene avee fucces dans la com–
poíirion des
mernes
tqbacs;
parmi tous ces crüs diffé–
rens, les feuilles les plus jaunes, les plus
lé~eres
&
les moins piquaores , fonr celles qui
réuffilfenr le
mieux pour les
ltlbacs
deflinés
a
fumer •
&
par cecee
raifon celles du LevarH
&
celles du Mariland
y
íont
tres.propr.-s.
JI feroit difficile de
fi~er
ledegrt! de fupériorité d'un
cr(l fur l'aurre; cela
Mp~nd
enrieremenr des rems
'
plus ou moins favorables que la planee a e{fuyés pen–
dant fon (éjour fur terre, de la prépar:uion qui a éré
donné~
·au• feuilles apres
1~
récolte,
&
des précaucions
¡¡ue l'oo
a~prifes
ent'uire pour les cooferver
&
les em–
ployer dans leur
poi~t
de maturité; de n¡@me il ne
peur y avoir de- procédé fixe fur la compofirion des
{qbqcs;
on doir
avoir
pour prir¡cipe uniquf', loríque
le goQc du cpnfommateur en cor¡nu. d'encrecenir cha–
que fabriql!e daos la plus par(aite égalité; c'efl
a
quoi
ón ne parvirnt qu'ave<: uoe
cr~s.~rande
connoiflance
des
matieres, une artention fuivte fur la qualité ac–
tuelle, non-feulemenr du erO, mais, pour ainli dire,
de
ch;~que
feuille que l'on emploie, l'expérience dic–
te enfuire s'il conviene de faire des mélanges,
&
en
quell•! proponían ils doivenr
~ere
(aits.
Une manufaél:are de
tl/b!l&t
o'
exige ni des•machineS>
d'une méchanique cornpliquée, ni des ouvriers d'one
intelligence di.fqc(le
a
ren<!Ontrer; cependant les opé–
rarion; en ap¡>arence les plus íimples demandenr
11'
pll)s
finguli~re
arrention; rien n'efi indifférent depuis
le
choi~
des marieres jufqu'a leur perfeétion .
U
fe
fabr-iqu~
des
tabacs
fous différentes formes qai
ont chacunc lt:ur dénominarion parriculiere
&
leur
ufage parriculiar.
Les
tabau
en carotres dellinés
a
~rre
rappés
&
ceux
en rolles ¡>rnpres pour la pipe, font l'ob¡et principal
· ¡!e la coplommatior¡,
On
fe contenrera done eje faire ici le dérail des opé:
rations nécelf:lires pour parvenir
a
former des roles
&
des carorres,
&
on a cru c¡e pouvoir donner
une
idée plus l)erte
&
plus précife de certe manreuvre,
qu'en
f~if'ant
pafler le leé}eur, pour
~infi
dire,
d~ns
chacun des
~rteliers
qui
1~
cqn¡p<;>fen¡
par le moyen
des Plaucbes placées fuivant l'ordre
dll
rravail, avee
!Jne explicatinn •·elarive
a
d¡acune .
Jl4ais paur
n' ~rre
poinr
arr~ré
dans
le
¡lé¡~il
de la
fab•icarion, il parolt nécelfaire eje
11!
faire préceger
de quelqt¡es réllexioc¡s, rant fL!r les b•cimens
néc~f
faires pour une manufaél:ure
&
leur diftriburion,
qt~e
fur
les maga!ins del!inés
a
coneMir les maciere$
pr~mieres
&
celles qai font fabriquées .
ltfagafi¡¡,· .
L'éx pQf¡cion e(l: la prerniere de touees
les acrenrions que Pon doir avoir pot¡r·placer les ma–
gaíins; le foleil
&
l'humidiré raijr
ég~lemen¡ coner~i
res
a
la coníervarion des
toblfct.
Les magai¡ÍlS defiinés po01r les
rnarie~es pren1i~res
doivenr
~rr~
valles,
&
il
en faur ele deux efpeces,
l'uc¡e pour
~onrenir
les feuilles
ac¡~ienqes
qui n'onc
plus de
fé~mentation ~ cr-~indre,
&
l'aurre pour les
feuilles plus nouvelles qui devane encare fermenrer,
dqivent erre fouvent
rer¡¡ué~s,
rravaillées
&
empilée~
a
diflC!rences haucc:turs.
· La quaiÍté
de~ ·QJati~res
de
d¡aqu~
envoi efl recon–
nue
il
fou enrrée d!ns la
m~nufaél:ure, ~
ll!s feuilles
tone placées fans ¡;onfufion daus les rnagaf¡us qui lcur
foar propres afic¡
d'~rre ~mployées
dans leur qng,
lqrfqu'ell~s
font parvenues
a
l~ur vr~i
point de ma–
¡urité; fans cene précau¡ion, or1 doir
s'atr~ndr-e
il
n'c!–
prouver aqct¡n fqcces dans la fabricarion'
&
a
e(fuver
ejes penes
&
des
déc~ecs tres-con{jdér~&les
,
'
11
ne faudroir pour les
ttrbacs
fabriqué$ que ¡les
m~gafins
de peu d'étendue, fi
les
tabacs
pouvoient
s'expofer
~n veqc~ ~
la fortie de la mijin de l'ou–
vrier; rnais leur féjour en rnaga(jn cft un
derni~r
de–
gré de préparation
rres-~flentiel ;
ils doivenr y e{ft¡yer
une nouvelle ferrnenracion indiípeuíable pour revi–
vifier les fels danr l'auivité s'étoit af!oupie dans le
CQUI'S eje
la fabricatÍOn ; ces magafins doivent etre
p•oporrionués
a
1~ confomrn~rion.
&
doivenc conte.
nir une provifion d'avance coníidérable.
A
l'égard de
l'e~ poficiotl,
elle doit
~tre
la meme
que pa ur les
mati~res
premieres,
&
on cloir abfer–
ver de plus d'y
n1éq~ger
des ouvcr¡ures en oppofi–
rions droites, afinque 1•air puilfe y
cin;ul~r
&
(e
re–
nouveller
r~ns
cefle.
Batirl!mJ
&
attelitr~.
Les maga!ins de coute cípece
dans une manufaél:ure eje
tllbac
qevant
ft~pponer
des
poids énormes' il en bien dillicile de pouvoir les éta–
blir aífez folidemenc
fqr
des planchers; oq doic, au-
tan'
















