
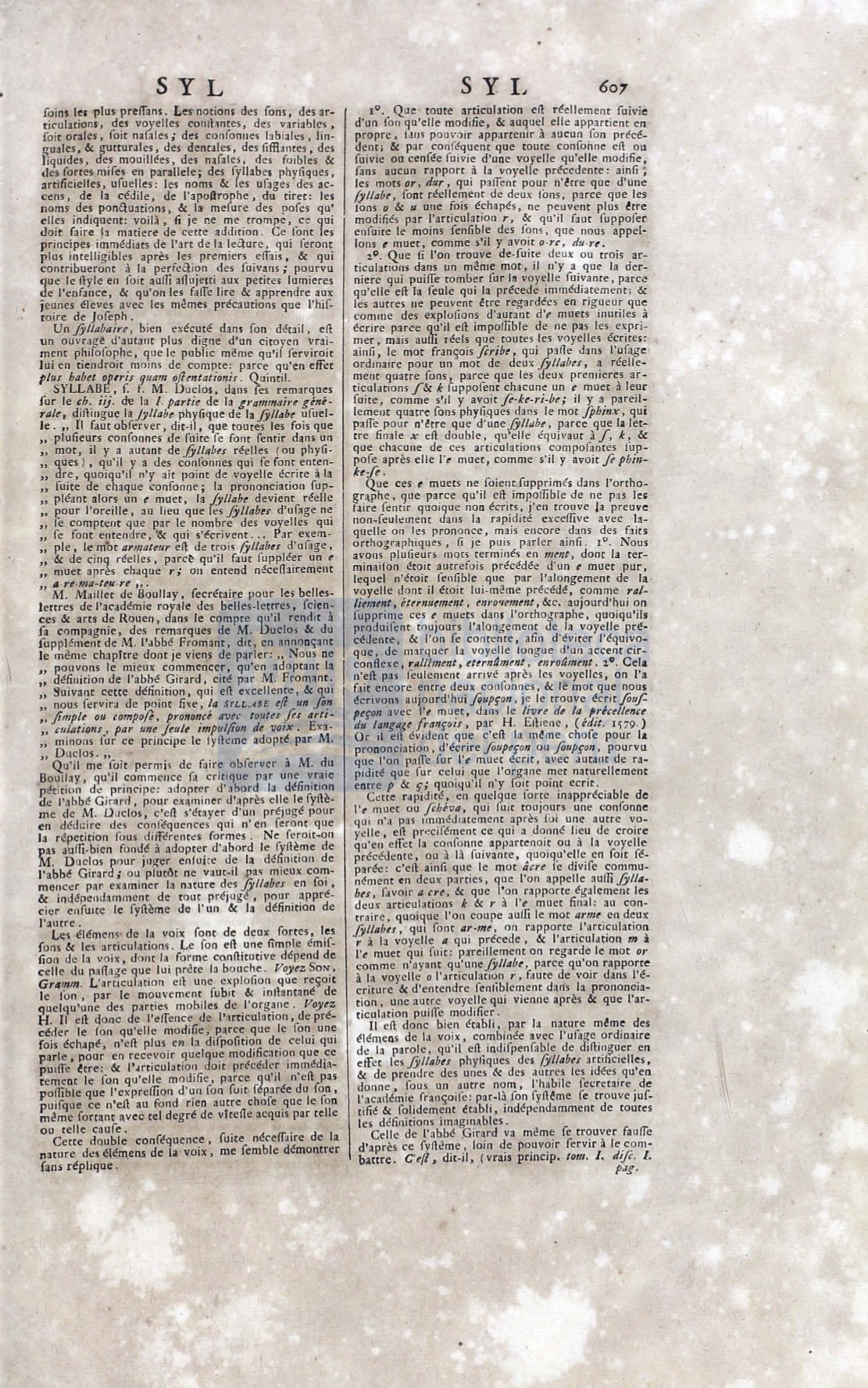
S Y L
foios ler
plu~
prefrans. Les-norions des fons
des ar–
ti<:ulations,
d~s
voyelles conttanres, des
v~riables
,
f01t orales, foor nafa les; des confonnes labial"s
lin–
goal_cs, &
gutturdl~s,
des dencales , des liffi2nces', des
Jiquodes, des mouollées, des nafales, des
foil> les &
des forres mi fes en parallele; des fyllabes phyliques
arriticielles, ufuel_les : les
~oms
& les uf3ges des
ac~
cens, de la cédole, de 1apoftrophe, du rirer: les
noms
_de~
ponétuari_ons, &. la mefure des pofcs qo'
elles
o~doquenr:
voola, li Je ne me trompe , ce qui
t.l01c faore la m
a
riere de cette addirion . Ce Ion
e
les
princ!pes i_m_médiacs de !'are de la
~eéture,
qui feronr
pl us o_ncelhgoble,s apres _les_ premoers etrais , & qui
concrobueronc a
!a
per.tcéto~n
.des fuivans ; pourvu
que le ltyle en Íolt aullo alluJCitl aux perite• lumieres
?e
l'enfance, & qu'onles Catre tire & apprendre aux
JCOilCS
éJeves avec les memes précautions que l'hif–
toire de Jofeph .
Un
JYIIabaire,
bien
exécuré dans fon dét3il
en
un
ouvrag~
d'auranr plus digne d'un cicoyen
~raí
mene pholofophe, que le pubfic
m~
me qu'il ferviroir
lui en tiendroir .moins de
com~re:.
paree qu'en elfer
plru babee o(ltrrs quam o!lentatronrs .
Quintil.
SYLLAB.~.'
f.
f.
M.
Du~los,
dans les remarques
fur le
ch.
IIJ.
de la / .
partu
de la
grammaire g;n;.
rale
~
din,ingue la
jyllabe
phylique de la
Jjllabe
ufuel–
le . .,
ll
fau
e
obíerver , doc-tl, que roures les
fois
que
plufteurs confonne• tle fuire fe fonr Cenrir daos un
mor, il y a auranr de
./Yllt~ber
réelles
( o
u phyli–
ques ) , qu'il y
a
des confonnes qoi fe fonr enren-
"
dr~.
quoiqu'il
n'y
air point de .voyelle écrire
a
la
,
fu ore de chaque confonne; la prononciation fup-
pléanr alors un
e
muer, la
/yllabe
deviene réelle
., eour l'oreille,
a
u lieu que fes
Jjllqbu
d'ufage ne
,. le
con1pt~ur
que par le nombre des voyelles qui
,
fe font entendre, '& qui s'écrivenr . . . Par exem–
" pie, le mbt
111'111atmr
ell de trois
(jllabu
d'ufage,
, & de <;inq réelles,
pare~
qu'il faut fuppléer un
~
" muet arres chaque
r;
011
entend néceflairell1ellt
,
•· r~~111a-tt11~rt
,, .
M.
Mailler de Boullay, fecréf'!!J;e pour les belles–
lerrres de l'académie
roy~le
des
belles-le~cres,
(cien–
ces & ares de
~ouen,
dans le cqmpre qu'il rendir
a
fa compagnie, des remarques de
M.
Duelo> & do
fuppl émenr de
M.
l'abbé Fro01anr, die, en annoo({anr
le meme
ch~ptrre
done je
viens
de
p~rler:
,. Nous oe
,
pouvons le mieux comme11cer, qu'en adopranr la
, détinirion de l'abhé Girard, cité par
M.
Fromanr.
, Suivanc cette délinirion, qoi en excellenre, & qui
, nous fervira de J>Oint lixe,
la
STLt...ABf.
ejl un .fon
,.
jimpl~
ou
&omp~(J,
prononú qvec top(u
fii
arti–
,
cr•lilfiQIU, par une
Jeute
impul(i< de voix.
E~a" minons fur ce príncipe le fyfieme adopté par M.
, Duelos ...
Qu'il me íoir permi< de
f~ire
obfer,er
a
M. du
Boullay, qu'il commence fa critique par une vraic:
pétírion d" prínc-ipe : adoprer d'abord la qétinirioll
d e l'abbé
Gir~rd,
pour ex'\miner
d'~pres
elle le
fyn~me de M. U udos, c•en s'érayer d'un préjugé pour
en dédo;ire des
conf~quences
qui n' en feronr que
la
r~peticion
fous
dilférenr~s
for01es . Ne feroic-on
pas al!lli-bien fondé
a
adoprer d'abord le fyfieme de
M . Duelos poor jnger enluice de la délinirion de
l'abbé Girard; ou plurélt ne vaur-il pas mieux com–
m~ncer
par examiner la nJture des
JY!Iabu
en foi ,
&
inqépeudammenr de tour préjogé ' pour appré:
cier eufuitc: le
fyn~me
de 1' Qn
~
la défi.nirion de
l'autre.
L~s
élémens· de la vQil(
fonr de demr forres. les
fons & les articulations. Le fon en une limpie émi[–
fion de la voix, done la fÓn11e cannirurive dépeod de
ce!le du pallage que lui prere la bouche .
Voyez
SoN,
Gr4mm.
L 'arcicularion en une explolion que re!<oit
le ton , par le mouvement fubir & inltanrané de
quelqu'une des parrie< mohiles de l'orgaue.
Voyez
l-{.
ll efl: qanc de l'el{'ence de l'articularion, de pré–
céder le Ion qu'elle modiñe, Paree que le fon une
fois écnapé, n'en plus el'l la <!ifpo(ltion de celui qui
parle, poar en rece_voir
9uelqu~ modilicari~n
que _ce
puifre
~rre;
&
1'Artoculattou dott
pr<.<céd~r
omméd(a–
remeot le fon qu'elle mo<lilie, paree qu'il n•en pas
pollible que l' exprellion d'un fon fuit fégarée du foo,
puifqne ce n'efi au fbnd ríen aurre chofe que le fon
meme fortant a,vec;.cel qegré de vlcefle acquis par telle
ou relle caufe.
Cecee dquble
conféqq~nce,
fuite néce!faire de la
narure d<!s
~~~men.~
de la voix, me femble démontrer
fans répliqu.: .
S Y L
1°.
Que toare arricularion en réellement fuivie
d'un fon c¡a'elle moditie, & auquel elle apparrienc en
propre. tao¡s
pou ~oir
appartenir
a
aucun fon précé–
denr; & par contéquenr que tome confohne en ou
foivie ou cenfée fuivie d'une voyelle qu'elle modilie,
fans aueun rapporc
a
la voyelle précedenre: ainli ;
les
mors
or, drrr,
qui pafrenr pour
n' ~tre
que d'une
fll/abe,
[oot réelle'!'ent de deux tons, paree que les
tons .
o
&
tJ
Ul~e ~oos é~hapés,
ne peuvenr plus
~ere
modoliés par
1
arncularoon
r,
& qu'il faur fuppofer
enfuite le moins fenftble des fon s, que nous appel–
lons
e
muer, comme s'il y avoir
o-rr, du-re.
2~'.
Que
fi
l'on rrouve de-fuire deux ou rrois ar–
ricularions dans un meme mor' il n'y a que la der–
nierc qui puifr comber fur ls voyelle fui vanee, paree
qu'elle en la leule qni la précede immédiaremenr;
&
les aurres ne peuvent étre regardées en rigueur que
t·omme des explolions d'aucanr
d'r
muers inutiles
¡¡
écrire paree qu'il en impollible de ne pas
les
expri–
mer, mais au(fi réels que couces les voyelles éerices:
ainli, le mor fran<_¡ois
flribe,
qoi pafle Jans l'
ufa.geordmaire pour un mor de deux
.f;llabu,
a réelle–
ment quaere fons
1
p3rce que les deux premieres ar–
ticulations
f&
k
luppofenr chacune un
e
muer
ii
leur
fui te , comme s'il y
avoit
fl·ke-ri-be
¡
il
y
a
pareil–
lcmenr qua
ere
fons
phyli.ques dans le mor
JPbinx,
qui
pafl'e pour
o'~tre
que d' uoe
(jllúbe,
paree que la ler–
rre final e
X
en doulJJe, qu
1
elle équivaut
a
J•
k,
&
que eh3cune de ces arcicolations compolanres fup–
pofe apres elle l'e muer, comme s'il y avoit
fi
phiiJ–
~e-fi.
Que ces
e
mue
es
ne foient fupprimt<s dans l'orrho–
gr:tphe' gue paree qu'il en impoffible de ne pas le'
taire fentlr quoique non écrirs, j'en erouve la preuve
non-feul.,menc dans la
rapidiré exceffive avec
!a–
quello! on les prononce, mais encore daos des faits
orrhograpniques, li
je puis parler ainfi.
r
0 •
Nous
avons plufieurs mors rerminés en
mmt,
done la rer–
minaiton éroir aurrefois précédée d'un
e
muer pur
l~quel
n'étoit fen(jble que par l'alon"'emenr de
1~
voyelle donr il écoit lui-meme
précédé ~
comme
ral–
ljemen_t, éternufln'nt, mro•1emmt,
&c. aujourd'hui on
tupprome ces
e
muets dan¡ l'orrhog raphe, quoiqu'ils
produifem rnujours l'alongemenr de la voyelle pré–
cédenre, & l'on fe contente , afin d'évirer l'équivo–
que, de marquer la voyelle tongue d'un accenr cir–
conflexe,
r11llfment, eternfhnmt, enrot2ment.
2°.
Cela
n'en pas feulemenr arrivé apres les voyelles, on
l'a
f:tir encore encre deux confonnes, & le mor que nous
\lcrivons aujourd'hui
fiup_fon ,
je le crouve écrir
Jimf–
peron
avec
l'e
mu~r,
dans le
livre
4,
la précel/m(t
'dr• lanfage fran_f&U,
par
H.
Ettiene, (
Mit.
1~ 79. )
Or il elt éviJenr que c•en la
m~me
chofe pour la
prononciarion, d'écrire
.foupefon
ou
fir1pfon,
pourvu
que l'on pafl'e fur l'e muec écrit ,
avec
autanr de ra–
pidiré que fur celui que l'organe mer nacurellement
entre
p
&
fi
quoiqu'il n'y foir point eerir .
Cerre rapidiré , en quelque force inappréeiable de
l'e muet au
flhéva,
qui fuir roujours qne confonne
qui n'a pas unmédoatemenr apres foi une autre vo–
yelle, en
pr~cifémenc
ce qui a donné lieu de croire
qu'en elfet la cont'onne
apparcenoi~
ou
a
la voyelle
précéJenre' ou
a
la fui vanee. quoiqu'elle en foit fé–
parée: c•en ainli que le mor
.icre
le divife commu–
nément
~n
deulf par{ies, que l'on appelle aufll.
jjlhr–
bu,
fJVoir
a
ere,
&
que l'on rapporre égalemenc les
deux articularions
k
&
r
a
l'e
mue~
final: au con–
rraire, quaíque l'on coupe aulli le mor
arme
en deux
JYIIabn,
qut fonc
ar-me,
on rapporce l'arcicularion
r
a
la voyelle
11
qui précede. & l'arriculation
m
a
l'e
muet qui fu ir : pa:reillem.enr on
r~garde
le mor
or
comme n'ayant qu'une
Jjllabe>
paree qu'on rapporte
a
la voyelle
o
l'arriculariun
r '
fdute de vojr daos l'é–
crirure & d'enrendre fentiblemenr darls la prononcia–
ríon, une auere voyelle qui vienne apres & que l'ar–
ticularion pui!fe modilier.
Il en done bien écabli. par la nature
m~
me des
élémeo.s de la voix, cam,binée avec l'ufage or<linaire
d~
la parole, qu'il en indifpenfable de diíhn¡¡uer en
elfer les.
Jjllabu
phyliques des
(jtlabu
arriticielles,
& de prendre des unes
~
des aurres les idées qu'en
donne
>
fou s un aocre nom, l'habile fecreraire de
l'aeadémie fran<_¡oite: par-la fon
fyfi~me
fe trouve juf–
tilié & folidemenr
~tabli,
indépendammenr de coures
les
délinirions
imagin~bles
..
Celle de l'abbé G.irard va m@me fe rrouver fautre
d'apres ce fyfieme , loin de pouvoir fervir
a
le com–
battre .
C'efl,
dir-íl, ( vrais prineip,
tom. / ,
tiifl.
l.
p,¡g.
¡'
















