
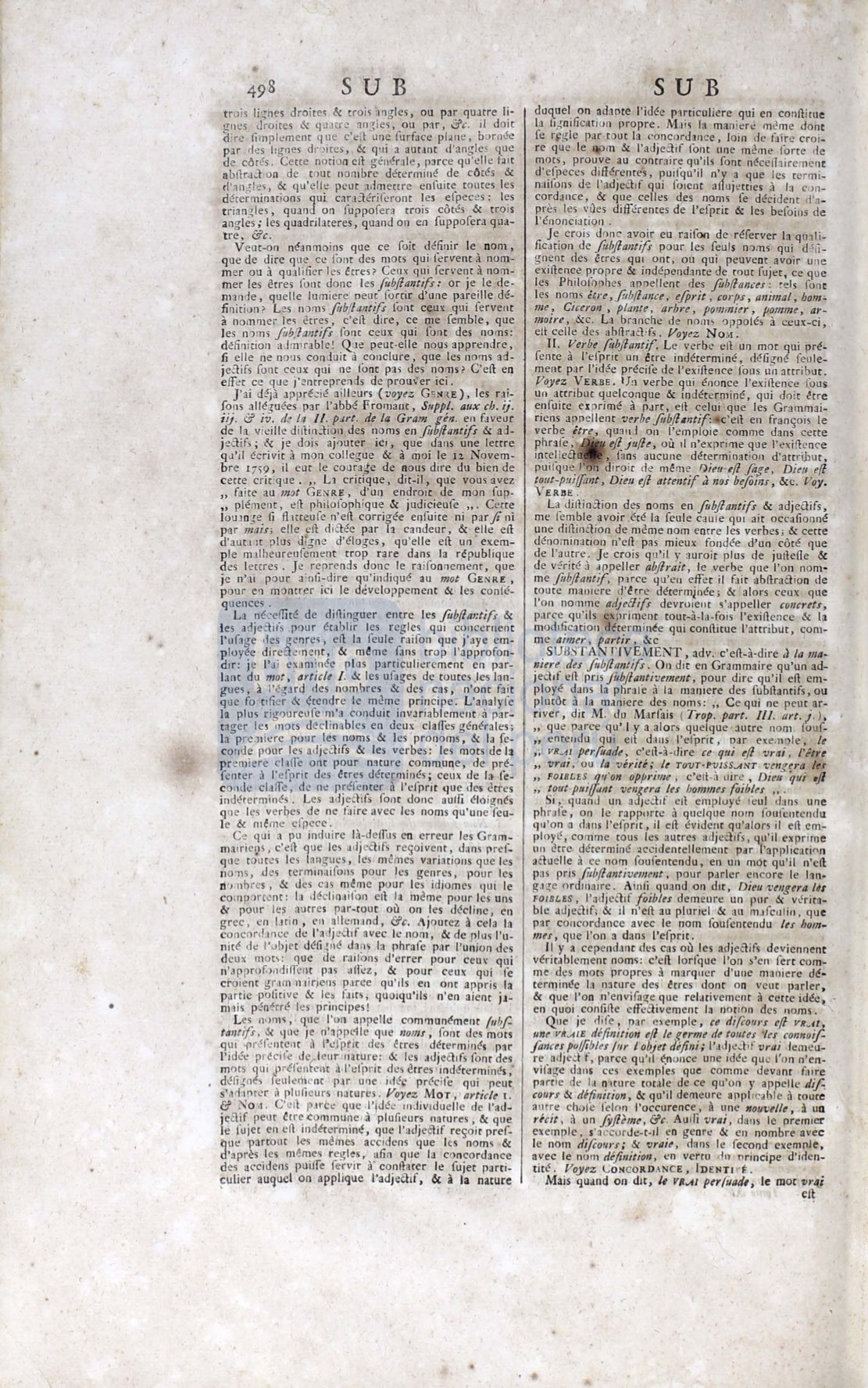
.
.
•
SUB
t rois lirrnes draites
&
erais angles, au par quatre
li·
~11cs d~aites
&
quatre an3ie1, au par,
&c.
il
doit
<tire fimplement que c'e[t une furface pl• ue,
born~e
par ,fes l1gnes dr•Jite ,
&
qni a aurant d'angles que
d
clltés. Cette notion eil générale, paree qu'elle fo1t
a bilr~a·,on
de
cout
nom bre dérermiué de cllrés
&
rl'a n·<le ,
&
q u'elle pcut
~dmerrre
enfuite tomes les
déte~minations
qui cara1éri fero nt les efpeces: les
triangles , quand on fuppo fera
cr01s cótés & rra1s
angles ; les quadrilateres, quand on en fuppofera qua–
tre
&c.
V eut-on néanmoir!s que ce foit
dé~nir
le, nom,
que de dire que ce Iom des mots qu1 fervent a nom–
mer ou a quali!ier les
~treS1
Ceux qm fervent
a
nom–
tner les @rres fu nt done les
fob.fla'ltifs:
ar je le ele–
mande, que!le lumiere
neu~ fo~rir
<!'une pareille
dé–
finition ? Les n ms
fl¡bf!antifs
loor ceux qu1 fervent
¡,
nommer les erres, c'eft dire, ce me femble, que
les noms
fl1b,'l antifs
fonr ceux qui font des noms:
d~!ini cion
admirabl e! Que peut-elle nous apprendre,
fi
elle ne nous concluir
a
conolure, que les noms ad–
jeaifs font ceu.x qui ne lonr pas des oorr¡s
1
C'eíl: er¡
elfer ce que j'enrreprends de prouver ici ,
J 'ai déja
appré~ié
ailleurs (
voyez
GEN, E) , l
es ra.i_–
fons allé ,uées par l'abbé Froma nr,
Suppl. atiX
cb.IJ.
iij.
&
iv. de
1!1
/1.
p,¡rt. de la Gram gén.
en
faveurde la víeille
diitin~1ion
des noms en
Ji¡6jlantift
&
ad–
jeétifs ;
&
je doi<
ajourer
ic1, que dans une lerrre
q u'il écrivir a mon collegue &
it
fi)Oi le
11.
Novem–
bre
17)9,
il eut le courage de nous dire du bien de
c erre erit;que _ ,
L~
critiqiJe, dir-il, que vous avez
,
fa ite au
mot
GEN
RE,
d' ul) endroir de mon fup–
" plément , eíl: philofaphique & judicieufe , . Cerre
Joul n" e fi fb rteufe n'eft corrigée
e~fui te
ni par
ji
ni
par
' 11~ais;
ell e eft di ée par
la
candeur, &
elle eíl:
d'aura,:r plus tlrg ne d'élogcs, qu'elle eft un '
ex.em–
ple malhem eufemenr rrop rare dans la rép
ubliqued es leerres . J e reprends done le raironncmenr, que
je n'ai pour a'nfi-d i1·e qu'indiqué au
mot
GENRE ,
p our en
montr~r i~i
le d¿veloppemenr & les con fé.
quences,
La nécellité de diftinguer entre les
fobjllll:ti[.·
&
les adjeélifs .pour érablir les
regles qui concerneor
I'u f.1ge des gen¡-es, eft la feule raifon que j'aye em–
ploy~e
di r_eéleooenr,
&
m~me
(ans _rrop' l'approfon–
dir: ¡e l'a> exam!llée plus parnculreremenr en par–
lanr du
mot,
·
article
/ .
&
les
~ fages
de routes les
lan–
gues '
a
¡•¿uar<l des nombres
&
de~
!'.as' n'onr fa ir
q ue forri!ier
&
~cendre
le
m~rne
pnn c1pe: L'analyfe
la plus rigou reu(e m'a éond4i r invariabl emenr
il
par–
ta<Ter
l e~
ooors M clinables en deui claOes générales;
Ia"prc~tiere
póur les n0ms
&
lespronoms,
&
la fe–
conde pour les adjetlifs & les verbe : ' les mots de la
pren¡iere
ci~Oe
onr pour nature commune, de pré–
fenter
a
l'efprir des érres déterminés ; ceux de la fe–
conde claffe' de ne préfenrer
il
l'efrrit que des en·es
inMrerminés". Les ad¡eélifs fonr done aulli éloignés
q oe les
ver~es
de
~e
.fai re avec les noms qu' une feu-
le &
m~me
cír.ecc .
·
Ce qui a pu induire la.-deffus en erreur les G ra m–
mairiens, c'eft que les ad)CéllfS resoJvent, daos ¡>ref.
que tÓu res les
la~gues '
les memes variarious que les
noms, .des rerminaifons pour )es genres, pour les
¡jr, nJbres, & des cas meme pour les id jomes qui le
comportenc : la déclinaif'on eíl:
la ineme pour les uns
&
pou r
le~
aurres par-.rour ou on les déciille , en
g rec, en I.Hio , en allemand,
&c.
1\joutez
a
cela la
conconhnr.;~
de l'arljeélif avec le nom, & de p lus !'u–
niré
d~
l'ob¡rt
défi~>té
da!' ! la phrafe par l' uqion des
deux moti: . que de
'~' l?ns
d'errer pou r ceux qui
n'approf.>nd11fenr
pa~
a
Ocz,
&
pour ceux qoi
fe
croient grJm ·nai rjens p<
!r.eequ' ds en Onr appris la
p arrie polirive
&
les fa1
ts,quoiqu'ils n'en aienr ja:
n\ais pénérré les prlncipes!
·
Les n•>ms , ' que l'on. appelle commonément
fub.f:
tantifs,
&
') llC
je n'appt'l le que
1101/IS ,
fon r des ffiOtS
qui 'f'réCe nrenr
~
t•cfprit des erres dérerm inés par
l'idée précil-e de leur •nacure:
&
les adjeél1fs fonr des
mots qui prélentenr a<i'elp nir des erres indérerminés ;
détiJnés ieul<"<nrnt par une idée · précife qui peur
s'ada'>rer
it
plufieurs narures.
Voyn
M oT ,
articie
t .
&
t
1
o ·.t . C'cíl: J>Jrce que l'¡dée udivrduetle de l'ad–
jell!f. peur
érr~ .commu~e
a
plufieurs narures' & que
le luJet en eft
JOdétermm~ ,
que l'udje6!Jf resoit pref–
ljue ·partbur les memes accidens que·
les
noms &
d'apres les
m ~me
-regles , ufin que' la concordance
des accidens puiffe ferviT
ir
conflarer le fu jet parri–
~ulier
auquel on applique l'adjeélif'
&
a
la
natur~
SUB
duque!. on adapte l'idée p1rricu!iere qui en coníl:irue
la fiJ ndicanon propre . MJis fa manieré meme dont
Ce
r¡!gle par-tour la <·oncordance, loin de fal re croi–
re que le
m
&
l'adjeél1f font une rneme forre de
mots, prouve au conrraire qu'ils fonr néceOaircment
d' efpeces différenres, puifqu'il n'y
a
que les rermi–
naifons
d~
l' ad¡eét1f qui fo1en r aOujerties
i\
la con–
cordance, & que ce!les des noms fe décidenr
d'n–
pres les vOes
dilf~renres
de l'efprir
&
les befoius de
l'énonciacio11 .
Je.
era is don
av'?ir eu raifoo de réíerver la qnali–
ficatJon de
Ji•lfla11tifs
pour les feuls nnms qui <J&fi_
gnenr de; écres qu1 onr, o u qui peuveor avoir une
exiftenae propre & indépendanre de rout fu jet, ce que
les Philofonbes apneflenr des
fobflan.;es :
rels
íont
les noms
étre, fl¡b/fat!&e, eforit ,
~oi·ps,
animal,
hom~
I/IC!
Cl<·eron
,
plall&e , qrbre, pwzmier, pomme , m·-
1/IOtre'
,&c.
La branche de nDilll oppofés
a
ceux-ci' '
ell ce!le des abftraél ;fs .
1/oyez
N
a
M .
H.
Verb(_ (i¡bft.antif.
Le
ver
be eft un mot qui pré–
fenre
a
l'el prir 011
~tre
indérerminé, défig né feule–
menr par l'idée précife de l'exifience fous un amibur.
f/oyez
VERBE. lh
verbe c¡ui énonce l'exiíl:ence lous
un arrnbm quelconque & mdéterminé, qui doir
~ere
~níui re
ex rimé
a
J>Jrt, eft celui <que les Grammai–
riel;ls anpellenr
verbe fl¡bjlllntif:
c'eil en
fran~ois
le
verbe
l&re,
quau.l 011
l'emploie comme daos certe
phrafe;
·
efljt~/fe,
ou
11
n'e<prime que l' exiftence
il)tel leél
, ritos aucune détermi naria11 d'arrri.bur ,
pui lque 1'
diroir de
mi!
me
f}ieu-,fl fote, Dim efl
tout-pnijJimt, Dim
ejl
llttentif
a
11ol be.foms,
&c.
V~y.
VER
bE '
l a_
diflinélion des noms en
fobjlantifs
& adjeélifs,
me
femble avoir éré la íeule caul!! qo1 air occafionné
une di!linélion de
me
me norn enrre les verbes ; & cette
dénomina rion n'efl pas mieux foncjée d'un cóté que
de l'aurre. J e crois qu'il
y
auroir plus de jullefle &
de
v~ri té
;\
~ppeller
pbjlrait,
le verbe que l'on no
m·
me
fl¡b.flantif,
paree qu'eu elfer il fair abíl:raélioo de
roure ma111ere cl'érre dérerrnjnée;
&
alors ceux que
1'011 nomrne
atljeélifs
devroie11t s'appeller
co11crets,
paree qn'ils ¡:xprin¡enr rour-a-la-fois l'exi!lence
&
la
mod,~carial1 dér~rminée
qui conOirue l'attribur,
~o
m–
me
a/rner, partir,
&e
·
SUBSTANr!VEMENT,
adv.
c'eft-a-dire
a
la
111a-
11iere des Ji•b.flmJ&i(s.
011 dir en Grammaire qu'un ad–
¡eébf eíl: pns
jlilljiantzvement,
pour dire qu'i l eft em–
ployé dans la phrale
it
la maniere des fubfta nrifs, ou
plucllr
a
la maniere des noms : ,. C e qui ne peur ar–
rivér, dir M. du Marfais (
Trop. part.
J/1.
tlrt. j . ),
~.
que paree qu'.l y a al o rs quelgue :turre nom
fo uf–
, . ente11du qui ell da11s
l'efpri r , par exe.n le,
le
•
,~1
vR..At pe1;{ilade,
c'ell-?l-di re
ce qtti 4/1
vrai,
r;lrt
,.,
vrai ,
ou
la v éritt; lt
rovT·PVISS..ANT
vrng tra lt.r
,
FOIBbES
L}t¡'on opprime
,
c'etl-a Jire ,
Die11
qui
.¡1
,
tq11t·p11ijfi111t ve11gera' les bommes fóibles
, .
Si ~
quand un adJeO:hf ell empluyé reul daos une
phra fe , on le rapporre
a
quelque norn foufemendu
qu'on " dans l'efprir, il ef¡ évidem qu'alors
il
eíl: em–
pln-yl', comme rous les autres adjeétifs, qu'il exprime
1111
erre; dérerminé
~ccidenrellemenr
par l'arplicari<'n
aéluetle
a
ce nom foufente ndu, en un mQr qu'il n'eíl:
.pas pris
.fi1bjla11tivemmt,
pour
pa~ler
eneore le lan–
ga~e
nrd111aJre. ñinti. quand o n dit,
Dieu vmgera
Ur
FOIBLES ,
!'ad)e~Jf
foibles
derneure un pu r
&
vérira–
ble adJeélJf)
&
1!
n'~!l
at¡ piune! ·&
a11
mJfculin , que
par concordance avec le pom foufenrendu
lts
bom–
mes,
que l'on a daos l'eíprir.
· 11
y a cependanr des cas oil les a.djeélifs deviennent
vérirablemenr noms: c'e!l lorfque l'on s'en ferr com–
me des mots propres
il
marquer d'une maniere dé–
reí-rr¡inée la n3ture des ;
~eres
donr on veur parler,
& que !'o'!
.n'envifa~e.que relarivem~nr
a
cerre idéet -
en quoi confifte elfeéhvemenr la nor>on des noms.
·
<tue je riife , par e>emple ,
ce di{cor11·s efl
vR.<C,
une
IVR.A!E
dé.finition
a/l
le germe de toutes
'IÚ
cotmoif–
jimces
p~(/ibles
j11r l'objet déji11i;
l'ad)e~1if
v.ra.i
.Jemeu–
·re _odjeél
~·,paree
qu'li
~nonce
une idée qu e l'on n'en–
vilage dans
ces
exemples que comme devane
faire
p artie de la n·¡rure rorále de ce qu'on
y
appelle
di¡:.
cours
&
d¿finition,
& qu'il demeure appl rcable
a
rouce
3lltre chofe feion l'occurence,
a
Une
IIOttVe/le,
a
UQ
rfcit ,
it
un
.f¡jleme, &c.
Aulli
vr11i,
dans le premier
exemple, s'accorde-r-d en geore & en nombre avéc
le nom
diflours;
&
vraie,
dans le fecond exemrle,
a vec le nom
d¿ji,zitioll,
en
vertu <in orincipe d'iclen–
tiré .
Voyez
CoNC!ORDANCE, IDENTI r É.
Mais quand on d1r ,
le
V
/I.AIper(iwlt,
le mor
vra..i
.
ea
















