
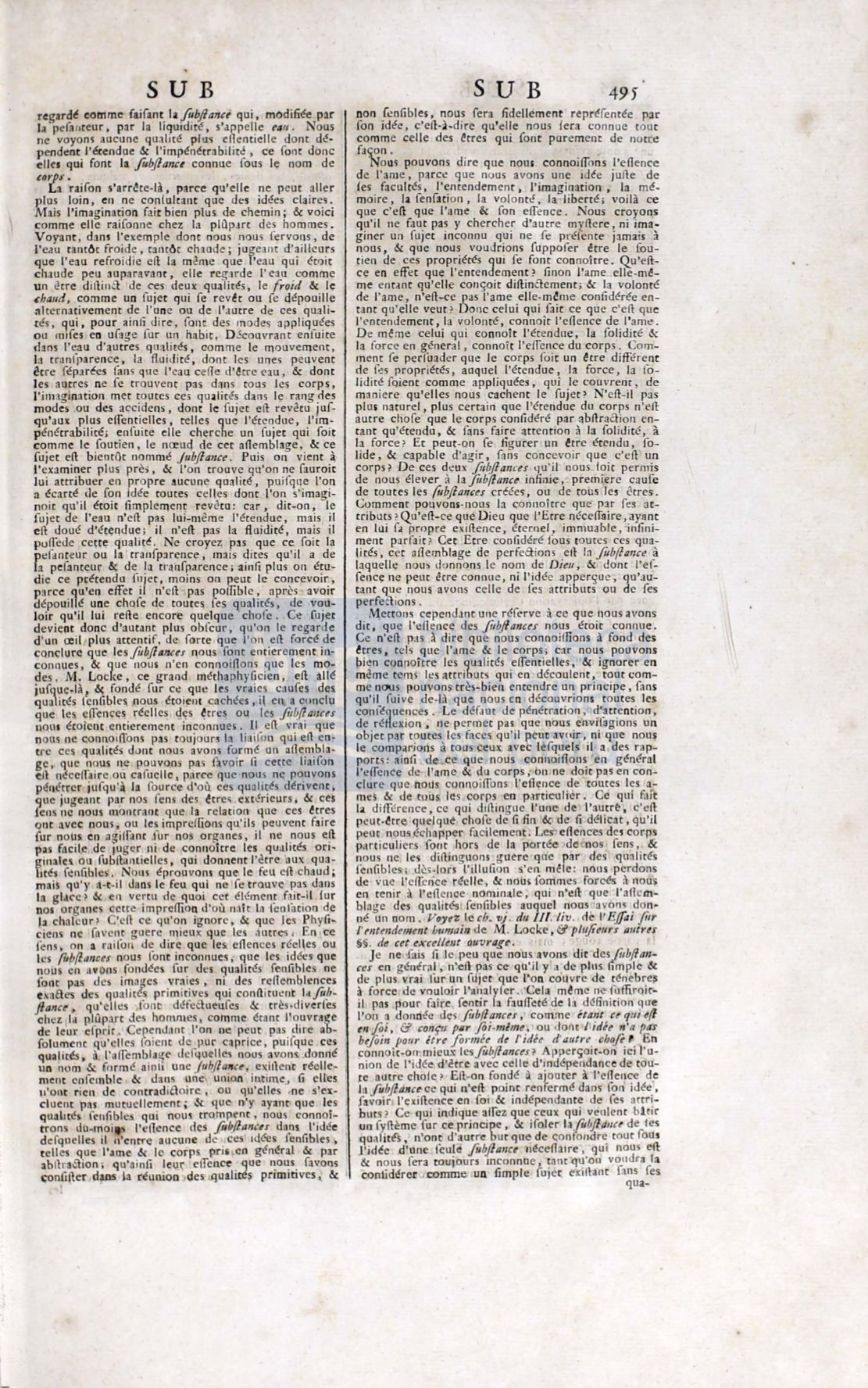
SUB
regarM eomme faifant
lajübjla11u
qui, modifire par
la pefa11reur, par la liquidité, s'appelle
ea11 .
Nous
ne
voyons
aucune qualité plus eflentielle dont dé–
pendt!nt l'écendue
&
l'impénétrabilité , ce font done
elles qui font la
.fobjla1l&t
connue fous le nom de
eorp~~ .
La raifon
s'arr~te-1~,
paree qu'elle ne peut aller
plus
loin, en ne confulrant que dts idées claires.
Mals l'imagination fait bien plus <le chemin;
&
voici
comme elle raifonne chez la plapJrt des hommes.
Voyant, dan• l'exemple done nous nou
[er vous ,
de
l'cau tantllt froid e , ranrllt chaode ; jugeant d'ailleurs
que l'eau refroidie e!l la meme que Peau qui ét'lit
chaude peu auparavanr, elle regarde
1'
ea u comme
un
~ere
di!linfr de
ces
deux qualités, le
(roid
&
le
~ha11d,
comme un fujet qui fe
rev~r
ou fe dépouille
alternativement de !'une ou de l'aurre de oes quali–
tés , qui, pour ainti dire, fonc des modes appliquées
ou rlllfes en ufage fur un habic , D .lcouvrant enfuite
clans l'cau d'aurres qualités, aomme le fllOuvement,
la cranfparence, la
lluidité, dont les unes pe4venc
~tre
féparées fan que l'cau cefle d'Gtrc <'au,
&
dont
les aurres ne fe rruuvent pas daos tous les corps,
l'irnagJ[Intion met
co~tes
ces
qualit~s
daos le raug des
modes ou des accidens, done le fujet ell reveru juí–
qu'aux plus elfentielles, te!les que l'érendue, l'om–
pénérrabilité; enfuite elle cl)erche un fujet qui íoit
comme le fuutien, le nreucf ele cer nflemblage ,
&
ce
fu jet efl bientl}r nommé
jt~bjla1zte .
Puis on vienr
~
l'examiner plus pre;,
&
l'on erouve qu'on ne fauroit
lui atrribuer en propre aucune
qu~l irá,
puiíqqe l'oo
a
écarté de íon ldée coures cel!es dont {'on s'imagi–
noi t qu' il écoit tin]plefllent reveru : car, dit-on,
le
fu jet de l'eau n•en pas lui-meme l'érendue, mais il
efl doué
d'ét~r¡~ue;
il n•en pas la fluidi[é, mais' il
puflede cette qualit6. Ne croyez pas que ce foic la
pefanceur ou la rranfplrence, mais dites qu'il a de
la peflntcur
&;
de la
tr~nípareoce;
ainfi plus on écu–
die ce prétendu !i1jer, moins on l'_eur le conc¡!voir,
porce qu•en elfet il n•en pas poflible, apres avoir
dépouiHé une chufe de roures fes qual icés, de vou–
loir qu'il lui rene encore quelque chofe . Ce (ujet
devi~pr
done d'autant plus obfcur , qu'on le rega n te
d' Uil
<EÍ{¡
plus attentif, de forte que
J'QI\
en forcé de
con<ilure que
lesjitbjlllll&u
nous funt entierement in–
connues,
&
que nous n'en coonoiflons que les mo–
des ,
N{.
Loclce, ce grand méthaphyticien, efl alié
jufque,ta
1
6(
fundé fur ce que les
v~aies
caufes des
qualité~ l ~nfibles
,nous étoient cacho!es
,¡¡
eo
a ounclu
que les e0ences réelles
g~s ~rre~
ou
les
jitbjla11cts
n0111 éroleot entierement inconnues.
11
ell vrai que
nous ne c;onnooffons pas roujours In liaifon qui en en–
tre ces
qu~lirés
dont nous avons formé un aflembla–
ge, que nous ne ¡>ouvo11s pas 11\voir
ll
cene liaifun
ell néce!faire ou cafuclle, paree que •nous no:: pouvons
p~otérrer juíqu'~
la fource d'oii ces qualicés dérivenr,
gue jugeant par nos fens des étre< exrérieurs,
&
ces
fens ne nous montraot que la relarion que ces
~tres
onr avec: oous, o u les
impr~l[ions
qu'ils peuvenr faire
fur nous en agilfant fu r no organes, il ne nous en
pas facile de ¡uger ni de cor¡noitre les qualités ori–
ginales ou íub!tilntielles, qui doonent !'erre 'aux qua–
lité• (enfi.bles'.
ous éprouvons que le fe
u
en chau¡l;
rnais qu'y a-t-il daos le feo.t qul ne íe rrauve pas dans
la gldce
1
&
en verm de quoi
cet
élément fair-il {ur
nos orgaues ccrre imprellion d'ou nait In feolation d.e
!3 chaleun
•en ce qu'on ignore,
&
que les
Phy·fi~
ciens ne faven t guere mieux que les aurres , En ce
fens, on
a
rnifon de dire que les. eflences réelles ou.
les
(upfla/ICU
nous font inconnues, que les idées que
nous
e
o
u
vons foodées fur des qualirés fenfibles ne
font pa& des imaores vraies , ni des re(lemblences
exaEles de
qualit~
primitives qui conlliruen't
l•fob–
ftanu,
qu'elles
fono défeélueufes
~
tres-diverfes
ohez la plílp'll't des homn1es, comme érant
1
ouvrage
de leu( efprit, Cepenclant l'on ne
peu~
pas dire ab–
folumeot qu'elles (oienc de pur caprice , puifque ces
qualicés,
a¡
l'affemblag<" defquelles
QOUS
avons..doooié
un n<•m
&
formé ai nli une
Jubjlallc~,
cx,illent réelle–
menr cnfemble
&
dans un;:, unian io\time,
{i
ell'es
u'onr rien de concradiéloire., ou qu'elles ,ne s'ex–
cluenr pns muNellement;
que n'y ayant· que les
qual.ores fenfible
qu i nous rro.mpenr, nous connol–
trons d!J-moi
,
l'eflence c\es
.fi¡bjla1lter
dallt l'idée
defqo
ellesil
n'enrre aucune
de ces 1dres feníibles ,
telles
9.uel'ame
&
le corps
p.ri~,
en
général
&
p3r
abllraóloon; qu'ainfi
le1,1~
elfence . que
~o~.
favoos
.;on,fi!ler
d~
la
(éunioo •des
li}Uahres
pnmmvcs ,
&
SUB
49)
non Íl!ntibles , nous fera fidellement repréfenrée par
for¡ idée, c•en-a-dire qu'elle nous lera connue tour
comme celle des
~tres
qui fonr purement de notct!
fac;on.
Nous pouvons dire que nous connoiflims l'eflence
de l'ame, pare" c¡ue nous avons une 1Me julle de
les facultés,
l'emendemenr, l' imaginarion ,
la mé.
moire, la fenf3tion, la volonté, la liberté; voila ce
que c'c!l que l'ame
&
fon effence.
ous croyons
q~'il
IIC
fau.t
pa~
y chercne: d'au tre mxnere ! ni ima:–
goner un íu¡et 1nconnu qUJ ne fe prélenre ¡amais a
nous,
&
que nous voudrions fuppo fer étre le f.ou–
ticn de ces propriétés qui fe font connolrre. Qu'ell–
ce
en effer que l'enrendement? tinon l'ame
elle-m~me entdnt qu'elle con<;oir dininélemenr ;
&
la volonté
de l'ame, n'ell-ce
pas
l'ame
elle·m~me
contidérée en–
tanr qu'elle veur ? Done celui qui íair ce que e•en que
l'<'ntendemenr, la volonté, connolt l'eflence de l'am,;,.
D e mCme celui qui eonnolr l'étendne, la folidité
&
la force en géneral, connolt l'eflence du corps . Com–
menr íe pert'uader que le corps foit un
~ere
dilférent
de
{~s
propriétés, auquel l'étendue, la force , la ío –
lidité Íqient comme appliquées, qui le couvrenr , de
maniere qu'elles nous cachenr le íujen
•en-it pas
plus narurel, plus cenain que l'éreodue du corps n'efl:
aurre chofe que le corps contidéré par
~bnraétion
en–
cane qu
1
étend
u. & f~ns
faire an ention
a
la fol idité .
a
la force ? Er
peur.oníe tig urer un
~rre
étendu , fo–
lide,
&
capable d'agir, fans concevoir que
e
en un
corps? De ces d.:ux
jitlljl(Zn<'er
<¡u'il oou
foit permis
de nous éle
ver
:\
la
Jitbflanu
inlinie , premiere cau
fe
de toures les
(itbflan~u
créées, ou de rous le• erres .
Commenr pouvonHJous
la
o;onnoltrc que par fes at–
triburs? Qu'en-ce que Dieu que !'Erre néceffaire, ayanr
en lui
f~
propre exillence, éternel, immuable, infini–
ment parfait
1
Cet Erre confidéré fous comes ces qua–
lirés. cet aflemblage de perfeélions ell la
jitb{lallce
a
laquell~;
nous donnons le nom de
Die11 ,
&
donr l'ef–
fenc~
ne pem
~rre
connue, ni l'idée apper!iuc, qu'au–
ranr que nous avons celle de les attributs ou de fes
perfetlions.
M,ettons cependanr une réferve
a
ce que 110us avons
dit, que l'efl ence des
Jitbflanus
nous écoic connue.
Ce n'efl pas
i\
dire que nous connoillions
a
fond des
~tres,
tcls que
l'~me
&
le corps; car nous pouvons
pien conpoitre les qualités effenrielles,
&
ignorer en
meme rems les anrlbuts qui en découlent, tour com–
me nous pouyons
~res-bien
encendre un príncipe, fans
qu'il fui ve de-1:\ que nous
en
découvrions toures les
coni~quen<;es .
Le défdut de pénérration, d'attenrion ,
de réf!exion. ne permer pas que nous en:vifagions un
objer par
ro
utes les faces qu' il
~eut
av"ir, ni que
nou~
le comparion>
i\
cous oeult
avec
leíquels il
a
des rap–
porrs : ainti de ce que nous conororfl.ons ' en général
l'effence de-
!
ame
~
du corps ; bn ne dore pas en con–
dure que
hoú~
conr¡oi!fons lleflence de toutes les a–
mes
&
de roús les corps
en
pdrticulier. Ce qui fart
la différence, ce qui diningue !'une de
l'autr~,
c'efl
peur.~tr
quelque chofe de ti fin &>de fi délicar, qu'il
peor n.ouséehapper faoilemenr . Les efleoKes des corps
panic~liers
four hors de la porrée
•do~nos
fens,
&
nous ne, les dillínguons g uere q tie par des qualités
fenfibl e ; des·lors l'illufion s'en mele: nous perdons
de vue l'ell.eñce réelle,
&
nous fommes forcés :\ nou$
en tenir
a
l'ellenoe nominale. qui n•en que l'aflem–
blage des qualitésl fenti.bles aoque! noas •avons don–
né un nom ,
Voytz
le
ch. vj. duiJI. Iiv.
c!e
1
Ejfai jitr
t'
mtmde1Nent IJIIn;ain
de
M.
Loo
k
e,
&
ptujie11rs
autru
§§.
de cet 11Xcelle11t ouvragt-.
Je ne• [ais fi. le.peu q,ue nous avons dit des
!itbjlall–
ces
en
génér~l.
n'ell pas
ce-
qb'il y a de plus ti'mple
&
de plus
vrai
{ur un (újer que l'on co'uvre de
rénebre~
a
force de voulojr l'analyler . 'Cela méme ne futliroir–
il
pns pour faire ftlllcir la fau{[ecé de la définirion que
l'on a dondée
d~s
fobflancu ,
comíne
élant
ce
q11i efl
tll•foi,
&
con;u
p11r
foi-mbne,
ou done
tljd¿e n'a p_t1r
bt}Oi11
po11r
itre fomtée de
r
idée d'
autr
e chofi
r
En
connolt-orr
mie~x
les.fobflances ?
Apperc;
oir.onici ]•u–
nion de l'idée d'erre avec celle d'indépenllance de rou–
~e
aurre chofe
1
Efl..on fundé
a
ajoccer
a
l'eflence de
1<1
fobflaJic
~ce quin'efl: point renfermé daos fon idée',
favoir, l'ex.i
flen.ceen Cei
&
indépendante de fes artri–
huts ? Ce qui indique alfez que ceux qui venlenr btrir
un
fyneme (ur ce.principe,
&
ifoler
la./itbfttince
de fes
qualit~.
o'one d'aurre but que de confondre tour rous
J'idée d
1
une feule
.fobjlallet
11écefla1re, 9u1 nous efl:
&
nous
Cera
ro.ujours inconnoe, tant"qtl'on vondra la
"coniidéreD ~:comme
on
fimple fujet éxillanr fans fes
qua-
















