
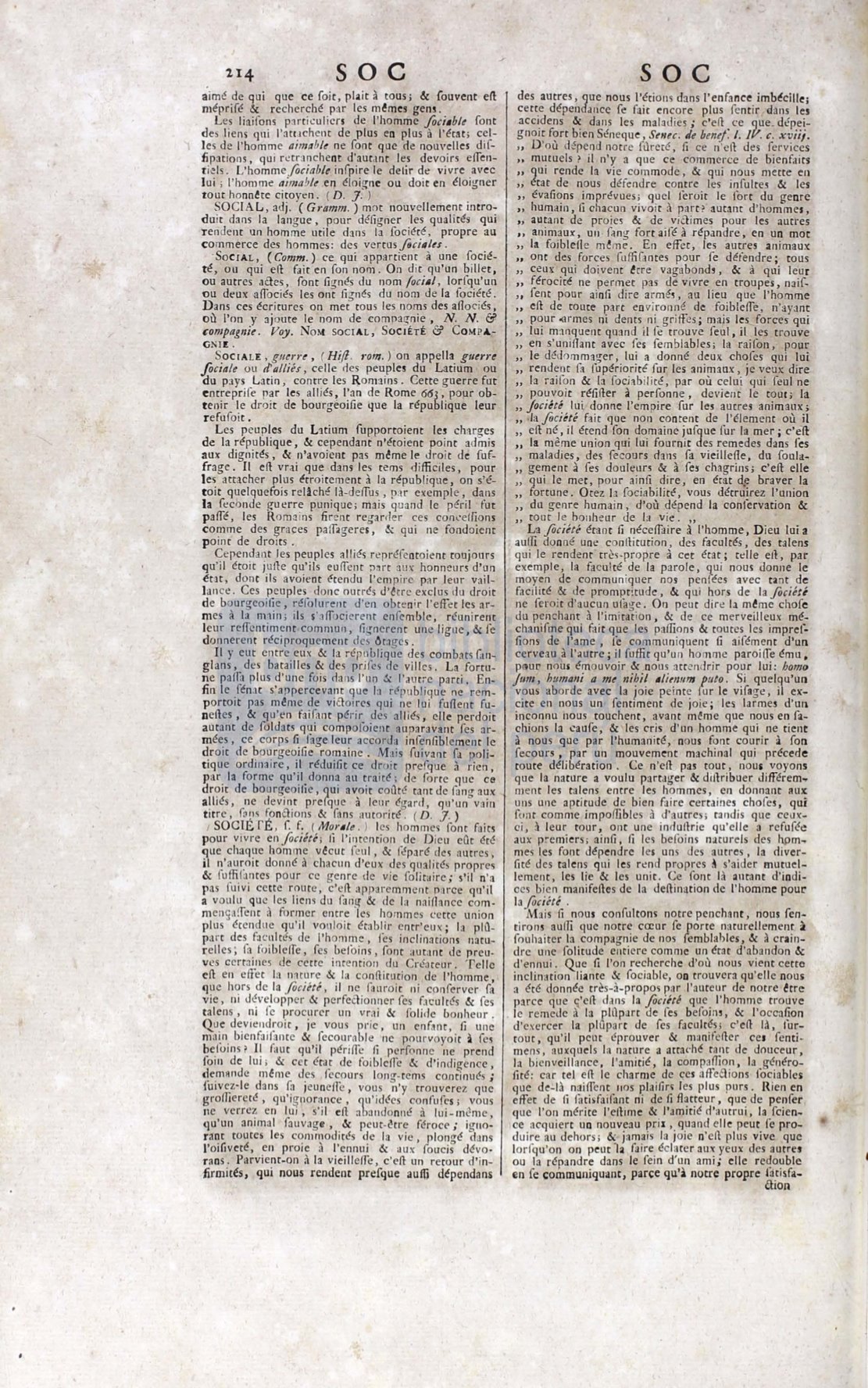
so e
;imé de qui que ce foir, plair
a
rous;
&
fouvenr ell
méprifé
&
recherché par les m!mes gens.
Les liaifons parrkuliers de l'homme
.foci11bl~
fonr
des liens qni l'an.tchent de plus ea plus
a
l'état; cel–
les de l'homme
aimabl~
ne fonr que de nouvelles dif–
bpations , qui rerr:mchenr d'aur.tnr les devoirs eífen–
t i.:\ls.
L'homme.fociable
infpire le delir de vivre avec
lui ; l' homme
aimabt.
en éloigne ou doit en éloigner
tour
honn~rc citoy~n .
( D.
J.
)
SOCIAL, adj. (
Gramm. )
mor nouvellemenr intro–
duir dans la
lang ue, pour déogner les
qualir~s
qui
rendenr un homme mile dans
la foeiéré, propre au
commerce des hommes: des venus
ficilllts .
·SocrAL, (
Comm.)
ce qui
app~rrienr
ii une foeié–
té , on qui ell fair en fon
11001 .
On die qu'un biller,
ou aurres aéles, fonr ognés du nom
focilll ,
lorfqu'un
OU
deux aífociés les OllC ognés du nom de la fociété .
Daos ces écritures on
mee
rous les noms des a!lociés,
ou l'on
y
ajoure le nom de comoagnie ,
N . N.
&
compagnie. Voy.
NoM soci AL, SoC IÉTÉ'
&
CoMP4-
GNII': .
SoCIALE ,
gu~rr~,
(
Hifl . 1·om.)
on appella
gr1erre
fociale
ou
d'alliés,
celle rles peuples du Larium ou
du pays Lacio , conrre les Rornains . Gerre g uerre fut
enrreprife par les all iés , l'an de Rome
663,
popr ob–
tenir le droit de bourgeoifie que la fépublique leur
r efufoir.
Les peuplcs du L1rium fupportoient
les charaes
de la république,
&
cependanr n'éroienr poinr admis
aux dignicés ,
&
n'avoient pas m!me le droit de fu f–
frage. Il ell vrai que dans les rems diffieiles, pour
le's arcacher plus
~croiremenr
a
la république, on s'é–
toir quelquefois rellché 1;\-deífus, par exemple , dans
la
fec nde gucrre punique; mais quand le péri l fut
paífé , les Roma ins
tirene regarder ces con,·etlions
comme des graces
paíf~geres,
&
qui ne fondoient
poinr de drom .
Cependat\t les peupl cs alliés rep•·éfenroient roojours
qu'il étoit jufle qu'ils euífenr
;>~re
" '"
honneurs d'un
érac, done ils avoient étendu l'cmpirc par leur vail–
lance. Ces peuples done ourrés
d'~cre
exclus du droit
d e bourgeoi oe, réfolurenr d'en obcen;r
l'eff~t
les ar–
mes ii la main ; ils s'afli cierenr enfemble,
r~unirent
leur reífentim enr.commun, fJgnerent une ligue,
&
fe
donnerent réciproquernenr des ór:tges.
11
y
cut enrre eux
&
la répnblique des combars
f:lll–
glans, des barailles
&
des prifes de villes. La forru–
n e paflit plus d'une fois dans l' uo
&
l'auc;e partí. En–
no
le fénar s'appercevant que
l:t
république ne r-em–
portoit pas
m~me
de viéloircs qui ne luí fu!lenr fu–
nefles,
&
qu'en faifant périr des alliés , elle perdoit
atlranc de foldars q'!i comJ)ofoienr auparavant fes ar–
mées, ce corps fJ
fage leur accorda infenoblemenr le
d_roit de bourgeo_ioe romaine . Mais fuivant
(a
poli–
trque ordlllarr.e, rl rédutfit ce dr tr prefque a ricn
par la forme qu'il donna au trairé; de forre que
e~
droic de bourg_eoilie, qui av,oir coQré rant de fa ng aux
alltés, ne devtnt prefque a leu r égard, qu'un vain
tirre,
f~ ns
fonélions
&
fans autoricé.
( D .
J.
)
¡
SOGIÉ
fÉ ,
C:
f. (
Mor11/e . )
les
hQmme~
font fairs
pour
vivre
en
fociétf;
fi
l'incenrion de D ieu efit éré
que chaque bomme vécut feul,
&
(.!paré des ;tutres
il
n'aur_oic donné
a
chacun d'eux des qualirés prop¡·e;
&
(uffifanres pour ce g
enre de vie fo liraire ; s'il n'a
pas fuiv i cette rourc, c
'e.llapparemmen t paree qo'il
a voulu que les licns du
(ang
&
de la naillance com–
men~a!fenc
a
former entre 'les hommes cecee union
plus écendue qu'i l vouloit érablir enrr'eux ;
b
plíl–
part des fa culrés de l'homme, fes inclinatiom natu–
(elles;
f.1
foib lelfe, fes beloins, fonr aucant J e preu–
ves ccnaines de ceere inrenrion du Cn'areur. Telle
ell en elfet la narure
&
la conllitution de l'homme
que hors de la
fociété,
il ne fauroit ni coníerver
f~
vie , ni J évelopper
&
perfeélionner fes facu ltés
&
fes
talens, ni fe procurcr un vrai
&
fo lide bonheur .
Q u.e deviend!·oir, je vous pt·ic, un enfanc,
r,
une
ma!n btenfatfante
&
fecour·able ne pourvoyoir
a
fes
be.(oins?
I!
fa ue qu'il périífe li petfonne ne prend
folll de lu1 ;
&
ce
e
éra! de foiblc!l'e
&
d'indigence ,
dem~nde
méme des
lecours
lona-rems continués ·
fuivez-le daos
f.1
jeune!l'e , vous
';',•y
crouverez quci
groffierecé, qu'ig!tOrance , qu'idées oonfufes ; vous
ne verrez en lui , s'il efl abandonné
a
lui- merne
qu'un animal fauvage ,
&
peur-~rre
féroce; iguo:
r~nt
coures les commodi tés de la vie, plonaé dans
J'oifivecé,
Cll
proie
a
l'ennui
&
aux
fouci~
dévo–
raos. Parvienr-on
a
la vieilleífe, c'efl un rerour d'in–
nrmités, qui nous rendent prefque auffi dépendans
so e
des aucres, que nous l'érions dans l'enfa nce imbt!cille;
cene dépendance fe fait encore plus fencir dans les
.acctdens
&
dans les maladies ; c'efl ce que_dépei–
gnoit forr bien Séneque ,
Stnec. de benq: l.
Jf/.
c. xvii¡.
, D'ou dépend narre fílreté,
li
ce n'ell des fervices
,. mutuels ? il
n'y
a que ce commcrce de bienfairs
, qui rende la vie commode ,
&
qui nous mette en
, érar de nous défendre conrre les in[ulres
&
les
, évaoons imprévues ; quel feroir le lorr du genre
, humain,
(j
ohacun vivoir
il
pare? auranc d'hommes,
, aurant de proies
&
de viélimes pour les ann·es
,
animaux, un fa ng fon aile
i\
répandre, en un mor
,
la foib lelle
rn~me .
En elfct, les aucres animaux
, onr des forces fuffi fances pour fe défendre; tous
,
ceux qu.i doivent
~rre
vagubonds,
&
;\
qui leu r
férociré ne permec pas de vivre en rroupes, naif–
lene pour ainli dire armt!s, au lieu que l'homme
efl de toure pare environné de
foiblcífe, n'ayant
pour <trmes ni dents ni griffes ; majs les
force~
qui
,
lui manquenr quand
il
fe rrouve feul,
il
les rronve
, en s' uni!lant avec fes femblables; la railon, pour
,
le dédommager , luí a donné deux chafes qui lui
,
rendenr fa tilpérioriré fur les animaux, jc veux dire
,
la raifon
&
la fodab iliré, par ou celui qui feu l ne
, pouvoit réofler
a
perfonne ,
devi~nt
le
COUI ;
la
,
jociété
lu~
donne l'empire fur les aurres animaux;
,
la
fociété
fai t que non con rent de l'élemenr ou
il
, ell né , il érend fon domainé jufque fur la mer; c'ell
,. la meme union qui luí fournic des remedes daos les
, maladies, des fecours dans fa vieille!le, dn foula,
, gement
ii
Ces
douleurs
&
a fes chagrins; c'eft elle
, qui le
mee,
pour ainfi dire, en érar d,e braver la
,
forcune. O tez la fociabiliré, vous décruirez l'union
, du genre humain, d'01l dépend la oon(ervation
&
"
tour le oonheur de la vie. "
La
.fociété
étaor
li
néceífaire
a
l'homme, D ieu lui a
au
(Ti
donné une conllirution, des facultés, des talens
qui le rendenr tres-propre
a
cer érat; tdle ell, par
exem ple , la faculté de la parole, qui nous donne le
moyen de commun iquer nos penfécs avec tanr de
facilité
&
Je prompt!tude ,
&
qui hors de la
fociété
ne feroit d'a ucun ulagc. On peur dire
il
m~me
chofe
du pcnchant ii l'imitarion,
&
de ce merveilleux mé–
chanifme qui fiti t que les paffions
&
rouces les imprel:
oons de l'ame , fe communiquenr
li
aifémenr d'un
cerveau
a
l'aurre ; il fuffit qu'u n homme paroi(Te ému.
p11uv nous émouvoir
&
nous are ndrir pour lui:
homo
jm11,
hmna11i a
m~
nihil 11/imum pueo.
Si quelqu'un
vous aborde avec la joie peinre
(ur
le vifage, il ex–
cite en nous un feorimenr de joie ; les larmes d'un
inconnu nous touchenr, avanr
m~me
que nous en fa–
ohions la caufe,
&
les cris d'un homme qui ne rient
a
nous que par !'humanicé, nous font courir
a
fon
fecours , par un mouvement machina! qui précede
roure délibérarioo . Ce n'efl pas tour , nou' voyons
que la nature a voulu parrager
&
dillribuer dilférem..
ment les ralens entre les hommes , en donnant aux
uns une aprirude de bien faire cerraines chafes, qui
f<>nr comme irnpoffibles
a
d'autres; tandis que ceux–
oi,
'l
leur
~our,
onr une inrluflrie qu'elle a refufée
aux premiers; ainíi,
li
les befoins nacurels
des
l¡pm–
mes les font dépendre le¡ uns des aurres, la diver–
fité des talens qui les rend propt·es
A
s'aider mucuel–
lement, les líe
&
les unir. Ce font lii anrant d'indi–
ocs bien manifeftes de la dellination de l'homme poul!
iafociété
.
Mais
li
nous confultons notre penchanr, nous fen–
rirons aulli que narre cccur fe porte narurellement
a
fouhairer la compagnie de nos femblaoles,
&
a
crain–
dre une folirude emiere comme un érar d'abandon
&
d'ennui. Que
li
l'on recherche d'ou nous vient cecee
inclinarion liante
&
fociable, oo rrouvera qu'elle nous
a éré donnée rres-a-propos par l'auteur de na rre !ere
paree que c'efl dans la
.focifté
que l'homme rrouve
. le remede
a'
la plupart de fes befoins'
&
l'ocoalion
d'cxercer la plílpa rr de fes faculrés ; c'ell la, fur–
wuc, qu'il pcut éprouver
&
manifefler ces fenti –
mens, auxquels la narure a arraché ranr de
douceu~,
la bienveillance, l'amitié, la oompaffion, la généro–
firé: car re) efl le charme de c;es affeélions lociables
que de- la naill'ent
110s
plaifir~
les plus purs. Hien en
elfec de
r,
facisfaifant ni de
r,
flmeur, que de penfer
que l'on mérire l'ellime
&
l'amicié d'ancrui, la [cien–
ce acq uiert un nouveau prix ' ·quand elle peut
fe
pro–
duire au dehors;
&
jamais la ¡oie n'ell plus vive que
lorfqu'on on peut 'la faire écla rer aux yeux des aurres
ou
la
répandre dans le fein d'un ami ; elle
re~o~ble
en fe communiquanc, paree qu'a norre propr-e I:Hisfa-
t.hon
















