
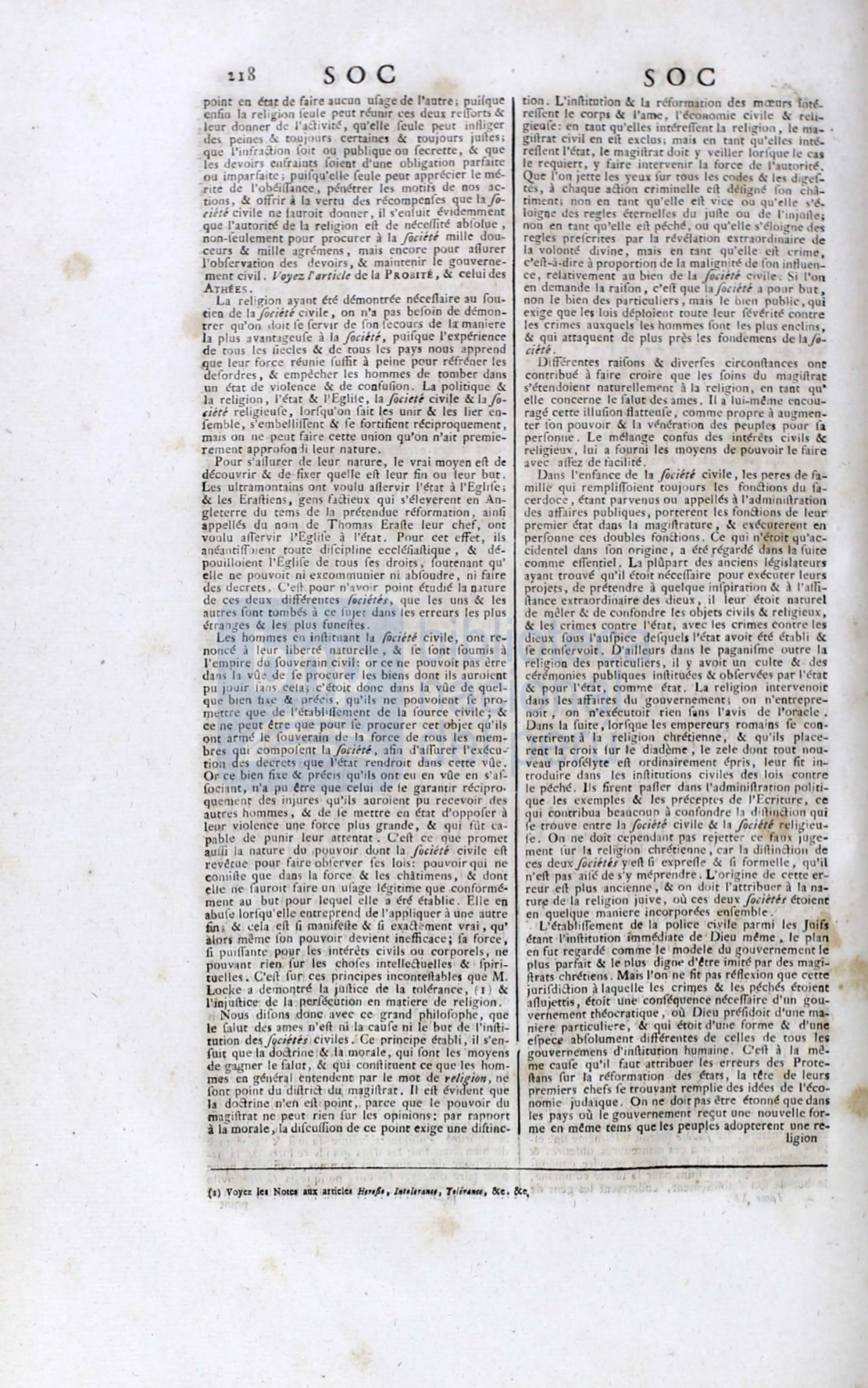
'
so e
point eo
~~
de faire aucun ofage de l'aotre ; puilque
fin la rel•"i<>n fcul e pcut
r~rur
ces dc111 r lfom
&
leur donne('dc l'aéhntl, qo'elle fculc peut inlliger
des peines • uj urs certtines ·
ujours julles;
que l'mfra 10n fo• r ou publiqoe oo fecrette,
&
que
les devoirs eufraiots foicnt d'une obligarion parfaire
ou imparfaire; puifqu'ellc feule peot
appr~ier
le mé–
nce de l'obéilfance, péoérrer le motifs de oos ac–
tions,
&
olfrir
a
t:1
verru d.,s récompenfes que 13
fo–
rih é
civil e
n~
laoroir dono r ,
i1
s'enlu1t év1dCIJ)ment
que l'autonré de la rehgion ell de néceiTiré abtoluc ,
non-feulement pour procurer
a
la
forihE
milie dou–
ceurs
&
milie agrémens, mais encore pour aflu rer
l'obfervarion des devoirs ,
&
maintenir le gouverne–
ment civil.
1/oyt:::. r
Drtidt
de la P
ROBITÉ,
celui des
ATHtE~.
La rel igion ayant éré démonrrée néceflaire au fou–
cicn de
la}oúété
c1vile , on n'a pas befoin de démon –
rrer qu'on do1t fe fcrv1r de fon lccours de la: maniere
la plus avanmgcufe
a
la
jócihé.
puifque l'e>tpérience
de rous les Jiccles
&
de cous les pays nous apprend
que leur force réunie fuffi r
a
peine pl'ur réfréner les
dcfordres ,
&
emp~cher
les hommes de romber daos
un érat de violence
&
de confufion. La politique
&
la religion, l'éca r
&
I'Eglile,
lafociué
civile
&
lajó–
cihé
religieufc , lorfqu'on fai t le unir
&
les
li~r
en–
femblc, s'embellitrenr • fe fortifienr réciproquemenr,
mais on ne peur faire cen e union qu'on n'air premie–
remen! approfon-:li leur na cure .
Pour
·~flurer
ele leur narure, le vrai moren ell d<
découvrir
&
de fixer <¡uelle en leur fin ou leur bur .
Le ulrramoncains onr voulu aflervir l'érar
a
l'Eglrfe;
& les Eralliens , gens fJ ie1Jx qui s'éleverenr en n–
glererre du rem de
la
prérenduc réformation , a•nli
appellés du nom de T homa Erafie leur chef, ont
voulu afl'ervir I' Eglite
a
l'éra r. Pnur cet elfer' ils
anéantitr >lent roure difcipli ne eccléliaflique ,
&
d~pouilloienr I'Eglife de rous fes elroits, fou renant qu'
elle ne pouvoit ni exrommunier ni abfouelre, ni fal re
des d,;crers. C'ell pour n'1voor point érud1é la nJture
de ces dcux dilféremes
(ociétés,
que les uns
&
les
nurres fonr rombés
~
ce íu¡ec dans les erreurs les plus
.!cranges
&
les pl us funelles .
Les homm<s en infi iruanc la
(ociétt
civile , onr re–
naneé
a
leur
liberr~
naturelle '
&
t'e font foum is
a
l'empire du fouvera in civil : orce ne pouvoir pas i!rre
dans la vOe de fe procurer les biens done ils auruicnt
pu juuir fans cela; c'éroit done dans la vOe de quei–
EJUC
bum
fa
e
&
flrécis, qu'ils ne pouvoient fe pro–
meerre que de l'érablilfcmcnr de la fource civilc;
&
ce ne peur erre que pour
fe
procurer cec objer qu' il
onc armé le fo uverain de
13
force de rou les mem–
bres qui
compofe.nrla
Jóciété ,
afin d'atrurer l'exécu..–
t ion des decrers que l'érar rendro•r dan eerre víle.
Or ce bien fixe
&
préc1s qu'ds on r eu en vOe en
s'a l~
(ocianr, n'a pu
~ere
que celui de le
~aranrir
récipro.
q1,1emenr des injurcs qu'ils auroient pu recevoir ele
aun·es hommes,
&
de le merrre en érar d'oppofer
a
leur violence une force plus
gr~nde,
&
qui ftlr ca–
pable de punir leur arrenrat . C'ell ce q1.1e promer
auffi la nacure du •Plll!voir dunr la
fociété
civile dl
¡•e v~cue
pour faire oblcrver fes lois: pouvoir qui ne
con~illc
que daos la force
&
les
ch~eimens,
&
done
elle ne fauroi r faire un ulage
l~gitime
que conformé–
mene au bur pour lequel elle a éré érablie . Elle en
abuló lorfqu' elle enrreprenel de l'appliquer
a
une autre
fin ;
&
.:ela ell fi manifefie
&
p
exaél~ment
vrai , qu'
il.lPts meme fon pouvoir deviene inefficace ; fa force,
fi
pLnflance poqr les intérers civils ou corgorels, ne
pouvanr .rieiJ fu r les
c~of~" in~elleéluelles
&
ípiri–
ruelles . C'ell fur
~es
pnnc1pes mconrefiabl es que M.
Locke a demor¡rré la jullice ele la rolérance, (
1 )
&
1'1nju(lice de la Jltlffécurion en mariere de religion.
Nous dilons done
avec
ce grand philofophe, que
le fal ut des ame9 n'ell ni la caufe ni le 'but de l'inlli–
tntioo des_(qcíhé.n civiles. Ce princi¡¡e érabli, il s'en–
fuit que la
Llq
rine
& ,1~ mc;>r~ le ,
qui font les 'moyens
de gagner le fa lur ,
&
qui conlliruenr ce que les hom–
mes en générq l en tendeno par le mot de
l'tligió11 ,
ne
{onr point du diftritt d.u, magillrat. 11 en évidenr que
la doarine n'en en, point
;:
paree que le pouvoir du
.ma,.ifira e ne peor r ien fu r les opinionS'; par rar.J)ort
i
¡.f
morale,da di[cuffion de
~e
point exige une dlftinc-
'
so e
tion. L'inlliro 'on
&
13 réformmon des m ors
In~retre~t
le corps
&
1'3
,
l'~coRomie
cn•1le
&
ro.:h–
g.eule: en not qu'elles inrere-trcnr
13
reh ·
clll ,
le rnJ–
g.llrar civil en ell e clu ; m1is n rant i¡u•
·11
mll!–
rellenr l'écn le rnlgillr:1r doir
y
'eillcr lorlque le ca
le requiere,
y
fa~re
in
n•en~r
la
furce de l'au ricé.
Que l'on jerre le yeux IÜr rou le·
~e ·
&
1.- d11!
.¡:.
, a
chaqoe 1clion cnminelle cll Mlign.! to n 'h.t–
rimeo ; non en rant qu'elle ell ,·ice
ou
qu'clle
•¿_
loigne des
re~les
c!rerndle du ¡ulle ou de l'tnjoll ;
non en nt qo'elle ell péché, ou qu'elle
' <'IOII!IlC
<les
regles prefcrares par la révéiJnon exrraordui:ure de
la
volonté dtvine, nni en ranr qu'elle cJl ·rime
c'ell-.1-dire
a
proportion de la maligmré de
Ion
intluen:
ce, reiJeivement au btc."'l de
1~
JDáhl
CJ\•JI . i l'on
en
dema~de
la raifon, c•en que
IJ.{o(lhé
J p ur bu r,
non le bu.-n des plrriculter , m1i le b1en public, qui
e~i
0
e
que les lois déploient roure leur
(é
éritc! COJI!Ce
le crimes auxquels le homm fonr le plu endm
&__
q?i m aquenr de plus prl!s le
fond~mcns
de
la.fo:CIU~ .
D ilft!rcnres raifons
&
diverfes circonllnnc
onr
conmbué
a
falCe croire que les foin du lllJgillrat
S'étendoient
naru~ellemPnt
aJa
rclig10n, Cn mot qu•
elle concerne le lalut des ame .
11
a
IU1-m~m~
encou–
ragé cerre il lufion tbrreu!'e , commc propre
i\
augmc.-n–
rer Con pouv01r •
Lt
~néranon
de peuplcs pou r fa
perfonne . Le mélange confus des intérc1u c•vils &
rdigieux, lui a fo urni lc.-s moyens ele pouvoir le FJire
avec aflez de faciliré.
Oans l'enfance de la
jódhl
civile, le peres de fa –
millc qui remplilfoienr toujou rs le fonllion elu
1;¡.
cerdoce , t<mnc parvenus 011 appellé ill'aelmin•firurion
Jes atfaire publiques. porrerenr le ron ions de leur
premier érar daos la mag• llrarure
&
e
•é
urercne en
perfonnc ces doubles fon ions. Ce qui n'étoir qu'nc–
cidenrel dans ton origine, a été
r~gardé
dans la fui re
comme etrenriel. La plílparr des anciem législateurs
ayant rrouvé qu'll étolt nécetl3ire pour e•écuter leurs
projers' de prérendre
a
quelque infpirarion
& :\
l'niTi–
llance exrraordinaire de dieux , il leur éroit naturel
de
n1~ler
&
de confondre les objc.-ts civils
&
rehgleux ,
&
les crimcs conrre l'érar, avec les crimes l'onrre les
dieux fou l'aufpice dcf(¡uels l'émt avolr été érabli &
fe cunlervoit. D'ai lleurs dans le paganifine oucre In
religion des parriculiers, il
y
avo1t un culte
&
des
cér~monies
publiques infiiruécs
&
obfervécs par l'état
pour l'érat, comme érat. La rcligion lntervenoit
dans les
alfa~res
du gouvernc.-mcne; on n'entrepre–
noir, on n'exécuroir rien fans !'avis de l'oracle .
Daos la fui ee, lorfque les
empereur~
romains fe con–
verrirent
a
la religion
chré~ienne'
&
qu'ils place–
rene la croix fur le diademe , le zele done rou t nnu–
veau profélyre eft ordinaircmenr épris, leur fir in–
eroduirc dans les infiirutions
civiles
des lois concre
le péché . l is firent palier dans l'adminillrapon politi–
que les cxemples
&
les précepres de I'Ecrirure, ce
qui conrribua beaucouf'l
il
confondre la dillHJélion qui
fe rrouve entre lo
jóciété
civile
&
In
fociité
reli~ieu{e. On ne doie cepenJan r pas rejerrer ce fa 11x ¡ugc–
menr (ur
13
religion chréeienne, car la dinin 1011 de
ces
deux.fociéth
y
efl fi exprefle
&
fi formelle, qu'il
n'efl pas aifc de s'y méprendre. L'originc de cecee er–
reur ell plus ancienne,
&
on doi r l'attribuer :\ In na–
rur~
de la religion juive , ou ces deu x
fo.:iéth
étoient
~n
quelque maniere incorp?rées .
.:~femble
..
.
. L'érabl ilfement de la pollee
c~lle
parm1 les Ju•fs ·
étant l'lnllitmion immédiare de Dieu
m~me
, le plan
en fut rcgardé comme
'1~
modele d_u gou vernement l.e
plus parfait
&
le olus d1gn<'
d'~rre •mm~
par
de~
mng•–
llrats chrétiens. Mais 1on ne fit pa1 réflexion que ceete
jurifdiél:ion
~ ~aquelle
les crio¡es
&
l e~ ~éch~~
écqient
3
fluiettís étolt un!:> conféquence nécelfalfe d nn gou–
verheme~t
théocrarique, ou Oieu préfiqoit d'une ma–
niere pareicul iere,
&
<¡Ui éroir d'uue forme
&
el'une
efpe'ce
abfolume1~t ~ilférenres d~ cclle_~
ele, rous le5
gouveroémens d'mfiltUtiOO huma lile . C efi a fa mi!–
me caufe qu'il faut arrribuer les erreurs eles Prore..
nans fur la réformarion des érats, la
r~re
de leurs
premiers chefs fe rrouvanr remplie des idées de l'éco–
pomie juda'1que. On ne do•r pas i!rre
~ronné
que dans
les 'pays ou le gouvernement recsur une nouvelle for–
me en
m~me
rems que les peuples adoprerenr une re-
'
ligion
(~)
yoyct
!~• Note~ aa~ a~riclc.o H!"l~,
ff!l"•'"!•
?'llí'•ll<f•
&e.
~e,
















