
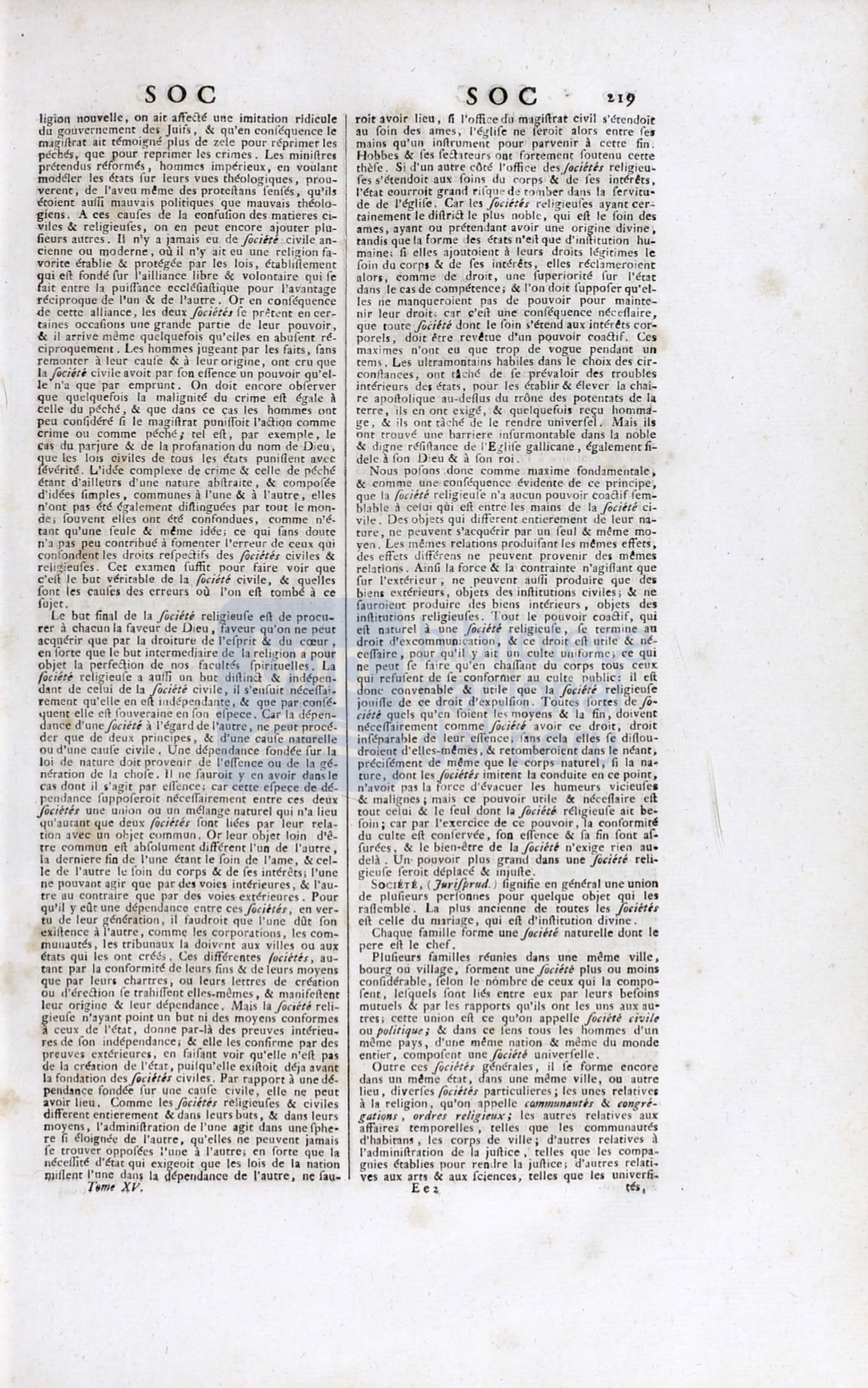
soc
ligio" nouvelle, on air affeélé une imlcation ridicule
do g.ouvcrnemenc _des Joiis,
&
qn'en conl"equence le
magifirat ait témoegné plus de zcle pour réprimer les
pécnés, que pour reprimcr les crimes. Les miniflres
précendus réformés' hornmes impérieux' en voulane
modéler les écacs fur leurs vues théologiqucs, prou–
verenc, de l'aveu
m~me
des proccfians fen(és, qu'ils
éroient aufli mauvais politiques que maovais théolo–
·giens .
A
ces caufes de la cwnfu!ion des matieres
ci–
viles
&
religieuies, on en peut encore ajomer plu–
fieu rs autres.
l1
n'y a jamais eu de
flciite
civile an–
cienne ou rr¡oderne, ou
il
n'y
ait eu une religion fa–
varice établie
&
protégée par les lois, établillemcne
qui efi fondé Cur l'ailliance libre
&
volontaire qui fe
fait entre la puil!ance eccléiiafiique pour l'avantage
réciproque de !'un
&
de l'aurre. Or en con(équencc
de cene alliance, les deux
flciéth
fe prP.tcnt en cer–
tai nes occaiions une grande parrie de leur pouvoir,
&
il arrive meme quelquefois qu'elles en abufent ré–
ciproquemenr. Les hommes jugeam par les faics, fans
remonrcr
a
lcur caufe
& ii
leur origine, onc ero que
la
flciití civil
e avoit par fon ell"ence un pouvoir gu'el–
le n'a que par emprunt. On eloic encore obferver
que quelquefois la malignifé du crime efl
ég~le
a
celle do péché,
&
que dans ce c;as les hommes une
peu conlidéré li le
ma~iflrat
punill"oic l'aélion comme
crime oo comme pécné ; cel efl, par exemple, le
cas
du parjure
&
de la profanarion du nom de D ieu,
que les lois oiviles de tous les écacs punillent a.vec
févérité . L'idée complexe
d~
crimc
&¡
cell e de péché
étant d'ailleurs d' unc nanere
abflr~ite,
&
compofée
d'idées íimples, commuoes ill'une
&
a
l'aurre, el les
n'ont pas été égalemem diflinguées par tour le mon–
de¡ fouvem elles om éré confondues, comme n'é–
tant qu'une feule
&
m~me
idt!e; ce qui fans dome
n'a pas peu comribué
a
fomenter
i'err~ur
de ceux qui
confondent les dr<:>irs refpeétifs des
flcihh
civiles
&
re(i~ieufes .
Cet examen fuffit pour faire voir que
c'eft le but véritable de la
focih¿
civile,
&
quelles
font les cau
fe~
des errcurs ' ou l'on efl tombé
a
ce
fu jet.
Le but final de la
flciété
reli~ieufe
efl de procn–
rer
3
chacun la faveur de D ieu, taveur qu'on ne peut
acqnérir que par la clroicure de l'efprit
&
du creur,
en force que le but intermecliair e de la religion a pour
objec la perfeélion de nos faculcés fp iricuelles. La
fociét¿
religieufe
a
aufli un but diflinél
&
indépen–
dant de celui de
13
fociété
civile , il s'enfuic nécdfai–
rement qu'elle en eñ inqépendante,
&
qoe par confé–
<¡uent elle efi fouveraine en fon ei"pece . Car la elépen–
dance
d'onefociété
a
l'égard de l'autre , ne peot procé–
der que de deux principes ,
&
d'une
c~ufe
nacurell<:
o u d'une caufe civile, Une dépcndance fonMe (ur la
loi de nato re doir provenir ele l'efrenee ou de la gé–
néracion de la chofe . 11 ne fauroit y en avoir daos le
cas done il s'agi t par efl"ence ; car cene e(pece de-dé-
. pendance fuppoferoit nécefrairemene entre ces deux
flciéth
une union ou un mélange naturel qui n'a lieu
4u'auranr que deux
(ociétés
font liées par leur rela–
tion avec un objet commun. Or leur objoc loin d'e–
tre <'Ommun elt abfolumcnt dilférem l'un de l'aucre,
la derniere fin de !'une écam le foin de l'ame,
&
cel–
le de l'aucre le
f"oin
do corps
&
de fes intérecs; l'une
ne pouvane agir que par
d~s
voies imérieures,
&
l'au–
tre au contraire que par des
voies
excérieo res. Pour
qu
1
il y eí\t une c;lépendanco entre
ces flcitth,
en ver–
tu de leur génération ,
il
faudroit que !'une dOt fon
exiflence
ii
l'aucrc,
comm~
les corporacions , les com–
munaucés, les
cribun;~ux
la doivenc aur villcs ou au¡c
érats qui les onr
cré.ls, Ces dilfc!renres
fociétés,
au–
tant par la conformiré de leurs fin s
&
de leurs moyens
que par leun chartres, ou leurs lettres de créacion
o u c!'éreélion fe trahill"em e11P.s.m@mes,
&
manifeflent
leur origine
&
leur dépendance.
M~is
la
flci"ét~
reli–
gieufe n'ayam point un but ni des moyens conformes
a
ceux de l'ét;Jt' donne par-la des preuves intérieu–
FeS de fon indépendance;
&
e11e les confirme par des
pr~uves
exrérieures, en faifa
m
voir
qu'e1le n'efl pas
ele la création de l'état, puifqo'e1le exifloie déja avant
la fonda cion des
fl ciétés civi les .
Par rapporr
a
une dé–
pcnd!nce fpndée fur une caufe
civil
e,
elle ne peue
avoir lieu. Comme les
flci¡t(s
re{,jgieufes
&
civiles
differe nt entierement
&
dans le4rs buts,
&
dans leurs
moyens, l'adminifl racion de l'une agic dans une fphe ·
re li éloign¿e de l'autre, q_u'e1les ne peuvenr jamais
fe crouver oppofées :•une a l'aucre;
en
force que la
nécef!ité d'état
qui
exigeoit que les lois de la narion
¡¡¡ifl~nt
!'une dae¡¡ la, dépeudance de l'aucre,
ne
fau-
TBmt
xv.
soc
·.
roit avoir lieu ,
li
l'office áu
ma~iflrat
civil
s'érendoit
au
(o in
des ames , l'égli(e ne
fe~oit
alors enrre fe•
mai ns qu'un infle·ument pour puvenir
a
cerre fin .
Hobbes
&
(es
feélateurs oot fortcment foutenu cette
thHe . Si d' un aute·e cOté l'officc eles
fociéth
religieu–
íes s'étendoir aux foins do corps
&
· de fes intcfrEcs ,
l'écae eourroit g ranel rifque de tomber dans la fervicu·
de de l'églife . Car les
flciéth
religieules ayane cer–
tainement le díflriél le plus noble , qui efl le (oin des
ames , ayant ou précendant avoir une origine divine,
candis que la forme des érats n'efi que d_' in!t iru_ci_on hu–
maine ;
fl
c11es a¡outoeene :\ leurs drom lég•t•mes le
(o
in du corps
&
de fes incérécs, elles réclomeroienr
alors comme de droit, une (uperiorité i"ur l'écae
dans '¡e cas de compétence;
&
l'on
do it
fuppofer qu'el–
les ne m3nqueroiene pas de pouvoir pour mainte–
nir Jeur droit; ca r v'efl une conféquence nécellaire,
qúe courc
fléihé
done le loi n s'écend aux
intér~ts
cor–
porels, doit
~tre rcv~tue
d'on pouvoir coaélif. Ces
maximes n'out eu que crop de vogue
pendan~
un
tcms . Les ultmmontains habiles dans le choix des cir–
con/lan ces, out tAché de
(e
préva loir des troobles
intérieurs des états, pour les établir
&
élever la chai–
re apofiolique au-dellus du tr<lne eles pocentars de lít
rerre, ils
en
ont exigé ,
&
qnelquef~is
rec;u
ho~u~d
ge ,
&
ils ont taché ile le rendre umverfel. Maes els
onr trouvé une barriere in(urmontable dans 13 noble
&
digne réliflance
d~
l'Eg life gallicane, égalemenc fi–
dele
~
Ion D ieu
&
a fon roi .
Nous pofons done comme maxime fond amemalc,
&
comme une conféquence évidenre de ce príncipe,
que la
(ucihé
religieu(e n'a ancun pouvoir coaéli f fem–
blablc
¡\
ce! ui qlii
efl:
entre les mains de la
ficiété
ci–
vile. Des objecs qui difFe renc entieremenc de leur na–
cure, ne peuvent s'acquérir par un feul
&
m~me
mo–
yen . Les
m~m es
relations produifant les
m~mes
elfecs ,
des effers di fférens ne peuvent provenir des
m~mes
rci3 tlons.
Ainii
la force
&
la
conc~aime
n'agi!lant que
fu r l'extérieur, ne peu vent aulle produí re que des
biens extél'ieurs, objets
de~
inlticutions civiles;
&
ne
(auroieert produire eles biens intérieurs , obj ets des
inlticutions religieufes . T our le pouvoir coaélif, qui
efl naturel
a
une
flciéf¿
religieu le, fe rerm ine au
droit d'excommunecation ,
&
ce droit efl mile
&
né–
cell"airc, pour qu'il
y
aie un cult<! un iforme ; ce qui
ne peut fe faire qu'en chall"anc du corps cous _ceux:
qui refufent de fe conforn1er au culee pnbhc: el efl
~onc
convenable .
&
m ile que la
fláété
rel igieufe
¡ouifre de ce droe t cl'expu Uiop . Toures fo rres
Cle
fl–
ciété
quels qu'en foient le moyens
&
la fin, doivene
nécell"a irement comme
fldétí
avoir
c.:
droic, droit
inféparable de leur elle nce; !ilns cel3 elles
(e
dillou–
droient
d'elles-m~mes,
&
retomberoient dans le néant,
préci fément de meme que le corps nacurel , íi la na–
cure, dont les
(oúétés
imirem 13 conduice en ce point,
n'avoit
pas la torce d'évacuer les humeurs vicieufes
--&
malig nes¡ mais ce pouvoir urilc
&.
nécellaire ell
tour cel ui
&
le feu l done la
flciét;.
réligieufe aic be-
. (oiu; car par l'exercice de ce pouvoir, la
conformir~
du culee efl coufervée, foo efl"ence
&
(3 fin fonc af–
(urées ,
&
le bien-@cre de la
flciétf
n' exige rien au•
del~
. Un• pouvoir plus grand dans une
]Ociété
reli–
gieufe feroit déplacé
&
injufle .
So c iÉTÉ, (
]tn·i./Prt~d.)
lignifie en généra l une union
de pluiieurs perfonnes pour quelque ob¡"et qui
les
ra!lemble. La plus ancienne de comes es
flúétis–
efl celle do ncariage, qui efl d'inflicurion divine .
Chaque famille forme une
Jociété
nacurelle done
le
pere efl le chef.
Plu!ieurs familles réunies dans une meme ville,
bourg o u village , formene une
flciété
plus ou moins
coniiC!érable, (elon le nómbre ele ceux qui la compo–
(enc, lelquels fonc liés entre eux par lcurs befoins
mucuels
&
par les rapports qu'ils onc les uns aux au·
eres ; cecee union efl ce gu'on appelle
flciété ci'IJile
ou
politiq11e;
&
dans ce !ens tous les hommes tl'un
meme pa ys, d'uue méme nation
&
rn~me
du monde
entier , compofent une
flciét6 oniver(el
le .
Oucre ces
flciétés
générales ,
il
fe forme encore
dans un mc!me état, áans une meme ville, ou aucre
lieu, di verles
{ocihh
particulieres ; les unes
rela~ive'
a
)a
reJigion, qu'On appelle
CO!ll1lllln411tÍS
&
congré–
gatÍQnf,
ordres
religie11x;
les
autr~s
rel acives aux
affaire; tem porelles, celles que les communaurés
d'habirans, les corps de ville; d'aotres relarives
il
l'adminiflration de la juflice, celles que les
comp~.
gnies établies poor rendre la jufiice; d'amres
~clan
ves aux arrs
&
aux fciences, eelles que les
umverli~
Ee ~
~ .
















