
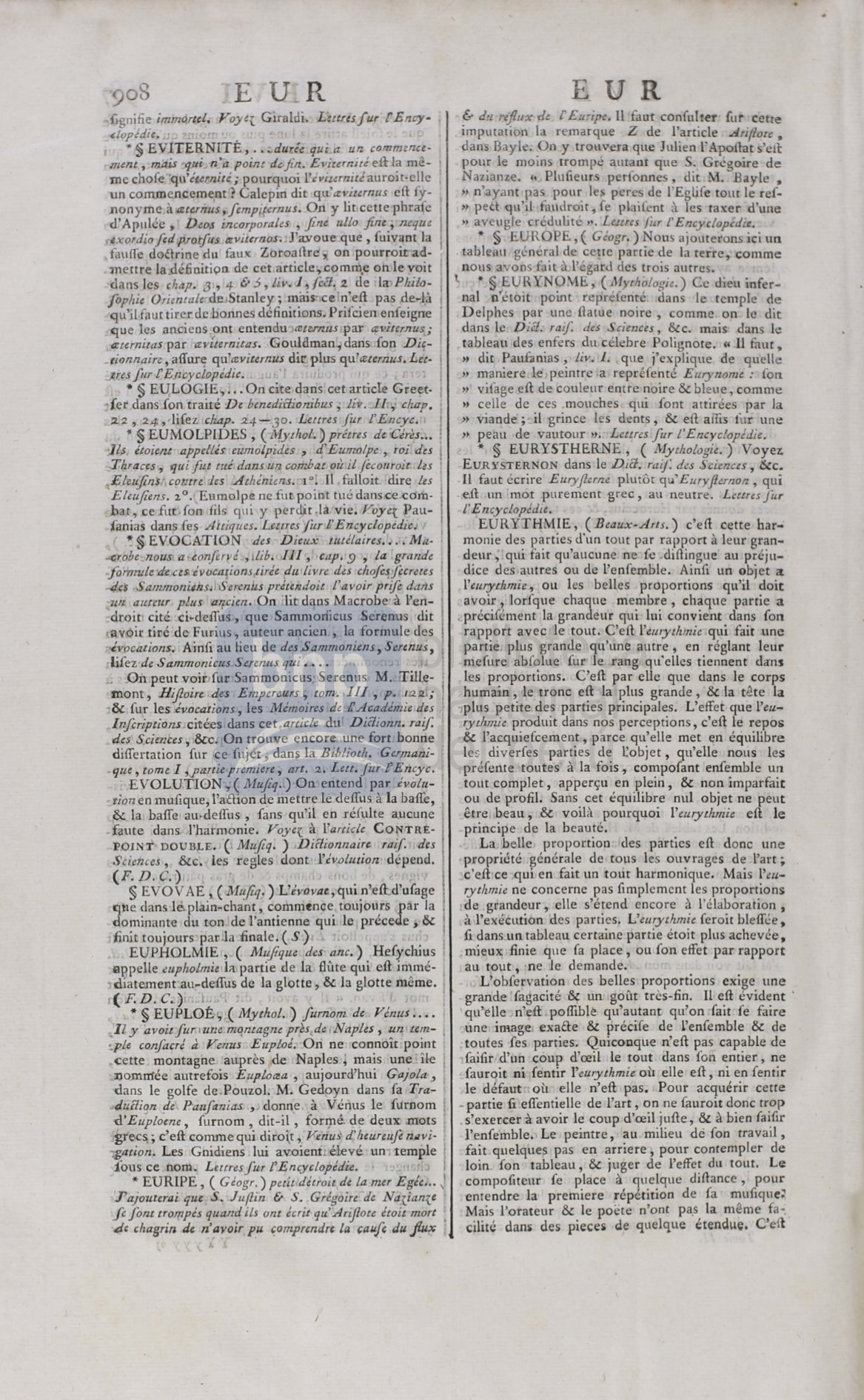
:;cJ
EUR
fignifie
immortel. Y oye{
Giraldi.
Lettrts fur
t
Ency·
~lopidie.
*
§
EVlTERNlTÉ, ...
dude
qui
a un commence·
ment , mais
.JJfti
n•a point de- fin . Eviternité
efr
la
me–
me chofe
qu,étu:nité;
pourquoi
1'
viurnicé
auroi -elle
un
commencement
?
Calepin dit qu.
aviternus
efi: fy–
nonyme
a
auernus ,Jempitemus.
ÜJl
y
lit cette pbr$
d'
Apnl
' e,
D~o.r
incorporales
,
fine ullo fine,
neq.ueexordio fid p.rotfu.s tEVÍtemos.
J'.a:.voue que , fuivant la
filuife doélrine du faux Zoroafi:re '· on pourroi.t-ad–
mettre la.défioiti9n de cet article,.comrn.e on le voit
dans les
chap.
3
,
4
&
S,
tiv.
1,
{rE.
2
de la
Philo–
fophie Orimtale·
d~
.Stanley; mai ce n'efi: pas
d..e-Ja
qu~il
faut tirer de bonnes défioirions. Prifcien enfergne
que les ancieos ont entendu
teternas
par
a:viternus;
-atemitas
par
a:vitemitas.
Gouldmao, dans fon
Dic–
tionnaire ,
aífw-e
qu'aviternus
dic. plus
qu
1
atemus.
Let.
tres Ju.r
t
Encyclopédie.
*
§
EULOGlE, ..• On cite daos cet
artid~
Greet–
fer dans Ion traité
De
benedimonibus, lív.
ll,
ch.ap.2.2,
24,
lifez
clz.ap•.24-30.
Lettres j'¡¿r L'En.cyc.
*
§
EUMOLPIDES, (
!tfythol. ) prétres de Céres._..
ll;
étoicnt appe!Lés eumolpides ,
d'
Eumo!pe
,
roi
des
.Thraces, -qui fut tué dan.s un comhat
ou
iL
fecortroit
L
s
Ele.ujins
comre les .Athéniens.
1° .
Il
falloit dire
les
Eleujiens.
2
°.
Eumolpe ne fu t point tué dans ce com·
hat,
ce
fut
fon
ñls
qui
y
perdjt .la vie.
Voye.{_
Pau–
{anias
·dan~
fes
Auiques. .úures fur t'EncyclopUie.
*
§
EVOCATION
des Dieux tutélaires.•..
Ma·
~rohe
nous-a •4.onfervé ,!lib• .]]/,
cap.9, ta
grande
formule
·de
ces évocations,tirée du Livre des clzofesJecretes
.de6
S ammonieizs.
u
erenus prétendoit
L'
avoir prift dans
'UIL
auteur plus drpcien.
On "lit daos Macr
obe· a l'en–
clroi cité
ci...&e.ífus ,
que Sammoclieus
j)
er.era.usdit
avoir tiré de Furius, auteur ancien , la formt:tle des
évocations..
Ainfi au lieu de
d"s.Sammoniens, Ser.enus.,
lifez
de. S ammonicus S eremts qui
••••
. _On peut voir fur Sammooicas 'Sexenus
M.
:till,e–
mont,
Hijloire
des
Empereurs, torrn
111,
p • .
ll2.Il.1;
,
&
fur les
év_ocarions,
les
Mémoires de
J1
Aaadémie des
lnflripzions
citées dans
cet .article
du'
Diélionn•
.raif.
des S.ciences,
&c.
On
trou:J.Teencor<t une fort bonne
diífertation fur •Ce fujet, dan$
la
Bihlioth. Ger;nani–
que, tome 1 ,prutie
premiere,
art.
..2.
Lett.
Jur
t
Encyc.
EVOLUTlON
7 (
Mujiq.)
On entend par
.évolu–
tion
en muíiqu.e, l'a:B:ion de metrre le deifm
a
la ba1Ie,
&
la
baífe
au~deífus
, fans qu'il en .réfulte aucune
, fat.lte dans l'hatrnonie.
Voye{
a
l'artic/e
CoNTRE–
l'OlNT
DOUB~E.
(
Mujiq.
)
Diélionnaire
raif. des
Scie'hces
,
&c. les regles dont
1'
évolution
dépeod.
(F.
D.
C.)
•
§
EVOVAE, (
Mufu¡.)
L'évovar:.,
qui
n'efr_d'ufage
que
dans
le
plain-.chant,
comrn~nae
toujours par
la
dominante du non de l'antienne qui
le
précede
;
&
finit toujours par .la iinaie.
(S)
EUPHOLMIE , (
Miifique des anc.)
Hefych.ius
¡¡P,pelle
eupholmis
la partie de la flute qui efr immé–
diatememt
atv-de:íf~s
de la glotte'
&
la glotte rneme.
(F.
D. C.)·
*
§
EUPLOÉ, (
Mythol.
)
fumom de Vénus •••
•
~'ll
y
avoit Jur
•
une montagn.e
pies
d~ ,
N
aples
,
un
tem-
..ple confacré
a
Venus
Euploé.
On
ne
connoit point
.::ette montagne aupres
de
Naples; mais une ile
no.mmée autrefois
Eupl.o~a
,
aujourd'hui
Gajota,
dans le golfe de .Pouzol. M. Ge.doyn dans fa
Tra–
áu.c1iqn fie Paufanias ,
donne
a
Vénus le furnom
d'Euploene,
fumom , dit-il , formé. de deux mots
-gre.cs.;
e'
eft cornme qui dir.o\t ,
Venus d'
h.eureufe
n.Jlv
Í·
:gation.
Les Goidiens lui
avo:ieni~
élevé un temple
ÍOlJS
ce nom,
Leures fJtr
l'.Encyclop.édie.
·
*
EURIPE, (
Géogr.) petit détroit de lamer Egle...
'J'ajourerai
que S. Juflin
&
S. Grégoire de Na{Íanz.e
fe
font trompés
qu.a.ndils
ont écrit qu''.Arijlote étoit mort
4e.
chagrin de
n~
ayoir p_u
~omprendre
la
'au[c du jl_ux
&
du
·
iflttx de
r
Eu~ip
.
Il faut confulter fur
e
te
imputation
l
remarque
Z
de
1
arricle
,¿¡
ijlot
•
dan Bayl .
n
y trouvera qtt Ju.lien l'Apo:ftat
'
it
pour le moins tromp autanr que
r ·
uoire de
Nazianze. " Plufieur
p
r
onne , dit .
~.
B
yl
,.
»
n'ayant pas pour le per
de l'Ealife
tom
le
r
•
)>
pe
l qu
il
faudroit'
[e
plai nt
a
les taxer d·une
»
aveugle crédulité ''·
Lettres
{ur
t
Encycfopldi.e.
*
§
E
O
E, (
Géogr.
)
ous ajouterons ici un
tableau géoéral de cette partie de la terre comme
nous a ons fait
a
1'
1
gard des trois autres.
'
'
*
§
EURY OME, (
11-fychologie.)
dieu infer-
nal
n
étoit point
r.
prefemé dans
le temple de
Delphes par une fiatue noire , comme on
le dit
dans
le
D iál. raif. des Sciences,
&c. mais dans
le
tableau des enfers du cél bre Polignote. "
U
faut
" dit Pauúmias,
Liv.
l.
qne
j
e plique de
quell~
;~
maniere le peintre a repr ' fenté
E urynome. :
on
»
vifage eíl: de coulenr entre noire
&
bleue, comme
, celle de ces mouches qui font attirée par
Ja
>)
viande; il grince les d nts,
&
efl.
affis fur une
>}
peau de vautour
>
•
Lettr s j'ur L'Encycloptdie.
*
§
EURYSTHERNE, (
A-fyehologie.)
Voyez
EURYSTERNON dans le
Dia. raij: &s
Sciences,
&c.
Ilfaut écrire
Eury.fterne
plu ot
qu'
Euryftunorz.,
qui
e.ftun mot purement grec, au neutre.
Lettres fur
i' Encyclopédie.
EURYTHMIE, (
Beaux-Ares.)
c'efl cette har..
monie des parties d'un tout par rapport
a
leur gran–
deu.r, qui fait qu'aucune ne
{e
difiingue au préju–
dice des autres ou de l'enfemble. Ainfi un 9bjet
a
l'euryt-hmie,
o u les belles proportions qtt'il doit
avoir, lorfque chaqne membre , chaque partie
a
préci{ément la grandeur qui
luí
convient dans fon
rapport avec le tout. C'eíl:
I'eurythtni.e
qui
fait une
partie. plus grande qu'une autre, en réglant leur
mefure abfolue fur le rang qu'elles tiennent
dan~
les proportions. C'eft par elle que dans le corps
humain.,
le tronc efi la plus grande ,
&
la
t~te
la
· plus petite des partíes principales. L'effet que
l'eu-
rythmie
produit dans
nos
perceptions, c'eft le repo&
&
l'acquiefcement, paree qu'elle met en équilibre
les diverfes parties de l:objet, qu'elle nous les
préfente toutes
a
la fois ' compofant enfemble un
tout complet, apper<;u en plein ,
&
non imparfait
ou de profil. Sans cet équilibre nul
objet
ne peut
etre beau'
&
voila pourquoi
l'eurythmie
eft le
príncipe de la beauté.
La belle proportion des parties eíl: done une
propriété géoérale de tous les ouvrages de l'art;
c'eft ce quien fait un tour harmonique. Mais
l'eu–
rythmie
ne concerne pas fimplement les proportions
de grandeur' elle s,étend eocore
a
l'élaboration ,
a
l'exécLúion des parties.
L'eurythmie
feroit bleífée,
fi
dans un tablea
u
certaine partie étoit plus achevée,
mieux finie que fa place, ou fon effet par rapport
au tout , ne
le
demande.
L'ob{ervation des belles proportions exige une
grande fagacité
&
un goirt tres-fin.
n
eft évident .
qu'elle n'edl poffible qu'autant qu'on fait fe faire
une imagre exaéle
&
précife de l'enfemble
&
de
toutes fes parries. Quiconque n'eíl: pas capable de
faifir d'un coup d'ceil
le
tout dans fon entier, ne
fauroit ni fentir
l'eurythmie
ou elle eft, ni en fentir
le défaut
ou
elle n'eft pas. Pour acquérir cene
partie
ú.
eífentielle de l'art, on ne fauroit done trop
s'exercer
a
avoir le coup d•ceil jufte'
&
a
bien faifir
l'enfemble. Le peintre, a u milieu dé fon travail,
fait q.uelques pas en arriere, pour contempler de
loin fon tableau,
&
juger de l'effet du tout. Le
compofiteur fe place
a
quelque diftance' pour
entendre la premiere répétition de fa
mufique~
Mais l'orateur
&
le poete n'ont pa_s la meme fa .._
cilité dan¡ des piece¡
cle
quelque
étendue.
C'efi
















