
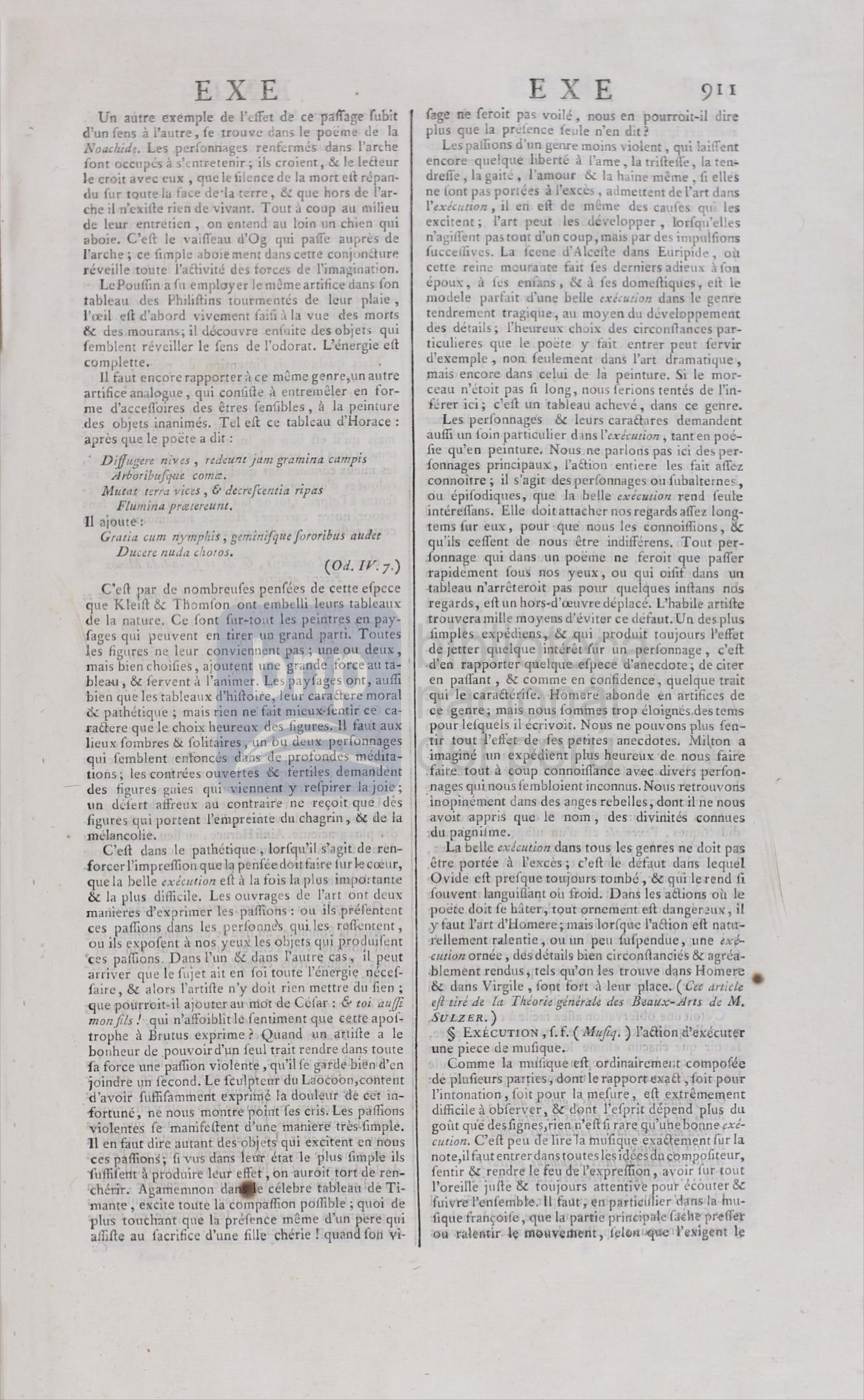
x~
n
autre exem?le
ce
alfa e fub't
d'un fenS
a
4 1
3
•re, e
rO IVC
a
1
le
po::m.
de fa
¡'
oachid!.
Les perfonn· ges rent rm '
dans l'ar he
or occup¿s
a ·
n· etenir; ib croient,
l
~
lec. eur
l e croir avec eux , qne le 1il....nce de la mort ei répan-
u fur toute a
t
e de·la
~(!rre
· :.
q te hors de Par–
che
;¡
n'c ifle ríen de
·i
:~n
..
Tou
co
J
p au milieu
de leur emreti n
on en end au loin un chien qui
aboiP, C'dl: le vaiífeau
d'Og
qni paíte aupr s de
l'arche; ce fim:>l., aboíe mene d· ns
etre
conjon~htrP.
r
1
vcille toute
1
aélivit~
des forces de l'ima·..ina·ion.
Le Pouffin a fu employer le meme anifice.dans fon
tablcau des
htlifii ns wurment 's de lcur plaie ,
l'
tl
efi d'abord v· vement fai.i
1
la
ue des morts
&
des mouran ; il d couvre
e11 1Ít
des objet qui
fembl"n r éveiller le
C
ns de !'odorar. L énergie
íl:
comple tte.
Il faut eneore rapporter
a
ce mGme genre,un autre
artífice andlogue ' q ui coníifie
a
entremeler en for–
me d ac efioire
des etres fenfibles,
a
la pein ure
des ob¡ets inanimés. T
1
efi. ce tabl au d'Horace :
a res q'ue le po"te a dir;
Dijfugere niv es , redeunt jam
gramina campis
A
rboribuj(¡ue
comcz.
Mutat
Lrra
vices,
&
decrefcemia ripas
Flwnina
prcetere.unt.
n
ajoute;
Gratia cum nymp/zis, gr:minifque f ororibus
audet
Ducue nuda choros.
(Od. IP.J.)
C'efi par de nombreufes penfées de cette efpece
que Kleifr
&
Thomfon ont embelli leurs tableanx
de la nature. Ce font fur-to ut les peintres en pay–
fagcs qui peuvent en tirer uo grand parti. Toutes
les figures ne leu r convienncnt pas; une ou deux,
mais bien choiíies, ajoment une grande force au ta–
blea-u,
&
fervent
a
l'animer. Les payfages ont, auffi
bien que les tableaux d'hifroire, leur caraétere moral
' pathétique ; mais rien ne fait mi ux·fentir ce ca–
taétere que le choix heurelt
des figures. ll faut aux
lieux fombres
&
folitaires, un o u deux perfonnages
qlli femblent entone
~s
da ns de profondes méd ira–
tions; les contrées ouvertes
&
fertiles demantlent
des figures ga ie
qui
iennent
y
refpirer
Ja
joie;
un d '{ rt affreux au contraire ne re9oit que des
figures qui portent l'empreinte du chagrin,
&
de la
mélancolie.
C'efr dans le pathétique, lorfqu'il s'agit de ren–
forcer l'impreffion que l.a penfée doit fa· re íur
k!
creur,
que la belle
exJcution
efi
a
la fois la plus importante
&
la plus difficile. Le ouvrages de l'art ont dcux
manieres d'exprimer les p ffions : ott ils préfentent
ces paffions daos les perfonne's qui les
roífcnrent,
Oll
Íls expo[i nt
a
nOS yeux les o bjer qui produifent
ces paffions . Daos l'un
&
daos Pautre cas, íl peut
~rri
er que le fujet ait en foi toute l'énergie n
1
e f–
faire,
&
alors
1
artiíl:e n'y doit rien mettre du íien ;
qu e pourr it-il ajouter au mot de
éfar:
&
toi au.fji
monfils !
qni n'affoiblltle fentiment que cette apof–
trophe
a
Brurus exprime? Qnand un artiíl:e a le
bonheur d pouvoir d un feul trait rendre dans toute
fa force une paffion violente, qu il fe g rde bién d'cn
joindre un fecond. Le fculpteur du Laocoon,<:ontent
d'avoir fuffifammcnt exprime la douleur de e
t
in–
fortuné, ne nous momre point fes cris. Les paffions
iolentes fe manifefient d'une maniere tr ' s-íimple.
11
en faut dire autant des obj ers qui e citent en nous
ces paffions; íi vus dans lettr état le plus fimple íls
fuffifetit a produire
1
ur effet , on auroit tort de ren–
ch 'rir. Agamemnon da
e célebre tablean de Ti–
mame, excite toute la compaffion poffible; quoi de
plu
touchant qne la préfence meme d un pere qui
affift
au facrifice d'une fille eh
1
rie
!
quand fon
vi-
E
I
fau
n~
feroic
ro·
-·1
dir
us que
1
pr.: n
Les
1
al ons
'
~
nre moi
io en• q
ti
en ore que ue
1
ber
e;:
a
rame
la ri le .-
. la
n–
drefi·
l
ai
:..
l'amour
' · la h
~ne m~.:m
.
i
e.les
ne iom p - po
~
1
es
a
re
·e
a m
te
t
r
~
l'exéct tio,7. ,
1l
n
eit
de
m~me
d;..s
c1
e
,· l
exch~n
;
rarr
pe
l[
1
S
•
lo per
lorC
i
e
n'a iHen pa o
u~
'un
coup
mai:, t->ar de ·mp
1ffio
.s
fu
e
1vc .
La
en d
}~etle
d
'1
E tripid
~
ou
ceue rein_ m .... urante
f
it fes d rniers adiet
,
f
époux
a
i
s maa1s,
e··
f
s dom
ili
uc , eil: l
mo de le parf ir
'une bel e
exr: u .on
an
le
g
nre
tendrem . t tragiqne, au moyen d
1
d
' v
h
e'"ment
~es
?etail · l'h
ln.u ·
hui.·
de circot llanees pJr–
tlculteres que le po ·re
y
tait
ntrer p u
(¡
rvir
d e::emple , non eule. ent dans
1
c:1rt
dram
ique ,
mats encore dans e
1
de la pein ure.
i
le mor–
ceau n'
1
toit pas
fi
long , nou ferions tent
1
s de l'in-
é rer ici; e efi un tableau a he\'
1
,
dans ce genre.
Le perfonnages
&
lcur cara ares d mand nt
auffi un foin particuli er d tn l'
x
1
CUÚon
tant en po '-
fi
'
.
N
,
te qu en
p~1n~ure.
o~•s ~e
parlons pas ici de per-
{onnages pnnctpau. , l aéhon emiere les fait aífez
connoitre; il s'agic des pcr(onnages o u fubalterne
ou épifodique , que
1a
be!l
xJcution
rend
feul~
intéreífans. Elle doit attacher no regard aífez long–
teros fur eux, pour que nous le
connoiffions ,
&
qu'ils ceífent de nous "tre indiffilrens. Tout per–
fon?age qui dans un poeme ne feroit que paífer
rap1dement fous nos yeux, ou qui oiíif dans un
tablean n'arr "teroit pa pour quelques iníl:ans nos
regards , eft un hors-d'reuvre d
1
placé. L'habile arriít
trouveramille moyensd'é
iter
ce d 'faut. Un des plus
iimples expédiens.,
&
qui produit roujours l'effet
d~
jetter quelque int
1
r "t fnr un perfonnage,
'elt
den rapporrer quelque efpece d anecdote; de citer
en. paífant,
&;-
.comme en confidence, quelque trait
qlll le caraétenfe. Homere ahonde en artificcs de
ce genre; mais nou fommes trop éloian 's des tems
pour lefquels il écrivoit.
ous ne pou
~ns
plu
fen–
tir tout
1'
$
t
de fes pecires anecdotes.
Mi~ton
a
imagme un expédienr plus heureux de nous faire
faire tout
a
coup connoiífance a
vec div rs
perfon·
.nages qui nous íembloient inconnus. Nous retrou
rons
inopin lment dans des anges r bell s, dont il ne nous
avoit appris que le nom, des divinit s connues
du pagnifme .
La belle
exicution
dans tous les genres ne doit pas
etre portée
a
l'exd:s; c'efi le défaut darrs lequel
O
ide eíl: prefque toujours rombé ,
&
qui le rend
ft
fouvent languimmt ou froid. Dans les a8.ions ou le
poete do't fe
ha
ter, toot ornem nt
efi.
danger :?ux, il
y
faut l'art d'Hom.ere ; mais lorfque l'aél:ion efr natn–
rellement ralentie
~
o u un peu fufpendue, une
exJ–
cwion
ornée, des détails bien circonílanciés
&
agréa–
.blement rendus , tels qu'on les trouve dan Homere
&dans Virgile , foot fort
a
leur place. (
Cet articte
e.fltiré de
la
Théorie
général~
des
B6aitx-Arts de M.
SULZER.)
§
ExÉCUTION,
f.
f. (
Mujiq.)
l'aétion d'.exécuter
une piece d ... muíique.
omme la muftque eíl: ordinaireme1:t compofée
de pluíieurs partíes , dont le rapport..exaa, foit pour
l'intonation, foir pour la mefure,
eft
extremement
difficile
a
obferver'
&
dont l'efprit dépend plus du
goC'tt que des íignes,.rien o
1
efrfi rare qu'uhe bonne
exé–
cu.tion.
C'ell: peu delire1a muíique exaétement fur la
note,il fa ut entrer dans tou tes les idées du c'Qmppíiteur,
fenrir
&
rendre le feu de l'expreffion, avoir fur.tout
l'oreille jníle
&
toujours attentive pour écouter
&
fuivre l'enfembl.e. ll faut, en parti<tulier dans la
fnu.
fique fran9oife, que la partíe principale fadle preífet
ou ralentir
le
nH>uvement, felon
JCSIUe
l'e. igent le
















