
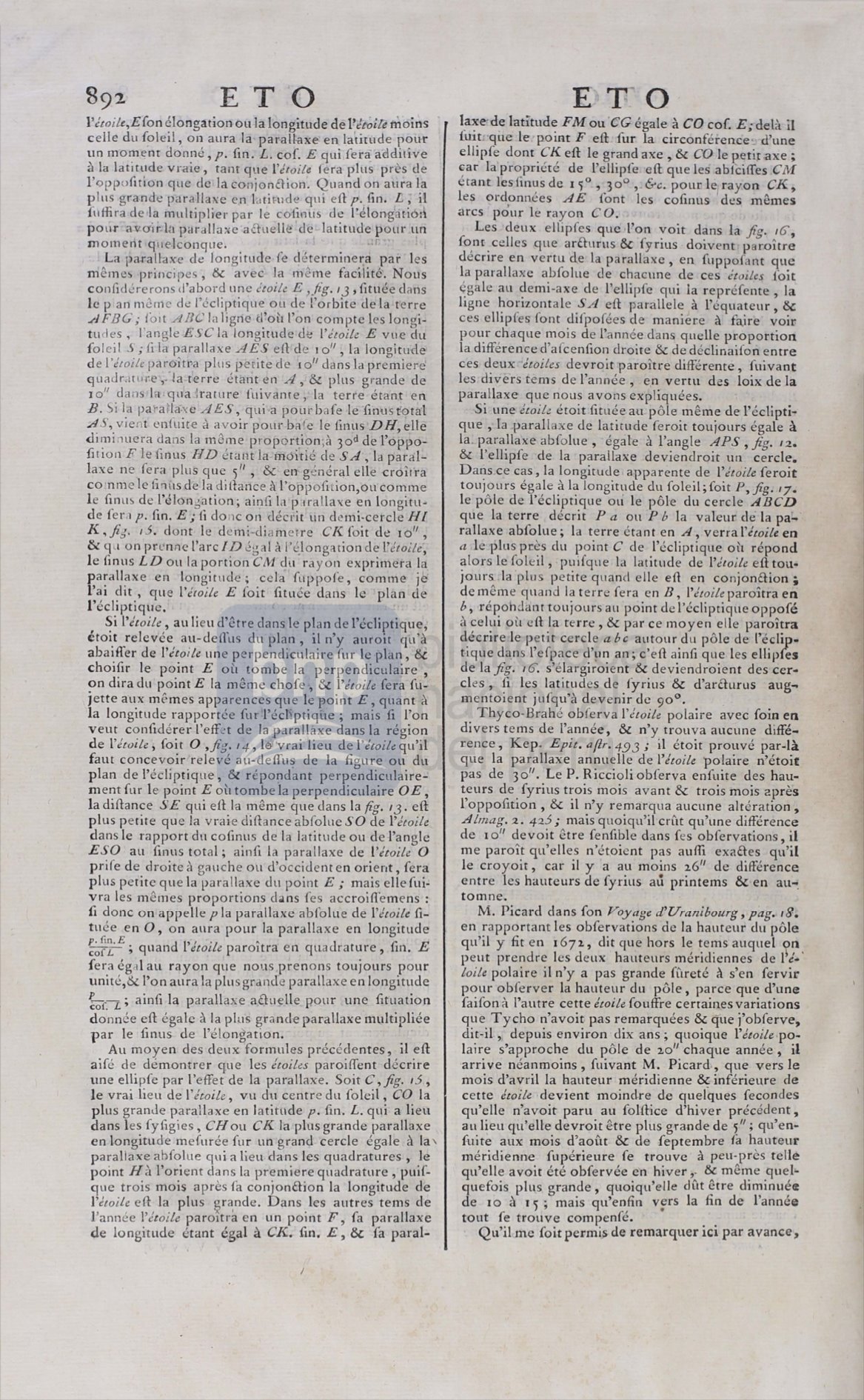
ETO
l'itoíle,Efon~longation
ou lalongitude de
t:üoile
fti.oins
celle du fole1l, on aura la par-aU-axe-en latiwde pour
un momenr donné,
p.
fin.
L.
cof.
E
qui {era: a€1ditive
a
la latitude vraie' tant que
l'étoile
(era
plus pres de
l'<>ppofition que de la c:onjonétion. Quand on aura la
plns gr·a-nde paralla ·e en
lt:~tit=ude
qui eft
p-.
fin.
E,
il
fuffira de •la multipli·er par le cofious de l' élongaE-Íó1'
ponr a'V.ctit la pélraUaxe aéluelle· de latitude pour un
momerlt q ueJconque.
'
.....
La pa..r-alla.x-€ de longitude fe
qétermine~a
par les
meme~
principes,
&
avec- la meme facilité. Nous
conúdérerons d'abord llne
étoile E
,fig.
13 ,
fituée dans
le p ·an menie de l'écliptique ou de t'orbite de la rerre
..A
FBG;
loit
ABC
la 1igne
~'ottl'on
compre les longi–
tudes, J'angle,ESC la longitutle de
l'étoile E
vue du
fo leil
S;
fila parallaxe
A ES
efi de
1
o'', la longitude
de
l'étoiLe
paroitPa plus p-erite de
10 11
dans la
premien~·
quadrt~tur.e
,-·!a
t€rn~
étant en
A,
&
plus grande de
Id'
da ns l .qua 1rarure fuivance, la terre étant e!'l
B.
Si la
paraHa~xe
A ES,
qui a pour bafe le ·finus r-otal
.AS ,
vient enfuite
a
avoir pour ba fe
le
ún lls
DH,
elle
~i~i n uera
dans la meme proportion ) t
30d
de l'oppo-–
fitton
F
lefinus
liD
é ranr
la~ móitié
ele
SA,
la parál–
laxe ne. fera plus q ue 5" ,
&
en génér4l elle -croirra
CO ·nme le fi'1nS de la diftance
a
l'oppofition,ou comme
l e finm de l'Jlo¡¡¡ b'ation; ainfi la,p:ualla"e en longitu–
d e fer.1
p.
fin.
E;
fi do ne o n décri c un demi-cercle
HI
K~
fig.
d.
dont le demi-diametre
CK
foit de
1
o
11 ,
&
q lt o n prcnn e l'arc
ID
égal
a
¡·~Iongation
de
Fétoile·,
le
íinns
LD
ou la port1on
CM
du ra yon exprimera la
parallaxe en longitude; cela fuppofe, comme-
je
l:~i
?it.,
que
I'étoite
E
foit fitu ée dans le plal'l de
l echpttq\1e.
.
Si
l'étoile,
au li eu d'etre dans le plan de l'écliptique,
étoit relevée
an-deíli.tsdu plan, il n'y auroit
qn'a
abaiffer de
l'éto ile
un e perpendi,culaire fur le ·plan,
&
choifir le p0int
E
O tl
tombe la perpendiculaire ,
on dira du poinr
E
la meme chofe ,
&
1'étoile
fera fu–
jette a\lX mE- mes apparences qu e le point
E'
quant
a
la longitude rapportée fur l'écl'i'ptiqite ; mais fi l'on
veut confi.dérer
l'dfet
de ra ·parallaxe dans la région
de l'
étoile ,
foit
O
,jig.
14,
lervrai lieu de 1'
étoile
qu'il
faut concevoir relevé
au-éleífu~
de la figure on du
plan de l'écliptiq ue ,
&
r épondant perpendiculaire–
ment fur le point
E
ott tombe la perpendiculaire
OE,
la difiance
S.E
qui efi la meme que dans la
fig.
'3.
eft
plus perite qu e
la
v raie difianceabfolue SO de
l'étoile
dans le rapport du cofinus de la latitude ou de -l'angle
ESO
au finus total; ainfi la parallaxe de
l'étoile
O
prife de droite
a
ganehe
Oll
d'occident en orient, {era
plus petite que la parallaxe du point
E;
mais elle fui–
vra les memes proportions da ns fes accroiífemens :
fi
done on appelle
p
la parallaxe abfolue de
l'étoile
fi–
tuée en
O,
on aura pour la paraltaxe en longitude
~~~~-E;
quand
I'é.tÓile
paroitra en quadrature, fin.
E
fer a égal au rayon que nous,prenons toujours pour
u nité,& l'on aura la plus granefe parallaxe en Iongitude
~of:I.;
ainfi la parallaxe aéluelle p.our une fituation
donnée efi égale
a
la plus grande parallaxe ffil.lltipliée
par le finus. de l'élongation.
Au moye n des deHx formules précédentes, il eíl:
aifé de démonrrer que les
ftoiles
paroilfent décrire
une ellipfe par l'effet de la parallaxe. Soit
C
,jig.
1.5,
le vrai líe u del'
étoile,
vu du centre du foleil,
CO
la
plus grande paralla;xe en Iatitude
p.
fin .
L.
qui a lie1.:1
dans les fyfigies,
CH
ou
CK
la plus grande parallaxe
en longitude mefurée fur un grand cercle égale
a
la '\
parallaxe abfolue qui a lieu dans les quadratures ,
lB
point
Ha
l'orient dans la premiere quadrature, puif–
que trois mois apres fa conjonaion la long1tude de
l'étoile
eR la plus
~rande .
Dans les autres tems de
l'année
l'
étoile
par01tra en un point
F, {a
parallaxe
de longitude étant égal
a
CK.
fin.
E,
&
fa para!-
E.
T
O
l~e· de latitud~
FM
ou
CG
égale
a
CQ
cof.
E;
de
la
i1
iUit que le p.omt
F
eft fur la
circonférence ~
d'une
ellipfe
~ont. e¡~
efi le
gr~d
axe,.
&
CO
le petiJ: axe;
Gar la propnere de l'elhpfe ·eft que
les
abfciífes
CM
étant les finus de
1 )
0
,
3o
0
, .
&c.
pour le¡rayon
CK
~
les
ord~nnées
A E
font les cofinus des memes
ares pour le rayoa
cq.
Les deux ellipfes q ue l'on voit dans la
fig.
10,
(onf celles que arB:urus
&
fyrius · doivent paroitre
décrire en vertu de la parallaxe , en fuppofant que
la parallaxe abfolue de chacune de ces
étoiles
foit
~gale
au ?emi-axe de l'ellipfe qui la repréfente , la
hgne
~onzont a l e
.sA
~ft
parállele
a
l'équateur,
&
ces elhpfes fonr dtfpofees de maniere
a
fa.ire voir
pot~r
chaque mois de l'année dans quelle proportion
la d1fféren-ce d'afcenfion droire
&
de déclinaifo n entre
ces deux
étoiles
devroit paroitre d.üférente, fnivant
les divers tems de l'année , e,n vertu des loix de la
parallaxe que nous a vons expliquées.
Si une
étoile
étoit fituée au pole meme de l'éclipti–
qne ' la .parallaxe de la titude feroir toujours égale
a
la. parallaxe abfolue , égale
a
l'angle
A PS
,
jig.
12.
&
l'~llipfe
de la parallaxe devie ndroit un cercle.
Daos cecas, la longitude apparente de l'
étoi!e
feroit
toujours égale
a
la longitude du foleil;foit
P,jig. '7·
le po le de l'écliptique otÍ le poi-e du cercle
.ABCD
que la terre décrir
P
a
ou
P h
la valeur de
lapa~rallaxe abfolue; la terre étant en
A,
vena
l'étoile
en
a
1e plus pres du point
e
de l'écliptique oh répond
alors le foleil, · puífque la latitude de
l'étoile
efr tou·
jours..la plus petite q ua nd elle efi en conjonaion ;
de meme quand la terre
{era
en
B,
l'étoile
paroitra en
b,
ré.pohdanrtoujours au point del'écliptique oppofé
a
celui oü efi la terre'
&
par ce moyen elle paroitra
décrire le petit cercle
ah e
autour du pole de {'éclip·
t-ique d(\nSl'efpace
d'~m
an; c'efi ainfi que les ellipfes
de la
fig.
16.
s'élargiroient
&
deviendroient des cer·
eles, fi les latitudes de fyrius
&
d'aréturus aug-
mentoient jufqu'a devenir de 90°.
_
Thyco-Brahé obfe rva
l'étoile
pelaire ave·c foin en
divers t ems de l'année,
&
n'y trouva aucune diffé..
rence , Kep.
Epit.
afir.
493 ;
il étoit prouvé par-la
que la parallaxe annuelle de
l'étoile
polaire n'étoit
~as
de
3d'.
Le P. Riccioli obferva enfuite des hau–
teurs de fyrius trois inois avant
&
trois
mois 2pres
l'oppofition,
&
il n'y remarqna aucune altération,
A
lmag.
2.
425;
mais quoiqu'il cr(h qu'une différence
de
I
0
11
devoit etre fenfi.ble dans fes obfervatÍOnS, il
me paro!t qu'elles n'étoient pas auffi exaaes qu'i(
le croyoit, car il
y
a au moins 26
11
de différence
entre les haureurs de fyrius
aú
printems
&
en
au~
tomne.
M. Picard dans fon
Voyage d'Uranibourg, pag.
t!J.
en rapportant les obfervations de la hautenr du
pole
qu'il
y
fit en
1672.,
dit que hors le tems auquel
on
peut prendre les deux hauteurs méridiennes de 1
¿..'
loile
polaire il n'y a pas grande ftLreté
a
s'en fervir
pour obferver la hauteur du pole, paree que d'une
faifon
a
l'autre cette
étoile
fouffre cerraines variations
que Tycho n'avoit pas remarquées
&
qlte j'obferve,
dit-il , depuis environ ·dix a-ns ; quoique 1'
éboile
po–
laire s'approche du pole de
20 11
chaque année
~
il
arri ve néanmoins, fuivant M. Picard., que ve-rs le
mois d'avril la l:tauteur méridienne
&
inférieure de
cette
étoile
·devient
moindn~
de quelques feco.ndes
qu'elle n'avoit paru au folílice d'hi ver précédent ,
a u lieu qu'elle devroit &tre plus grande de 5"; qu'en–
fuite aux mois d'aoút
&
de feptembre .fa
haut~ur
méridienne fupérieure fe trouve
a
peu-pres telle
qu'elle avoit été obfervée e'n hiver
~-
&
meme quel–
quefois plus grande,
GJUOÍqu'elle
dt'tt e rre diminuéct
de
IO
a
I) ;
mais qu'enfin verS la fin de l'année
tout fe trouve compenfé.
•
Qa'il me foit
peJtm~
de remarquer
ici
par avance,
















