
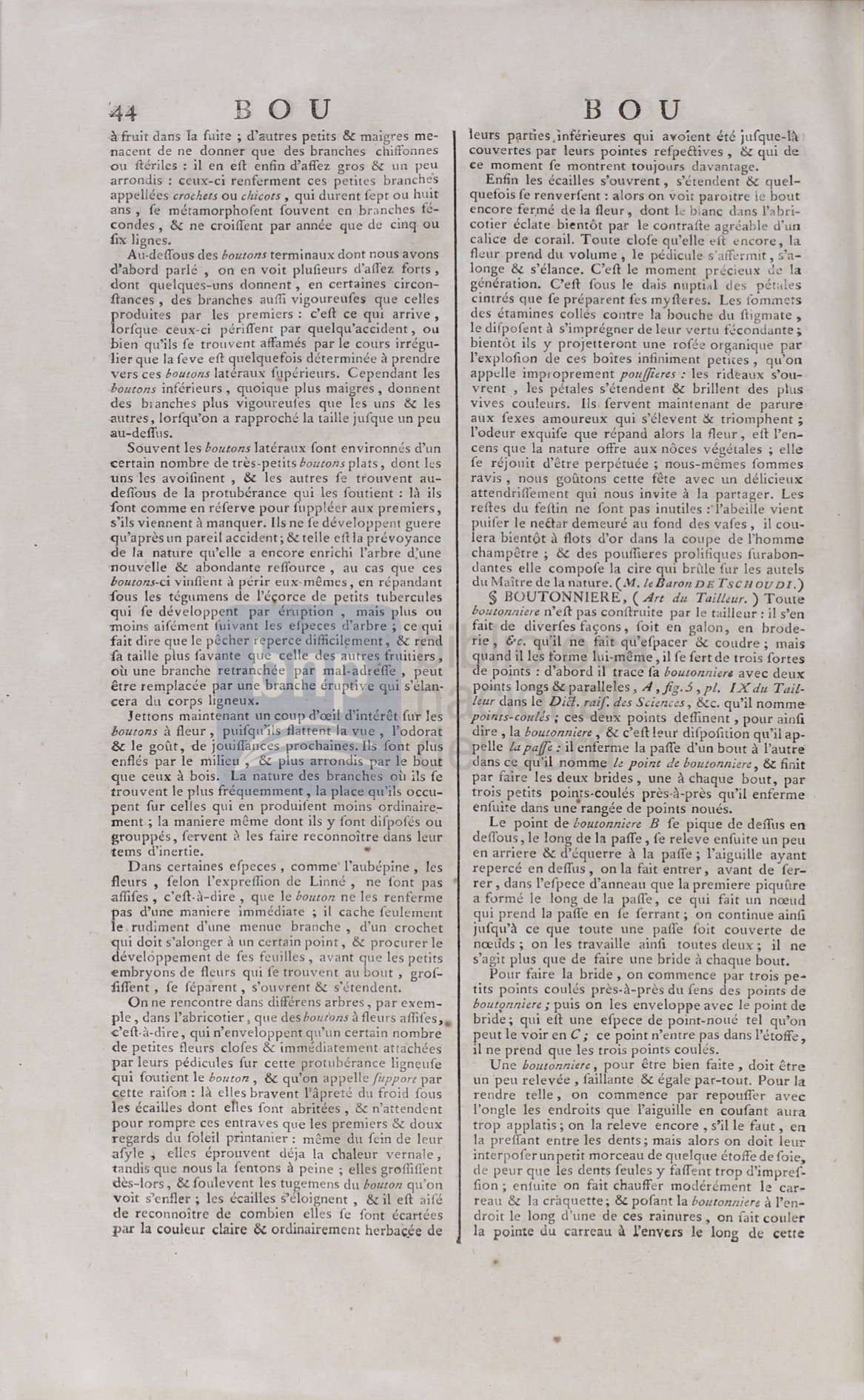
BOU
a
fruit Clans Ia fuite ; d'autres petits
&
maigres me–
nacent de ne donner que des branches chi:ffonnes
ou ftériles : il en efi enfin d'affez gros & un
pe~
a:rrondis : ceux-ci renferment ces petites
branch~s
appellées
crochets
ou
chicots,
qui durent fept ou hlllt
ans , fe métamorphofent fouvent en
br~nches
fé–
condes,
&
ne croiífent par année que de cinq ou
fix lignes.
Au-deífous des
boutons
terminaux dont nous avons
<l:'abord parlé , on en voit plufieurs d:aífez forts,
dont quelques-uns donnent, en certames Circon–
.frances , des branches auffi vigoureufes que celles
produites par les premiers : c'efi ce qui arrive ,
lorfque ceux-ci périíTent par quelqu'accident , ou
bien qu'ils fe trou vent affamés par le cours irrégu–
·Jier que la fe ve efi quelquefois déterminée
a
prendre
vers ces
boutons
latéraux fupérienrs. Cependant les
'houtons
inférieurs, quoique plus maigres, donnent
des branches plus vigoureufes que les uns
&
les
-autres, lorfqu)on a rapproch ' la taille jufque un peu
au-deífus.
Souv€'nt les
boutons
latéraux font environnés d'un
certain nombre de tres-petits
boutons
plats, dont les
1.1ns ·les avoifinent ,
&
les autres fe trouvent au–
deífous de la protubérance qui les foutie,nt : la ils
font comme en réferve pour fupplé er aux premiers,
s'ils viennent
a
manquer. Ils ne fe développen t guere
qu'apres un pareil accident; & telle efi la prévoyance
de la nature qu'elle a encore enrichi. l'arbre
d~une
nouvelle
&
abondante reífource , au cas que
ces
boutons-á
vinílent
a
périr eux-memes' en répandant
fous
les tégnmens de l'écorce
d~
petits tubercules
qui fe développent par éru ption , mais plus on
moins aifément fuivant les efpeces d'arbre ; ce qui
fait di re que le pecher reperce difficilement,
&
rend
::fa taille plus favante que celle des autres fruitiers,
Otl
une branche retranchée par mal-adreífe , peut
etre
re~placée
par une branche éruptive qui s'élan–
cera du corps ligneux.
·
·
J
ettons maintenant un coup d'ceil
d'intér~t
fu'r les
bOUtons
a fleur, puifqu'i!s flatt'ent la VUe , l'odorat
&
le gottt, de jouiífances prochaines. Ils font plus
enflés par le milieu , & plus arrondis par le bout
que ceux
a
bois. La nature des branches
Oll
ils fe
trouvent le plus fréquemment, la place qu'ils occu–
pent f\:lr celles qui en produifent moins ordinaire;–
rnent ; la maniere meme dont ils
y
font difpofés
Oll
grouppés' fe:rvent
a
les faire reconnoitre dans leur
tems d'inertie.
Dans certaines efpeces, comme l'aubépine, les
fleurs , felon l'expreffion de Linné , ne font pas
.affifes, c'efi-a-dire, que le
bouton
ne les renferme
pas d'une maniere immédiare ; il cache feulement
le rudiment d'une menuc branche , d'un crochet
qui doit s"alonge-r a un certain point' & procurer le
développernent de fes feuilles, avant que les petits
.embryons de fleu rs quí fe trouvent au bout , grof–
iiífent, fe féparent, s'ou vrent & s'étendent.
On ne rencontre dans différens arbres, par
exem–
ple ' dans l'abricotier ' que des
hout'ons
a fleurs affifes ,
-c'efi-a-dire, qui n'enveloppent qu'un certain nombre
de petites fleurs clofes
&
immédiatement attachées
cpar leurs pédicules fur cette protubérance ligneufe
qui fouti ent le
bouton,
& qu'on
appellejupport
par
cette raifoB:
la
elles bravent Fapreté du froid fous
les écailles dont elles font abritées , & n'attendent
pour rompre ces entraves que les premi ers & doux
regards du foleil printanier : meme du fein de leur
afyle ,
e'llcs éprouvent déja la chaleur vernale,
tandis que nous la fentons
a
p-eine ; elles groffiífent
des-lors, &foulevent les
tu~etnens
du
houton
qu'on
voit s"enfler ; les écaiHes s'e1oignent ,
&
il efi aifé
de reconnoitre de combien elles fe font écartées
par la couleur daire
&
ordinairement herbac_ée de
BOU
leurs
p~rties
.lnférieures qui avoíent été jufque-Ia
couvertes par leurs pointes refpeétives,
&
qui de
ce moment fe montrent toujours davantage.
Enfin les écailles s'cuvrent, s'étende nt
&
quel–
quefois
fe renverfent: alors on voit paroitre le bout
encore
fer.méde la fleur -, -dont le b:anc dans l'abri–
cotier
éclatebientot par-
le contrafie agréable d'un
calice de corail. Toute dofe qu'elle eft encere, la
fl eur prend du volume, le pédicule s'affi rmit , s'a–
longe
&
s'élance. C'efi le moment pr¿cieux d
la
génération. C'efi fous le dais
nupti c~ l
des pétales
cimrés que fe préparent fes myfieres. Les fomm"'tS
des étamines collés centre la bouche du fiígmate ,
le difpofent a s'imprégner de leur ve rtu f¿condante;
bientot ils y projetteront une rofé organique par
l'explofion de ces boites ínfiniment petites, qu'on
appelle imp1oprement
pouifieres:
les rideaux
s'ou–vrent _, les pétales s'étendent
&
brillent des
ph.tsvives couleurs. Ils fervent maintenant de p
arureaux fexes amoureux qui s'élevent
&
triomphent ;
l'odeur exquife que répand alors la fleur, efi l'en–
cens que la nature o:ffre aux noces végétales ; elle
fe réjouit
d'~tre
perpétuée ; nous-memes fommes
ravis , nous goutons cette fete avec un délicienx:
attendriífement qui nous invite a la partager. Les
refies du fefiin ne font pas inutiles : l'abeille vient
puifer le neél:ar demeuré au fond des vafes, il con–
lera bientot a flots d'or dans la coupe de l'homme
champetre ; & des pouffieres prolifi.ques furabon–
dantes elle compofe la cire qui brille fur les autels
du Maitre de la nature.
(.L\1.leBaronDE
TscH ou
DI.)
§
BOUTONNIERE, (
Art du Taillmr.)
Toute
boutonniere
n'eíl: pas con11ruite par le tailleur: il s'en
fait-
de diverfes fa<;ons, foit en galon, en brode–
rie,
6-c.
qu'il ne fait qu'efpacer
&
coudre; mais
quand illes forme lui-meme, il fe fert de trois fortes
de points : d'abord il trace fa
boutonniere
avec deux
points Iongs & paralleles ,
A,
fig.
.5
,
pl.
1X du T
ail–
Leur
dans le
Diél. raif. des Sciences,
&c. qu'il nomme
points-coulés
;
ces deux points deffinenr , pour ainfi
di re, la
boutonniere·,
& c'efi leur difpofition qu'il ap–
pelle
la paffe :
il enferme la paífe d'un bout a l'autre
dans ce qu'il nomme
le point de boutonniere ,
&
finit
par faire les deux brides' une achaque bout' par
trois petits
points~coulés
pres-a-pres qu'il enferme
enfuite dans une rangée de points noués.
Le point de
boutonniere
B
fe pique de deífus en
deffous, le long de la paífe, fe releve enfuite un peu
en arriere & d'équerre a la paífe; l'aiguille ayant
repercé en deífus , on la fait entrer, avant de fer–
rer, dans l'efpece d'anneau que la premiere piquíhe
a formé le long de la paífe , ce qui fait un nrend
qui prend la paífe en fe ferrant; on continue ainíi
jufqu'a ce que toute une paífe foit couverte de
nceLids ; on les travaille ainfi
ton tes deux; il ne
s'agit plus que de faire une bride
a
chaque bout•
Pour faire la bride, on commence par trois pe·
tits points coulés pres-a-pres du fens des points de
hout~rzniere;
puis on les enveloppe avec
le
point de
bride; qui efi une efpece de point-noué tel qu'on
peut le voir en
e;
ce point n'entre pas dans l'étoffe
7
il ne prend que les trois points coul és.
une
boutonniere'
pour etre bien faite, doit etre
un peu relevée, faillante & égale par-tout. Pour la
rendre telle, on commence par repouífer avec
l'ongle les endroits que l'aiguille en coufant aura
trop app latis; on la releve encore, s'ille faut, en
la preífant entre les dents; maís alors on doit leur
interpofer un petit morceau de quelque étoffe de foie,
de peur que les dents feule s
y
faífent trop d'impref–
fion; eniuite on fait chauffer modérément le car–
reau
&
la craquette;
&
pofant la
boutonniere
a l'en–
droit le long d'une d€' ces rainures, on fai t couler
la
pointe
du carreau
a
l'envers
le
long
de
cene
















