
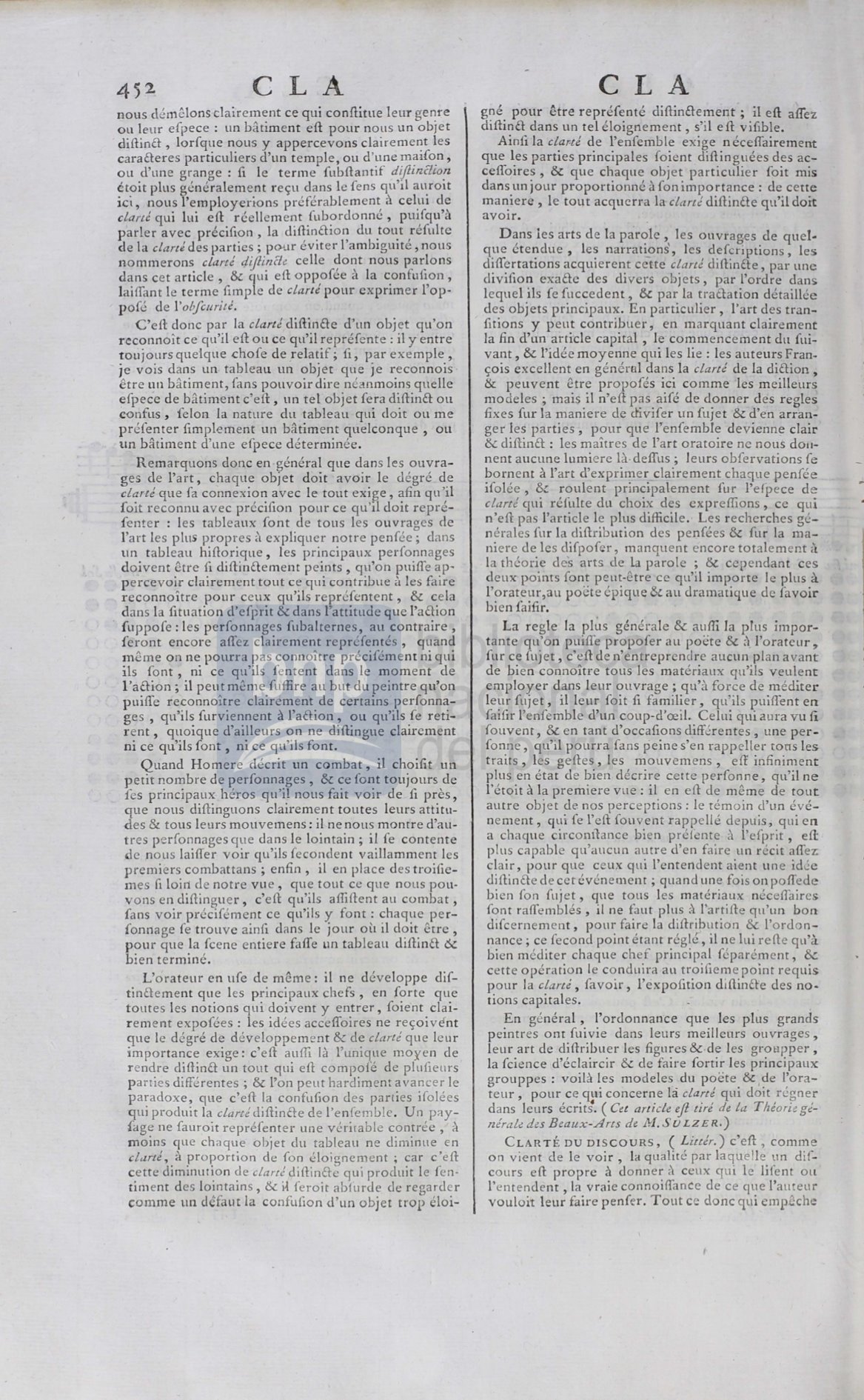
452
CLA
nous dérnelons clairement ce qui coníl:itue leur
gen~e
on leur efpece : un
b~!timent
efi pour nous un objet
<difl:inét, lorfque nous y appercevons clairement les
caraéteres particuliers d'un temple, ou d'une maifon ,
ou d'une grange : íi le tenne {ub.fiantif
diflinaio:z
étoit plus généralement re<;u dans le {ens qu'tl aurott
ict'
nous l'employerions préférablement
a
celui de
ckrté
qui
hli
efr réellement fubordonné, puifqu'a
parler avec préciíion, la difrinétion du, tour réfulte
de la
clané
des parties; po-ur éviter l'ambignité ,nous
nommerons
clarté
cJijlin8e
celle dont nous parlons
clans cet article '
&
qui eft {)ppofée
a
la confufion'
laiífant le terme íimple de
clarté
pour exprimer fop–
pofé de
1'
obfcurité.
C'eft done par la
clard
diftinéte d\m objet qu'on
reconnoit ce qu'il e:fr ou ce qu'il repréfente
:
il y entre
toujours queique chofe de !elatif; íi, par exemple,
je vois dans un tableau un objet que je reconnois
etre
Ull
batÍment, fans pOUVOÍr dire néanmoins quelle
~fpeée
de batiment c'eft, un tel objet fera difiinB: ou
confus, felon la nature du tableau qui doit ou me
préfenter íimplement un bihiment quelconque, ou
un
b~himent
d'une efpece déterminée.
Remarquons done en général que dans les ouvra–
ges de l'art, chaqne objet doit avoir le dégré de
clarté
que fa connexion avec le- tout exige, afin qu 'il
foit reconnu avec précifton pour ce qu'il doit repré–
fenter : les tableaux font de tous les ouvrages de
l'art les plus propres
a
expliquer notre penfée; dans
un tableau hiílorique, les principaux perfonnages
doivent etre íi diftinétement peints' qu'on pniífe
ap~
percevoir clairement rout ce qui contribne
a
les faire
reconnoitre pour ceux qu'ils repréfentent,
&
cela
dans la fituation d'efprit
&
dans r'attitude que l'aétion
fuppofe: les perfonnages fubalternes, au contraire,
feront encore aífez clairement repréfentés, quand
meme on ne püt\rra pas connoirre précifément ni qui
ils font , ni ce qu'ils fentent dans le rnoment de
l'aétion; il
peutm~me
fuffire au but du peintre qu'on
puiífe reconnoitre clairement de certains perfonna–
ges ' qu'ils furviennent a l'aétion' ou. qu'ils fe reti–
rent, quoique d'ailleurs on ne difiingue clairement
ni ce qu'ils font , ni ce qu'ils font.
Quand Homere décrit un combat, il choifit un
petit nombre de perfonnages,
&
ce font toujours de
fes principaux héros qu'il nous fait voir de fi pres,
que nous difl:inguons clairement toutes leurs attitn–
des & tous leurs mouvemens: il ne nous monrre d'au–
tres perfonnages que daos le lointain; il fe contente
ce
nous laiffer voir qu'ils {econdent vaillamment les
premiers combattans ; enfin, il en place des troiíie–
mes
ú
loíri de notre vue, que tout ce que nous pou–
vons en difi:inguer, c'efl: qu'ils affifl:ent au combat,
fans voir précifément ce qu'ils
y
font : chague per–
fonnag.e fe trouve ainíi dans le jour oü il doit erre '
pour que la fcene entiere faífe un tableau diftinét
&
bien terminé.
L'Órateur en ufe de meme: il ne développe dif–
tinétement que les principaux chefs, en forte que
toutes les notions qui doivent y entrer, foient clai–
rement expofées : les idées acceífoires ne re<;oivént
que le dégré de développement
&
de
clarté
que leur
importance exige: c'efl: auffi la l'unique moxen de
rendre difl:inét un tout qui efi
compoú~
de pluíieurs
parties différentes ;
&
l~on
peut hardiment avancer le
paradoxe, que c'efi la confuíion des parries ifolées
qui produit la
clarté
difiintte de l'en [emble . Un p<ty–
fage ne fauroit repréfenter une véri(able contrée '
a
moins que chaque objet du tableau ne diminue en
clarté'
a proportion de fon éloionement ; car e 'efi
cette diminution de
clarté
diftinét~
qui produit le fen–
timent des lointains ,
&
i.t
feroít abfurde de regarder
comme un defaut la confufion d'un objet trop éloi-
CLA
gné pour etre repréfenté difl:inél:ement ; il efl: a:lfez
diftinét dans un tel éloignement, s'il e
fr
vifilile.
Ainfi la
clar-té
de l'enfemble exige néceíTairement
que
l.esparties principales foient difiinguées des ac–
ceífoires ,
&
que chaque objet particulier foit mis
dans.unjour proportionné
~
fon importance: de cette
mar:Ient ,
le
tout acquerra la
clarté
diftinéte qn'il doit
avo1r.
Dans les arts de la pa.role, les ouvrages de quel·
que étendue , les narrat!9ns', les defcriptions, les
diífertations acquierent cette
clareé
difiinéte, par une
divifton exaB:e des divers objets, par l'ordre dans
lequel ils fe fuccedent,
&
par la traét:ation détaillée
des objets principaux. En particulier, l'art des tran–
Gtions
y
peut contribuer., en marquant clairement
la fin d'un article capital , le commencement dn fui–
vant,
&
l'ídée moyenne qui les líe : les auteurs Fran–
<_;:ois excellent en général dans la
clarti
de la diétion •
&
peuvent etre propof€s ici comme les meilleurs
modeles ; mais il n'efr pas aifé de donner des regles
fixes fur la maniere de divifer un fujet
&
d'en arran–
ger les parties, pour que l"enfemble
devienn~
clair
&
difiinél : les rnaitres de l'art oratoire ne nous dou–
nent aucune lumiere la· deífus ; leurs obfervations fe
bornent a l'art d'exprimer clairement chaque penfée
ifolée,
&
roulent principalement fur l'e{pece de
clarté
qui réíi..Ilte du choix des expreffions, ce qui
n'eft pas l'article le plus difficile. Les recherches gé–
nérales fur la difl:ribution des penfées
&
fur la ma–
niere de les difpofer, manquent encore totalem12nt a
la théorie des arts de la paro le ;
&
cependant ces
deux poinrs font pent-etre ce qu'il importe le plus a
l'orateur,au poete épique
&
au dramatique de favoir
bien faifir.
La regle la plus générale & auffi .la plus impor–
tante qu'on puiífe propofer au p0ete
&
á.
l'orateur
~
fur ce fujet, c'efl: de n'e.ntreprendre aucun plan avant
de bien connoitre tous
les
matériaux qn'ils
v~ulent
employer dans Ieur ouvrage ; qu'a force de méditer
leur fujet, il leur foit fi familier, qu'ils puiífent en
faiftr l'enfemble d'un coup-d'ceil. Celui qui aura vu
ú
fouvent,
&
en tant d'occaftons différentes, une per–
fonne, qu'il pourra fans peine s'en rappeller tocrs les.
traits, les gefies, les monvemens, eff infiniment
plus en étar de bien décrire cette perfonne, qu'il ne
l'étoit a la premiere vue: il en efl: de meme de tout
autre objet de nos perceptions: le témoin cl'un évé–
nement, qui fe l'efi fouvent rappeHé depuis, quien
a chaque circonH:ance sien préfente a l'efprit' eft
plus capable qu'aucun autre d'en faire un récit aífez
clair, pour que ceux qui l'entendent aient une idée
difl:inB:e de cet événemenr; quand une fois on poífede
bien fon fujet, que tous les matériaux néceífaires
font raffemblés ' il ne faut plus
a
l,.artifie qu'un bon
difcernement, ponr faire la difrribution
&
l'ordon–
nance; ce fecond point éranr réglé', il ne lui refi:e qn'a
bien méditer chaque chef principal féparément,
&
cette opération le conduira au troifteme point requis
pour la
clarté,
favoir, l'expoíition difiinél:'e des no·
rions capitales.
En général, l'ordonnance que les plus grands
peintres ont fuivie dans leurs meilleurs ouvrages,
leur art de difiribuer les figures & .de les groapper,
la fcience ·d'éclaircir
&
de faire fortir les principaux:
grouppes : voila les
modele~
du poete
&
de l'ora–
teur, pour ce qui concerne la
clarté
qni doit régner
dans leurs écrit!. (
Cet
article efl tiré
de
La
Théorie
gi–
néralcdesBeaux-Arts de
M.SVLZER.)
CLAR
TÉ DU DISCOURS, (
Littér.)
c'efi, comme
on vient de le voir , la qualité par laguelle un dif–
cours eft propre a donner
a
CeUX qui le lifent Oll
l'entendent, la vraie connoiífance de ce que l'aureur
vouloit leur faire penfer. Tout
'e
done qui emp.&che
















