
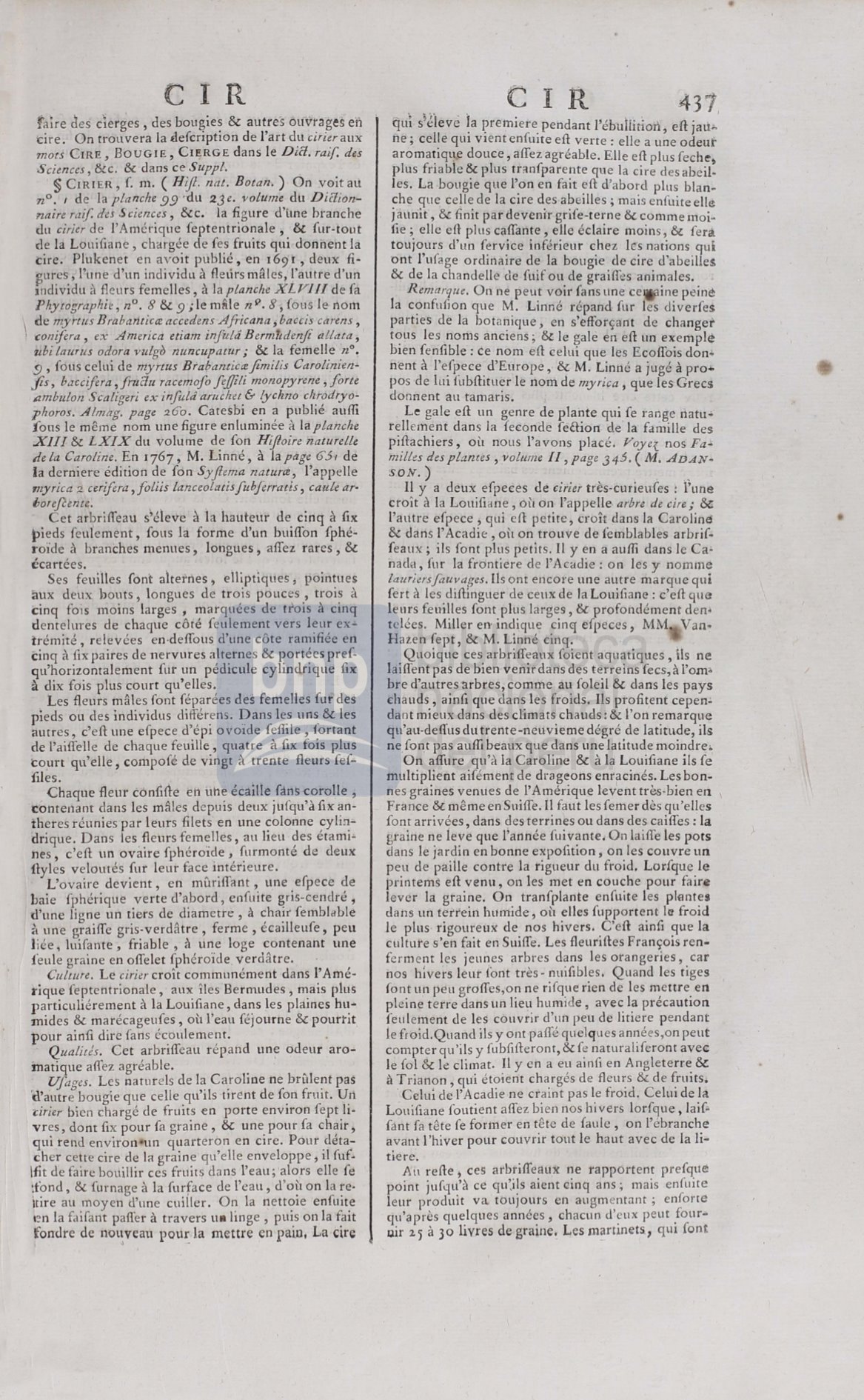
CIR
faire des
c1erges, des bougies & autres otfvtages
efl
tire. On rrouvera la .defcription de l'art du
cirieraux
mots
CIRE, BouGIE, CIERGE dans le
Día.
rai{. des
Sciences,
&c.
&
dans ce
Suppl.
§
CIRIER,
f.
m. (
Hijl.
nat. Botan.)
On voit au
n°.
,
de la
planche 99
·uu
2je. volume
du
Diélion–
naire raif.
des
.S
ciences,
&c.
la figure d'bne branche
dn
cirier
de 1'Amérique feptentrionale,
&
fur-tout
de la Louifiane, chargée de fes fruits qui donhenr la
cire. Plukenet en avoit publié, en
1691,
deux fi–
gures~
Fune d'un individua fleúrs
m~
les, l'autre d'un
individua fleurs femelles, a la
planche
XLVIII
de fa
Phytographie, n°.
8
&
9
;le mfHe
nP.
8,
fous le nom
\ de
myrws BrábarlticCP- accedens Afri
cana, bacciscarens,
'
-conífera, ex America etiam infuld Bermuden.Ji aliata,
ubi laurus odora vulgo nuncupatttr;
& la femelle
n°.
-9,
fous celui de
myrtus BrabanticCP-Jimilis Carolinien–
jis, baccifera ,jruau racemofo feflili monopyrene, forte
¿¡mbulon Scaligeri ex infuld aruchet
&
!yckno cfzrodryo–
;phoros. .Almag. page .2.6'o.
Catesbi en a publié auffi
fons le meme nom une figure enlurninée
a
la
planche
XIII
&
LXIX
du volume de fon
Hijloire naturelle
de la Carofine.
En
1767,
M.
Linné,
a
lapage 6'5J
de
la
derniere édition de fon
Syflema naturCP-,
l'appelle
myrica
.2
cerifera ,foLiis lanceolatisfubferratis, carde ar·
iJoreflent
.
,
.
Cet arbriífeau s'éleve
~
la hauteur de cinq a fix
pieds feulement, fous la forme d'un buiífon fphé–
to!de
a
branches menues' longues' aífez rares' &
écarrées.
Ses feuilles font alternes, elliptiques; pointues
áux deux bouts' longues de trois pouces ' trois a
cinq
fOls
moins larges ' marquées de trois
a
cinq
denrelures de chaque coté feulement vers leur ex–
trémité' relevées en·deffous d'une cote ramifiée en
cinq
a
íix paires de nervures alternes
&
portées pref–
qu'horizontalement fur un pédicule cylindrique
fix:
a
dix fois plus courr qu'elles.
Les fleurs males font féparées des fernelles fut des
p~eds
ou des individus différens. Dans les uns
&
les
autres, c'eft une efpece d'épi ovoide feffile, fortant
de l'aiífelle de chaque feuille' quatre
a
fix fois plus
court qu'elle' cornpofé de vingt
a
trente fleuts fef–
íiles.
Chaque fleur coníifte et1 uhe écallíe fáns corolle ,
contenant dans les males depuis deux jufqu'a fix an–
theres réunies par leurs filets en une colonne cylin–
drique. Dans les fleurs femelles, an lieu des étami–
nes
c'eft un ovilire fphéroide, furmonté de deux
fiyl~s
veloutés fur leur face intérieure.
L'ovaire devient, en muriífant, une efpece de
baie fphérique verte d'abord, enfuite gris-cendré ,
d'une ligne un tiers de diametre'
a
chair
femblable
a
une graiífe gris-verdatre' ferme' écailleufe' peu
liée, luifante' friable '
a
une loge contenant une
feule graine eh oífelet fphéroide verdatre.
Culture.
Le
ciri~r
croit communément dans
1'
Amé–
tique feptentrionale, aux iles Bermudes , mais plus
particuliérement
a
la Louifiane, dans les plaines hu–
mides & marécageufes, Ottl'eau féjourne
&
pourtit
pour ainfi dire fans écoulemenr.
Qualités.
Cet arbriífeau répand une odeur aro–
inatique aífez agréable.
,
Ufages.
Les naturels de
I;
Ca.roline ne hrule?t pas
d'autre bougie que celle qu 1ls tJrent de fon frmt. Un
árier
bien chargé de fruits en porte enviran fepr li–
vres, dont fix pour fa graine,
&
une pour fa chair,
qui rend enviran un quarteron en cire. Pour déta–
cher cette cire de la graine qu'elle enveloppe, il fuf–
lfit de faire bouillir ces fruits dans l'eau; alors elle fe
~fond'
&
furnage
a
la
furfa~e
de l'eau'
d'o~
on la
~e
ltire a
u m
oyen d'une cuiller. On la nett01e enfune
l:n la faifant paífer
a
travers
tllil
linge ' puis on la fait
fondre de nou
veau
pQur
la
mettre
en paio,
La
cire
J
-
C
I
R
431
qui s
9
éieve
~a
I?remiere. pendant l'ébullition, efi jau...'
ne; celle qm VIent enfutte eft verte: elle a une odeuf'
aroma~ique
douce, aífez agréable. Elle eft plus
feche~
plus fnable
&
plus tnnfparente que la
cire
des abeil–
les. La bougie que l'.on en fait
~ft d'abo~d
plus blan·
che que celle de la c1re des abeilles; ma1s enfuite elle
j
aunit,
&
fin ir par devenir grife-terne & comme
moi~
fie ;. elle efr plus caífante, elle édaire moins,
&
ferá
tOUJOurs d'un fervice inférieur chez
le-s
nations qui
ont l'ufage ordinaire de la bougie de cire d'abeilles;
& de la chandelle de fuif ou de graiífes animales.
Remarque.
On ne peut voir fans une ce
ine peine
la
c~mfufion
que
M.
Linné répand fur les diverfes
partles de
la
botanique, en s'efforc;ant de changer
t<:>us les norns anciens; & le gale en efi un exemple
b1en fenfible : ce nom eft celui que les Ecoífois don•
nent
a
I'e.fpece. d'Europe,
&
M.
Linné a jugé
a
pro.o.
pos de lm fubíbtuer le nom de
myrica,
que les Grecs
donnent au tamaris.
Le
gale eft un genre de plante qui fe range rtatu–
rellernent dans la {econde feétion de
la
famille des
pifiachiers, ott nous l'avons placé.
Poyez
nos
Fa–
milLes
des
plantes, volume
/1,
page
34:5. (M.
ADA.Jtfo
SON.)
_
11
y
a deux efpeees de
cirier
tres-curieufes : l'une
croit
a
la Louiíiane'
Oll
on l'appelle
arbre de
cire;
&
l'autre efpece, qui efi petite, c1·oit dans
la
Caroline
& dans
1'
Acadie, ou on trouve de femblables arbrif.
feaux; ils font plus petirs.
Il
y
en a auffi. dans le Ca–
nada, fur la frontiere de l'Acadie: on les
y
nomme
lauriersfauvages.lls
ont encore une autre marque qui
fert
a
les diilinguer de ceuxde JaLouifiane: c'efique
leurs feuilles font plus larges,
&
profondément den•
telées. Miller en indique cinq efpeces,
MM.
Van..
Hazen fept,
&
M. Linné cinq.
Quoique ces arbriífeaux foient aquatiques,
Hs ne
laíífent pas de bien venirdans des terreins fe
es,
a
l'oma
bre d'autres'!:lrbres, comme
a
u foleil
&
dans les pays
chauds, ainfi que dans les froids.
lis
profitent cepen–
dant mieux dans des climats chauds:
&
l'on remarque
qu'au-delfus du rrente-neuvierne dégré de Iatitllde, ils
ne font pas auffi beau.x que dans une latí
tu
de moindre.
On affure qu'a la Caroline
&
a
la
Louiíiane ils fe
rnultiplient aiférnent de drageons enracinés. Les bon.
nes graines ven
u
es de l'Amérique levent tres-bien en
France
&
m
eme enSuiífe.
Il
faut les femerdes qu'elles
fonr arrivées, dans des terrines ou dans des caiífes: la
graine ne leve que l'artnée fuivante.
On
laiffe les pors
dans le jardin en bonne expofition, on les couvre un
peu de paille contre la rigueur du froid, Lorfque
le
printems eft venu, on les met en couche pour faire
lever la graine. On tranfplante enfuite les plentes
dans un ter'
te
in humide, o ti elles fupportent la froid
le plus rigoureux de nos hivers. C'efi ain!i que
la
culture s'en fait en Suiífe. Les fleuriftes Franc;ois ren–
ferment les jeunes arbres dans les otangeries, car
nos hivets leur font tres- nuifibles. Quand les riges
font un pe
u
gtoffes,on ne rifque rien de les mettre en
pleine rerre dans un lieu humi e, ave e la précaution
feulement de les couvrir d'un peu de litiere pendant
le froid.Quand ils
y
ont paífé que1ques anrtées,on peut
compter qu 'ils
y
fubfifteronr, &fe naturaliferonr avee
le fol
&
le climat.
Il
y
en a eu ainfi en Angleterre
&
a
Trianon, qui ét?ient cha.rgés de
fleu~s
&
de
~ruits.
Celui de l'Acadte ne cramt pas le fro1d. Celm de la
Louifiane foutienr aífez bien nos hi vers lorfque, Iaif•
fánt fa tete fe former en tete de {aule, on l'ébranche
avant
1
'hiver pour collvrir tout le haut avec de la li–
tiere.
A
n
refie ; ces arbriífeaux ne rapportenr prefqué
point jufqu'a ce qu'_ils aient cinq ans; mais enfuite
leur produit
va
toujours en augmentant ; enfone
qu'apres
qu~lques anné~s,
chacun
d'~ux
peut .four–
Qir
2)
a
JO
hvres de grame! Les martmets., qm fon
















