
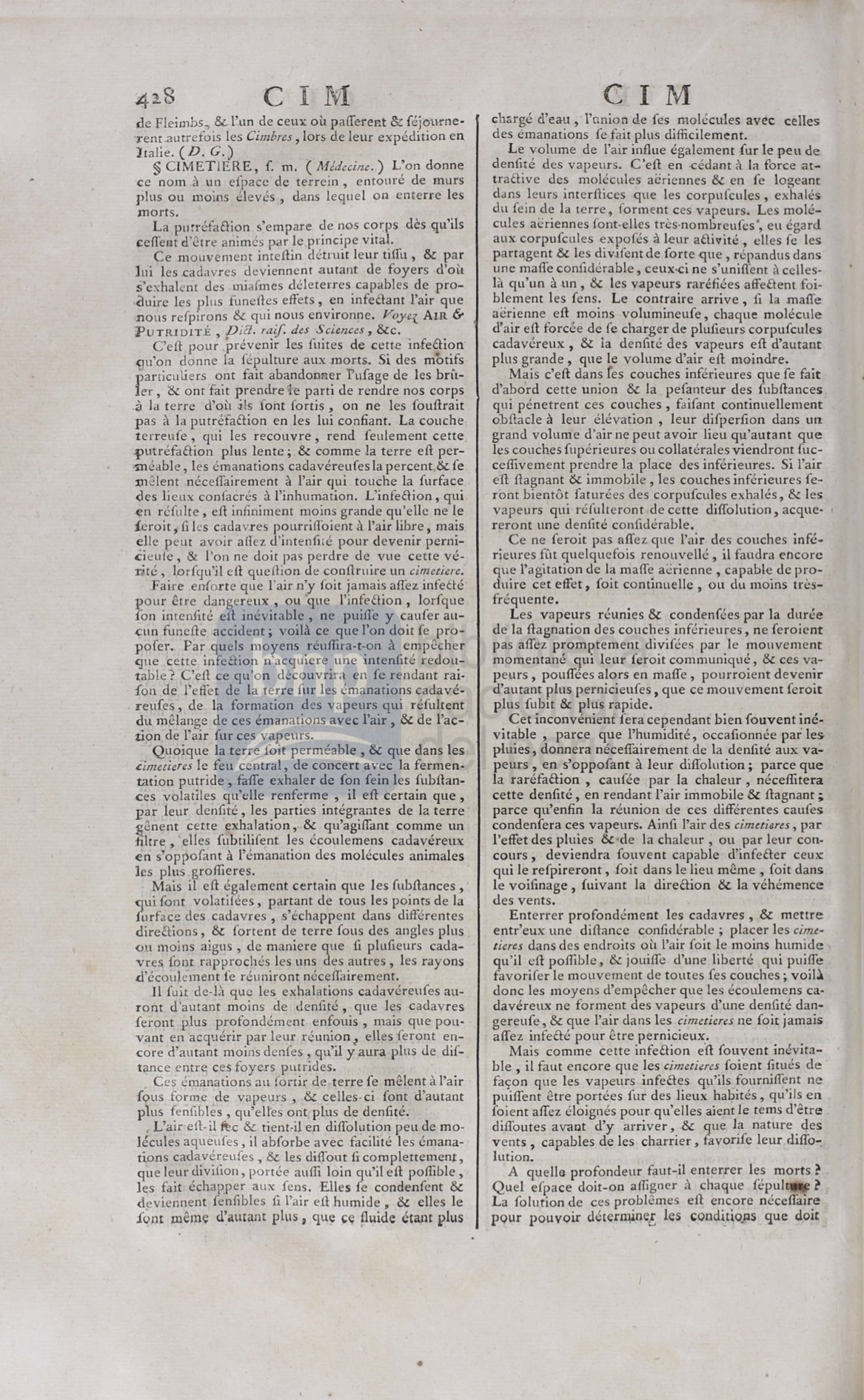
C IM
d e Fleimbs., &. l'un de ceux ol! paífereet
&
féjourne–
·.renr.autrefois les
Cimbres,
lors de 1eur expédition en.
l talie.
(D. G.)
§
CIMET LERE, f. m. (
l'dédecine .)
L'on donne
ce nom
.a
un efpace de ter rein, entouré de murs
p lus ou moins élevés , dans lequel on enten:e les
morts.
La putréfaélion s'empar e de
~0s c?~PS
des qu'ils
ceífeat
d
etre animés par Je,princ1pe
VItal.
Ce mouvement inteftin dét ruit leur tiífu,
&
par
hii les .cadavres deviennent ..autant de foyers d'oU.
s'exhalent des miafmes déletel:res capables de
pro–
<luir.e les plus
funeíl:~s
effets ,
~n
infeB:ant l'air que
·.nous refp irons
&
qm nous env1ronne.
Voye{
AI-R
.& ,
P .UT RJDIT.É ,
D i8 . raif. des Sciences
~&c.
C'efr pour prévenir
les
fuit
es decett.e i nfeél:ion
gu'on donne la fépulture aux .mor.ts.. Si des motifs
p ar ticulie rs ont fait abandon111er 'I'ufage de les brft–
l er ,
&
ont fait prendre
e
parri de rendre nos corps
.a
la terre d'ol1
jJs
foht fortis
~
on ne les foufrrait
pas
a
la putré'faB:ion en les lui confiant. La couche
terre nfe, qui les recouvre, rend feulement cette
.put réfaél:ion plus lente;
&
comme
Ja
terre eft per–
?.méable , les érnanations cadavéreufes la percent & fe
:me lent .né.ceífairemet'lt
a
l'air qui touche la furface .
des lieux confacrés a l'inhumation. L'infeél:ion, qui
-€n réfulte ,
e1l:
infiniment moins grande qu'ellc ne le
.íeroit' fi les ca·davr es pou.rriífoient
a
l'air libre' mais
d le peut avoi r aífez d'intenfiré pour deveni<t perni–
.Cieuíe,
&
l'on ne doit pas pe
rdre de vue cet te vé–
ni ré , l,orfqu'il eíl: quefiion de confrrui.re un
cimetiere.
.Faire enforte que l'air r.l'y foit jamais aífez infeét:é
p ou
r etre dangereux ' ou que l'infeél:ion ' lorfque
fon
intenfi.téefi inévirable, ne puiífe
y
caufer au–
~un
funefte accident; voila ce que l'on doit fe pro–
pofer.. Par qu els mo
yens réuffira-t-on
a
empecher
-que cette infeétion n'
acquie.re une intenfité redou–
t able? C'efr ce qu'on découvrira en fe rendant raÍ·
fon de l'effet de la terre fur les émanations cadavé–
reufes , de la formation des vapeurs qui réfultent
du melange de ces émanations avec l'air'
&
de l'ac–
tion-de l'air fur ces vapenrs.
Q uoique la terre foit perméable ,
&
que dans les
ctmetieres
le fe u central, de concert avec la fermen–
tation pntride , faífe exhaler de fon fein les fubílan–
ces volatiles qu'elle renferme , il efr certaia que ,
par leur denfité , les parties intégrantes de
la
terre
genent cette exhalation,
&
qu'agiífant comme un
.:filtre, elles fnbtilifent les écoulemens cadavéreux
€n s,oppofa nt
a
l'émanation des molécules animales
les plus groffieres.
Mais il efi également certain que les fubfiances ,
<¡ni
font volatifées, partant de tous les points de la
fu rface des cadavres, s'échappent dans di1férentes
direétions,
&
fortent de terre fous des angles plus
()ll
moins aigus , de maniere que fi plufieurs cada–
v res fon t rapprochés les uns des autres, les rayons
.d'écoulement fe réuniront néceífairement.
Jl fuit de-la que les exhalations cadavéreufes au–
r ont d 'autant moins de deníité , que les cadavres
.feront plus pr ofondément enfouis , mais que pou–
vant en acqué rir par leur r ' un.i.onX' elles feront en–
cere d'au tan t m
oins denfes , qu'il
y
aura plns de dif–
t ance
entre
ces
foye.rsputrides.
Ces émanations
au
fo rtir de terre fe melent
a
l'air
{c;>us forme de vapeurs ,
&
eelles· ci font d'autant
plus fenfibles , qu'elies ont plus de denftté.
, L'air
e íl:-it
~e
&
tient-il en
diírol~1tion
peu de mo–
lécules aqueufes, il abfo rbe avec facilit é les émana–
tions cadavéreufes ,
&
les diffout
fi
complettement ,
que leur diviíion, portée auffi loin qu'il efr po:ffible,
l es
fait échap_per aux feos .
Elles fe condenfent
&
<l~viennent
fenfibles
fi
l'air
e.frhumide ,
&
elles le
íont
.xnem~
d'autant plus
~ qu~ '~
r uide étant
p_lus
CIM
cha rgé d'eau, l'anio n de fes molécules avec celles
des émanations fe fait plus difficilement.
Le volume de l'air influe également fur le pe
u
de
clenfité des vapeurs. C'eíl: en -cédant
a
la force at·
traB:ive des molécules aeriennes
&
en fe logeant
dans _leurs interftices que les corpufcules , exhalés
du
fem de la r.erre , forment ces vapeurs.. Les molé–
cules aeriennes font-elles tres-nombreufes ·, eu égard
aux corpufcules ex.pofés a leur aélivité
elles fe les
parra.gent
.&
les di v.ifent de forte ·que , r6pandus dans
une maífe conúdérable, ceux--ci ne s'uniífent
a
celles–
la qu'un
a
.un '
&
les vapeurs ra-réfiées affeél:ent foi–
blement les fens. Le contraire arrive , íi la rnaífe
aerienne efi moins volumineufe' chaque molécule
d~air
eíl: forcée de fe charger de plufieurs corpufcules
cadavéreux ,
&
la denfité des vapeurs eíl: d'autant
plus grande, que le volume d'air eíl: moindre.
Mais c'eft dans fes couches inférieures que fe fait
d'abo'rd cette union
&
la pefanteur des fubíl:ances
qui pénetrent ces couches , faifant continuellement
ohfiacle
a
leur élévation ' leur difpedion dans un
grand volume d'air ne peut avoir lieu qu'autant que
le.s
couches fup érieures ou collatérales viendront fuc–
ceffivement prendre la place des inférieures. Si l'air
efi: íl:agnant
&
immobile, les couches inférieures fe–
ront biento t fatur ées des corpufcules exhalés,
&
les
vap eurs qui réfult eront de cette diífolution, acqne-
'
reront une deníité coníidérable•
Ce ne feroit pas aífez que l'air des couches infé–
rieures füt quelquefois renouvellé, il faudra encore
qu e l'agitation de la maífe aerienne' capable de pro–
duire cet effet, foit continuelle , o u du moins tres–
fréquente.
Les vapeurs réunies
&
condenfées par la durée
de la ftagnation des couches inférieures, ne feroient
pas aífez promptement divifées par le mouvement
momentané qui leur feroit communiqué,
&
ces
va–
peurs, pouífées alors en maífe, pourroient devenir
d'autant plus pernicieufes, que ce mouvement feroit
plus fubit
&
plus rapide.
Cet inconvénient fera cependant bien fouvent iné–
vitable ' paree que l'humidité' occafionnée par' les–
pluies, donnera néceífairement de la deníité aux va:.
peurs' en s'oppofant
a
leur diífolution; paree que
la raréfaB:ion , caufée par la chaleur , néceffitera
cette denfité, en rendant l'air immobile
&
fragnant;
paree qu'enfin la réunion de ces différentes caufes
condenfera ces vapeurs. Ainfi l'air des
cimetiBres,
par
l'effet des pluies & ·de la chaleur, ou par leur con–
cours, deviendra fouvent capable d'infeéter cemc
qui le refpirer0nt' foit dans le lieu meme ' foit dans
le voifmage , fuivant la direB:ion
&
la véhémence
des vents.
Enterrer profondément les cadavres ,
&
mettre
entr'eux une difiance coníidérable; placer les
cime–
tieres
dans des endroits
oi1
l'air foit le moins humide
qu'il eíl: poilible,
&
jouiífe d'une liberté qui puilfe
favorifer le mouvement de toutes fes couches; voila
done les moyens d'empecher que les écoulemens ca–
davéreux ne forment des vapeurs d'une denfité dan..
gereufe,
&
que l'air dans les
cimetieres
ne foit jamais
aífez infeB:é pour etre pernicieux.
Mais comme cette infeB:ion e'fi fouvent inévita–
ble , il faut encore que les
cimetieres
foient íitués de
fac;on que les vapeurs infeB:es qu'ils fourniífent ne
puiífent etre portées fur des Jieux habités ' qu'ils
en
fo ient aífez éloignés pour qu'elles aient
le
tems d'etre
diífoutes avaot d'y arriver,
&
que la nature qes
v ents, capables de les
ch~rrier ~
favorife leur
diífo~
lution.
A
quelle profondeur faut-il enterrer les morts?
Quel efpace doit-on ailigoer
a
chaque fépult
?
La folution de ces problemes
efi encore néceífaire
p_our
pouvoir
déter~~e¿:
les
CQ.nd~t~ops
que
doi~
















