
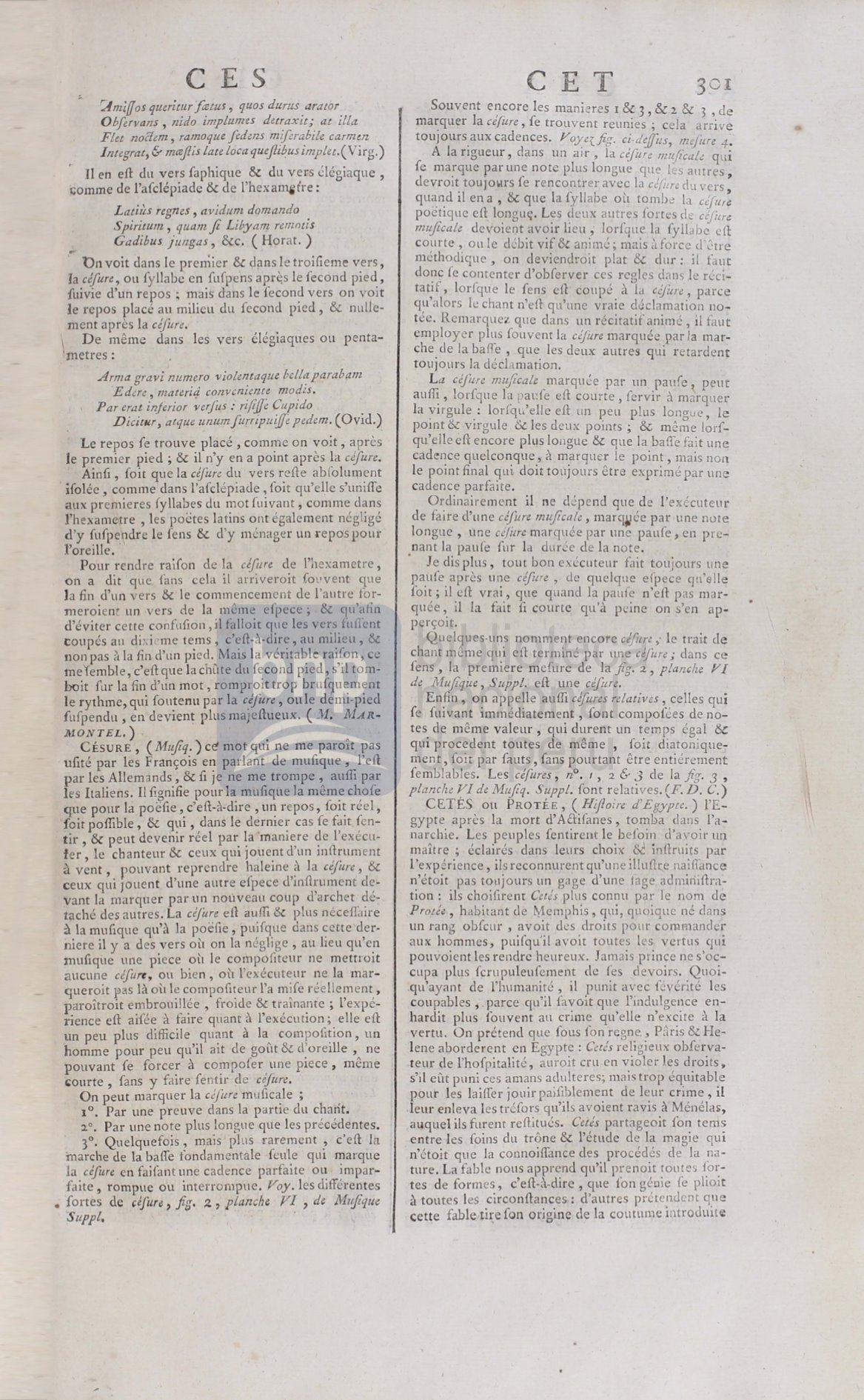
CE
S
r.Amiflos queritur fcetus, quos durus aratot
Ohfervans
,
nido implumes detraxit; at illa
FLet noClem
,
ramoque jedens mifi rabile carmen
lntegrat,
&
mce.ftis late loca
quefii~us
implet.(
Virg.)
' 11
en eft du vers faphique
&
du vers
1
légiaque ,
comme de l'afclépiade
&
de
l'hexa~fre:
Latius regnes, avidum domando
Spiritum., quam
ji
Lihyam remntis
Gadibus jungas,
&c. (
Horat.)
'On
voit dans le premier
&
dpns
le
troifieme vers,
Ia
clfure,
ou fyllabe en fufpens
apr~s
le fecond pied,
{uivíe d'un repos
~
maís dans le fecond vers on voit
le repos placé a
u
mílieu du fecond pied,
&
nulle–
rnent apres la
céfure.
\ De meme dans les vers élégiaques ou penta–
'Jnetres:
Arma gravi numero violentaque bellaparabam
E
dere
,
materirj conv niente modis.
Par
erat
inferior
verJas : rijiffe Cupido
D
icit11.r, atque
unumfurripu.if!e pedem.
e
O
vid.)
Le repos
(e
trouve placé, comme on voit,
apn~s
le
premier pied ;
&
il
n'y en a point apres la
céfure.
Ainfi, foit que la
céfure
du vers reíl:e abfolur:pent
ifolée, comme dans l'afcl lpiade , foit qu' lle s'uniífe
aux premieres fyllabes du mot fuivant, comme dans
l'hexametre , les poeres latins ont
1
galement négligé
d'y fufpendre le fens
&
d'y m' nager un repos pour
l'oreille. ·'
Pour rendre raifon de la
cifare
de l'11exametre,
on a dit que fans cela il arriveroit fo uvent que
la fin d'un vers
&
le commencement de l'autre for–
rneroiem un vers de la meme efpece;
&
qu'afin
d'éviter cette coofuíion, il falloit que les vers fuírent
coupés an diJ.i -me tems , c'efi-a-dire, au milieu,
&
non pas
a
la fin d'un pied. Mai_s
la
véritable raifon, ce
me'femble, c'eíl: que la chute du fecond pied, s'il tom–
boit fLlr la fin d'un mot, romproit trop bruf9nement
le rythme, qui foutenu par la
céfure,
onle demi-pied
{ufpendu , en devient plus majefiueux.
e
J1. JltfAJt–
MONTEL.)
CÉsURE, (
Mrtjiq.)
ce' mot qui ne me paroit pas
ufité par les Frans:ois en parlant de mufique , l'efi
par les Allemands,
&
fije ne me trompe, auffi par
les Italiens.
Il
fignifie pour la mufique la meme chofe
que pour la poeíie, c'eft-a-dire , un repos, foit r 'el,
foit
poffible,
&
q~,;ü
, dans le dernier cas fe fait fen–
tir,
&
peut devenir réel par la maniere de l'exécn–
fer, le chanteur
&
ceux qui jouent d'un in!l:rument
a
vent ' pou ant reprendre haleine
a
la
céfu.re'&
ceux qui JOnent d'une autre efpece d'infirument de–
vant la marquer par
un
nouveau coup d'archet dé–
taché des autres. La
céfure
efi auffi
&
plus nécefiaire
a
la mufique qu'a la poeíie' puifque dans cette der–
niere
il
y
a
des vers
Otl
on la néglige, au lieu qu'en
rnufique une piece Otl le compoíiteur ne mettroit
aucune
céfure,
ou bien, Otl l'exécute_ur ne la mar–
queroit
~as
la o\tle compoíiteur l'a mife réellement,
paroitroit embrouillée , froide
&
trainante ; l'expé–
rience eft aifée a faire quant
a
l'exécution; elle eíl:
un peu plus difficile quant
a
la compoíition'
un
homme pour peu qu'il ait de gol'tt
&
d'oreille , ne
pouvant fe forcer
a
compofer une piece ' meme
'ourte , fans y faire fentir de
céfure.
On peut marquer la
cifure
muficale ;
1°.
Par une preuve dans la part' e
du
charit.
2°.
Par une note plus longue que les précédentes.
3°.
Quelquefois, mais plus rarement , c'eíl:
la
marche de la baífe fondamentale fenle qui marque
la
cifure
en faifant une cadence parfaite ou
impar–
faite , rompue ou interrompue.
Voy.les
différentes
• fortes de
cifurs, fig.
;z.
,
planche
VI
,
de Mzifique
Suppl.
CET
301
Souvent encore les manieres r
&
3
&
2
&
3
d
1
~r.
r
'
'
e
ma~quer
a
ce,ure,
1e trouvent reunies; cela arrive
tOUJOurs.aux cadences.
J7o.Y_etfig. ci deffus, mejitre
4 •
A
la ngueur, dans un
a1r , la
céfur mu(ica/¿
qui
fe
ma.rque par une not plus longue que les a
m
res ,
devr01~
tOUJOI.lrS fe rencontrer avec la
céjur
du vers ,
qu~r:d
zl
en a ,
&
que la fyllabe o
't
tombe la
cifur,;
poet1que eíl:
longu~.
Les deux autre forr
s
d
cijltre
mujicale
devoient avoir lieu , lorC1ue la fyll abe
ft
courte' o
u
le cl 'bit vif
&
animé; mais
a
force d'"tre
méthodique, on deviendroit plat
&
dur;
il
faut
don~
fe conrenter d'obferver ces regles dans le r 'ci–
tat,if' lorfque le fens
fr
coup, a
la
cffore'
paree
q~1
alors le chant n'efi qu'une vraie
d~clamation
no–
tee. Remarqnez que dans un récitatif animé, il faut
employer plus fouvent
la
cljure
marqué par
la
mar–
che. de la balfe , que les deux atltres qui retardent
tOUJOurs la dé
el
'lmation.
La
céfure
mufical&
marqu
1
e par un paufe
peut
au~
' lorfque la
)at~fe
eft courte' fervir
a
m~rquer
la ylrgule.:
lorfq~l·
el! e eft
un
re
u
plus longue ' le
po1nt
&
v1rgule
&
les deux pomts ;
&
m" me Iorf–
qu'elle efi encore plus longue
&
que la baífe fait une
cadence quelconque'
a
marquer le point mais no
le point final qui doit toujours etre
expri~é
par une
cadence parfaite.
O~dinairement
il
ne d.:pend que de l'ex 'cutet
r
de faite d'une
céfure mujicale,
marq~ée
par une note
longue , une
ifúre
marquée par une paufe, en p re–
.nant la panfe fur la dur.:e de la note.
J
e dis plus, tour bon ex' cuteur fait touiours une
pa.ufe. apres
u~e
céfu.re,
de queJque
efpe~e
qn'elle
foit; 1l eíl: vrat,
que
quand la paufe n'eíl: pas mar–
quée '·
il
la fait fi courre qu'a
p
ine on s'en ap–
pers:oit.
Quelques-uns nomment encore
céfitra
!;
le trait de
chant meme qu.i eíl: termin, par une
cifur~;
dans
ce
fens , la prem1ere mefure de
la
fig.
.2.,
plamlze
P1
de Jlfujique, Su.ppl.
efi une
céfure.
linfin, on appelle auffi
cifures relatives,
celles qui
fe fuivant immédiatement, font compOD
1
es de no–
tes. de meme valeur' qui durent un temps
'gal
&
qm
proc~dent
tontes de m" me ,
foi diatonique–
ment' foit par fauts' fans pourtant etre entiér ment
femb!ables. Les
cé{ures,
n°.
1,
.2.
&
J
de
la
fig.
3
,
planclze
J;l
de Mttjiq. Suppl.
font relatives.
(F. D.
C.)
CETES
on
PROTÉE, (
1-Iifloire d'Egypte.)
l'E–
gypte apres la mort d'Aétifanes, tomba dans l'a–
narchie. Les peuples fentirent le befoin d'avoir
un
maitre ; éclairés dans leurs choix
ce
i
1íhuits par
1
'expérience, ils reconnurent qu'une illuíhe
n.aií1~mce
n'étoit pas tolljours nn gage d'une tage adminiíl:ra–
tion : ils choifirent
Cet
1
S
plus connu par le nom de
Protée,
habirant de Memphis, qui, quoiaue né dans
un rang obfcur , avoit des droits pour 'ommander
aux hommes, puifqu'il avoit toutes
l
s vertus qui
pouvoient les rendre heureux. Jamais prioce ne s'oc–
cupa plus fcrupulenfement de fes
evoirs. Quoi–
.qu'ayant de
1
humaniré ,
il
punit avec
f
v
1
rité les
coupables, .paree qu'il favoit qne l'indulgence en–
hardit plus fouvent an crime qu'elle n'excite
a
la
vertu. On prétend que fous fon
r
gne. , P1rís
&
He–
lene aborderent en Egypte:
Cet
1
5
religieux obferva–
teur de l'hofpitalité, auroit
cm
en violer les droits
:~
s'il el'n puni ces amans adulteres; mai. trop équitable
pour les laiífer jo
uir
pai!iblement de leur
e
rime, il
leur enleva les tréfors qu'ils avoient ravis a Ménélas,
auquel ils furent reíl:ítués.
Cetés
partageoit fon tems
entre les foins du trone
&
l'étude de la magie qu i
n'étoit que la connoi:ífance des procédés de
la
na–
ture. La fable nous apprend qu'il prenoit toures for–
tes de formes, c'eíl:-a-dire , q¡,te ion génie fe plioit
a toutes les circoníl:ances: d'autres pr 'rendent q le
cette fable tire fon origine de
la
coutnme
i ntrod uit ~
















