
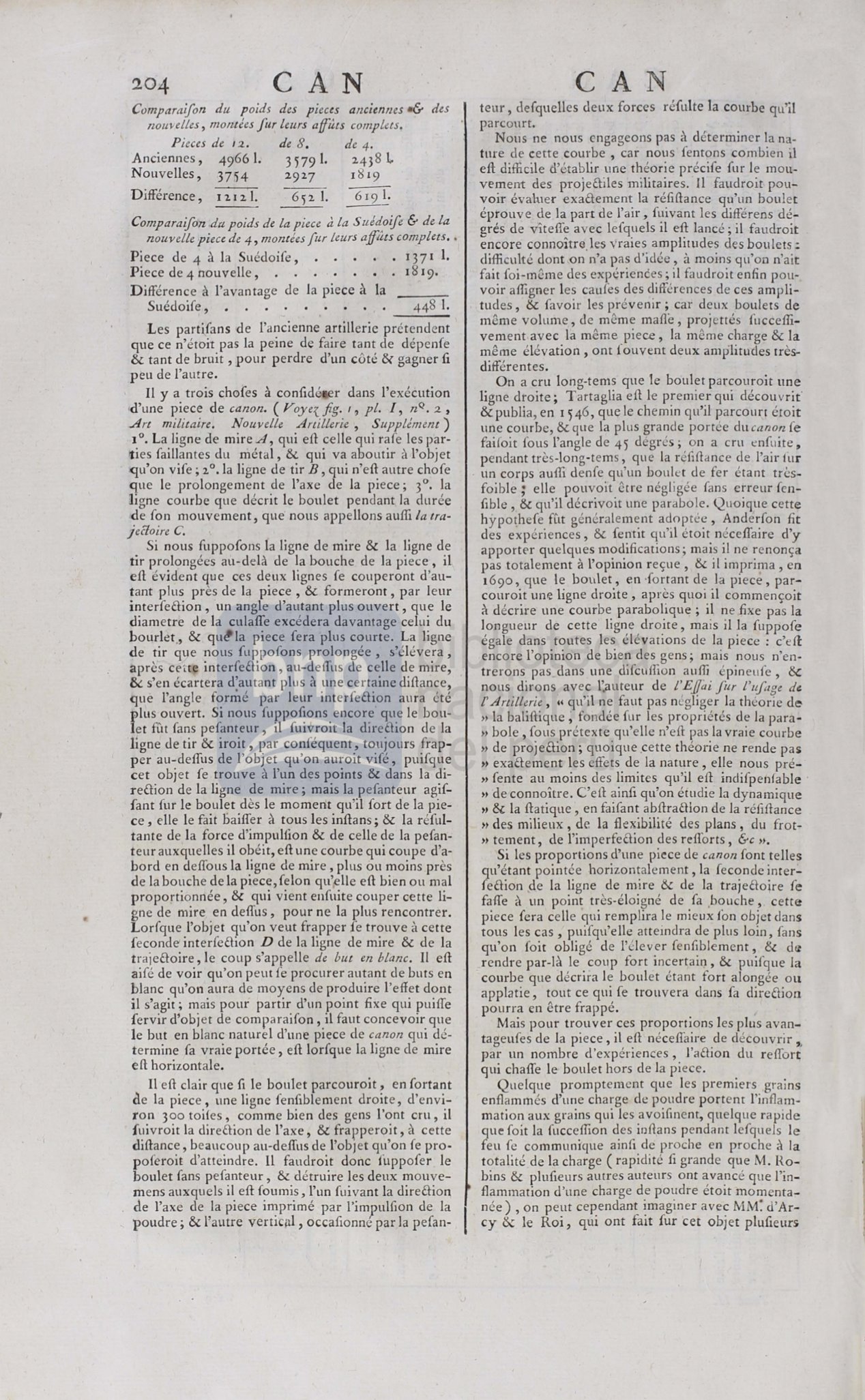
CAN
Comparaifon du poids des pieas anciennes
&
des
nouveLLes, mo11,tées Jrtr leurs afflus compl ts!
Pieces de
12.
de 8.
de
4·
Anciennes,
4966l.
3
579!.
2438
L.
Nouvelles,
37~4
2927
1819
D ifférence,
~
6 52
l.
619
!_.
Comparaifon .du poids de la piece
a
la
Sué~oife
&
de la
nouveLle piece de 4, montées fu.r leurs affitts complets.
·
Piece de 4
a
la Suédoife'
.
I
3
71
l.
Piece de
4
nouvelle,
.
r8
19.
Différence
a
l'avantage de la piece
a
la
Suédoife,
448
l.
Les
part~fans
de l'ancienne artillerie prétendent
que ce n'étoit pas la peine de faire tant de dépen{e
&
tant de bruit ' pour perdre d'un coté
&
gagner
fi
peu de l'autre.
Il
y
a trois chofes
a
coníid, er dans l'exécution
rd'une piece de
canon.
e
Yoyez
fig.
1,
pl.
1,
nQ.
2
,
Art
militaire.
Nottyelle Artillerie
,
Supplément )
1°.
La ligne de mire
A,
qui efi celle qui rafe les par–
íties faillantes du métal'
&
qui va aboutir
a
l'objet
qu'on vife; 2°.la ligne de tir
B,
qui n'efi autre chofe
que le prolongement de l'axe de la piece; 3°. la
ligne courbe que décrit le bonlet pendant ]a durée
de fon mouvement, que nous appellons. auffi
la tra-
jeaoire
C.
·
Si nous fuppofons la ligne de mire
&
la ligne de
tirprolongées au-dela de la bouche de la piece, il
e.fiévident que ces deux lignes fe couperont d'au–
tant plus pres de la piece,
&
formeront, par leur
interfeél:ion, un angle d'autant plus ouvert, que le
diametre de la culaífe excédera davantage celui du
bourlet,
&
qu
la piece fera plus courte. La ligne
de tir que nous fuppofons prolongée, s'élévera,
apres ceae
inter~eél:ion, au-~eífus
de
c~lle
d.e mire,
&
s'en écartera d autant plus a une cert
ameddtance,
qué l'angle formé par leur interfeél:i.on aura été
plus ouvert. Si nous fuppoíions encore que le
bou~
Iet fUt fans pefanteur, il fui roit la direétion de la
ligne de tir
&
iroit, par conféquent
~
toujours frap–
per au-deifus de l'objet qu'on auroit vifé, puifque
cet objet fe trouve
a
l'un des points
&
dans la di–
recrian de la ligne de mire; mais la pefanteur agif–
fant fur le boulet des le moment qu'il fort de la pie–
ce' elle le fait baiífer
a
tous les infians;
&
la réful–
tante de la force d'impulíion
&
de celle de la pefan–
teur auxquelles il obéit, efi une courbe qui coupe d'a–
bord en deífous la ligoe de mire, plus ou moins pres
<le la bouche de la piece, felon qu'elle efi bien o u mal
proportionnée,
&
qui vient enfuite couper cette li–
gne de mire en deífus, pour ne la plus rencontrer.
Lorfque l'objet qu'on veut frapper fe trouve
a
cette
feconde·interfeél:ion
D
de la ligne de mire
&
de la
tra jeél:oire, le coup s'appelle
de but en blanc.
Il efi
aifé de voir qu'on peut fe procurer autant debuts en
blanc qu'on aura de moyens de produire l'effet dont
il s'agit;
~ais
pour
partí~
d'un point fixe qui puiífe
fervir d
1
obJet de comparatfon, Il faut concev01r que
le but en blanc naturel d'
unepiece de
canon
qui dé–
termine fa vraie portée, e.fi lorfque la ligne de mire
efi horizontale.
11 efi clair que íi le boulet parcouroit
~
en fortant
d.e la piece, une ligne feníiblement droite, d'envi–
ron
300
toiíes, comme bien des gens l'ont cru, il
fuivroit la direél:ion de l'axe'
&
frapperoit'
a
cette
difiance, beaucoup au-deifus de l'objet qu'on fe pro–
poferoit d'atteindre. Il faudroit done íuppofer le
boulet fans pefa
nteur,
&
détruire les deux mouve–
mens au:xquels il
e.fifoumis, l'un fuivant la direél:ion
d.e l'axe de la piece imprimé par l'im,Pulfion de la
poudre;
&
l'autre vertic¡¡l , or;:caíionne par la pefan-
CAN
teur, defquelles deux forces réfulte la courbe qu'il
parcourt.
Nous ne nous engageons pas
a
déterminer la na–
ture de cette cout·be , car nous fentons combien il
eft difficile d'établir une théorie précife fur le mou–
vement des projeililes militaires.
ll
faudroit pou–
voir évaluer exaél:ement la réíillance qu'un boulet
éprouve de la part de l'air, fuivant les différens dé–
grés de viteífe avec lefquels il eft lancé ; il faudroit
encore connoitra)es
raies amplitudes des boulets:
difficulté dont on n'a pas d'idée'
a
rnoins qu'on n'ait
fait foi-merne des expériences; il faudroit enfin pou–
voir affigner les caufes des différences de ces ampli–
tudes,
&
favoi r les prévenir; car deux boulets de
meme volume' de meme maíle' projettés fucceffi–
vement avec la meme piece' la meme charge
&
la
meme élévation' ont fouvent deux amplitudes tres–
différentes.
On a cru long-tems que le boulet parcouroit une
ligne droite; T artaglia efi le
p~emi;.r
qui
déco~ v r~f
&
publia en
1
5
46, que le chemm qu1l parcoun etoit
une cou;be,
&
que la plus grande port ' e du
canon
fe
faifoit fous l'angle de
4
5
dégr
' s;
on a cru enfuite ,
pendant tres-long-tems, que la réfifiance de l'air fur
un corps auíli denfe qu'un boulet de fer étant tres–
foible
elle pouvoit er re négligée fans erreur fen–
íible
&
qu'il décrivoit une parabole. Quojque cette
hypdthefe fut
généralem~nt a~o~té :, ~ndé~fon
?t
des expériences,
&
fent1t qu 1l etolt neceifatre d
y
apporter quelques rnodifications; mais il ne
renon~a
pas totalement
a
l'opinion res:ue'
&
il imprima' en
1690,
que le bonlet, en ·fortant de ]a piece, par–
couroit une ligne droite, apres quoi il commens:oit
a
décrire une courbe parabolique ; il ne Jixe pas la
longueur de cette ligoe droite, mais illa fuppofe
égale dans toutes les élévations de ]a piece : c'eíl:
encore l'opioion de bien des gens; mais nous n'en–
trerons pas_dans une difcuffion auffi
' pine ufe ,
&
nous dirons avec
l~auteur
de
l'E./fai
fur
l'uflzge de.
l'
Artillerie ,
''
qu'il ne faut pas négliger la théorie de
>>la balifiique; fondée fur les propriétés de la para–
»
bole, fous prétexte qu'elle n'efr pas la vraie courbe
»
de projeél:ion; quoique .cette théorie ne rende pas
" exaél:ement les effets de la nature , elle nous pré–
»
fente au moins des limites qu'il eíl indifpet1fable
»de connoirre. C'efi ainíi qu'on éwdie la dynamique
>'
&
la .fiatique, en faifant abfira8lon de
la
réfifiance
»des milieux, de la flexibilité des plans, du frot–
» tement, de l'imperfeél:ion des reiforts,
&e
>,.
Si les proportions d'une piece de
canon
font telles
qu'étant
point~e
horizon:alement, la
fec~nde ~nrer
feél:ion ,de la ltgne de m1re
&
de la
traJeéto~re
fe
faffe
a
un point tres-éloigné de fa ,bouche' cette
piece fera celle qui remplira le mieux ion objet daos
tous les cas , puifqu'elle atteindra de plus loin, fans
qu'on foit obligé de
1'
' le ver feníiblement,
&
de:
rendre par-la le coup fort incertain,
&
puifque la
courbe que décrira le boulet étant fort alongée ott
applatie, tout ce qui fe trouvera daos fa direétion
pourra en etre frappé.
Mais pour trouver c
es proporrions les plus avan–
tageufes de la piece, il, e.fi néceifa!re .de déconvrir ,,
par un nombre d'exp nences,.
1
aél:wn du
reífor~
qui chaife le- boulet hors de la p1ece.
Quelque promptement que
les
premiers grains
enflamrnés d'une charge de poudre portent l'inflam–
mation aux grains qui les avoifinent, qnelque rapide
que foit la fucceffion des iDftans pendant lefquels le
feu fe comrnunique ainfi de ¡Jroche en proche
a
la
totalité de la charge
e
rapidité
fi
grande que M. Ro–
bins
&
pluíieurs autres auteurs ont
~va.ncé
que l'in–
flammation d'une charge de poudre eto1t mom nta–
née), on peut
ce~endant ~maginer ave~
MM:
d'Ar–
cy
&
le Roi,
qlll
ont fa1t fur cet
ob¡et
pluíienrs
















