
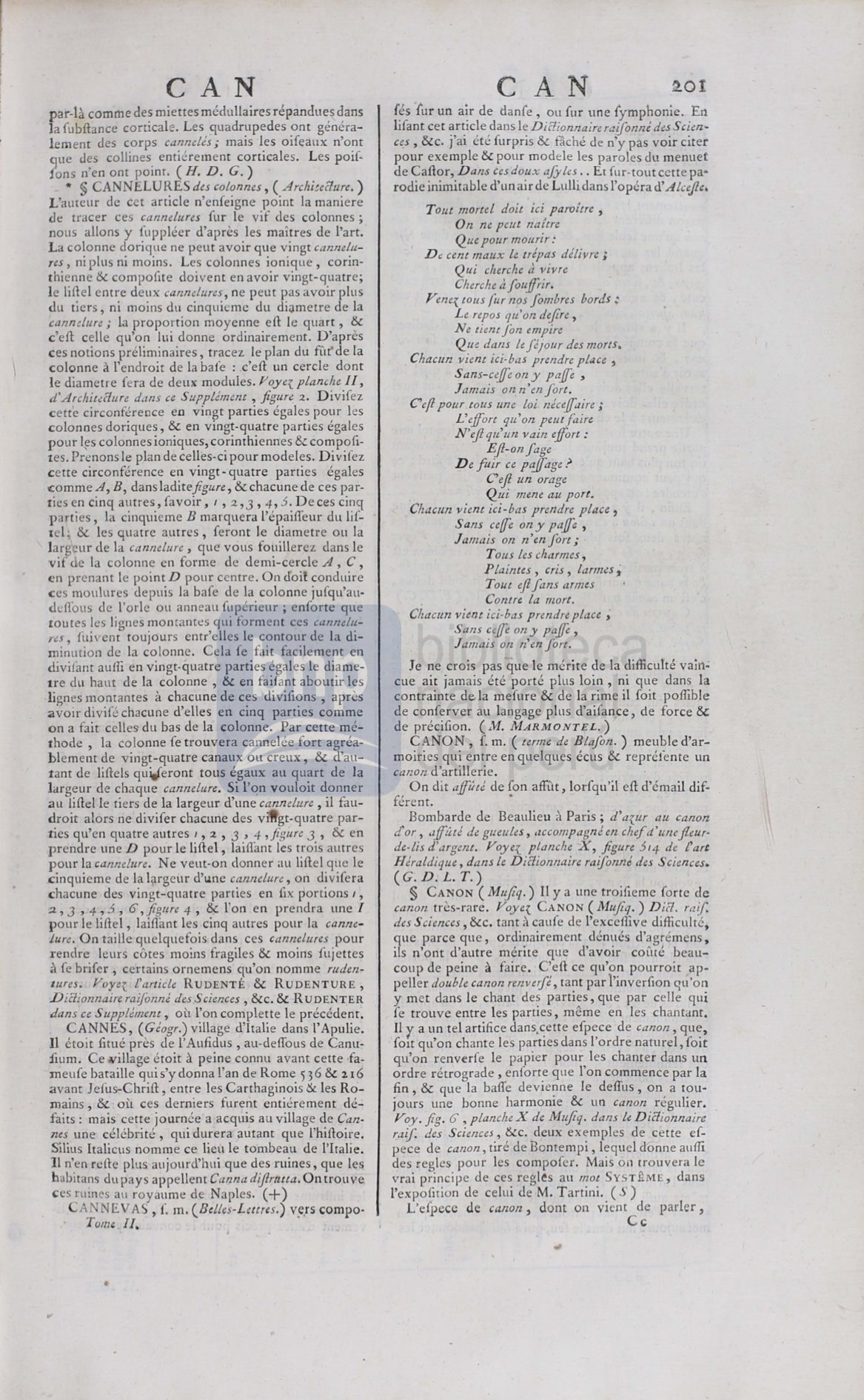
CAN
par-la comrne des miettes médullairesrépandues dans
la fubfl:ance corúcale. Les quadrupedes ont généra–
lement des corps
cannelés;
mais les oifeaux n'ont
que
d~s
collínes. entiérement corticales. Les poif,
fons n·en ont pomt.
(H. D. G.)
• §
CANNELURES
des colonnes,
(
Architeélare.)
L'aureur de cet article n'enfeigne point la maniere
de tracer ces
cannelures
fur le vif des colonnes ;
nous allons
y
fuppléer d'apres les maitres de l'art.
La
colonne dorique ne peut avoir que vingt
cannelu–
res,
ni plus ni moins. Les colonnes ioníque, corin–
thienne
&
compoúte doivent en avoir vingt-quatre;
le lifl:el entre deux
cannelures,
ne peut pas avoir plus
du tiers, ni moins du cinquieme du di¡;¡metre de la
cannelure;
la proportion moyenne efl: le quart ,
&
c'efl: celle qu'on lui donne ordinairement.
D'apn~s
ces notions préliminaires, tracez le plan du
ffu:·
de la
colonne
a
l'endroit de la bafe : c'efl: un cercle dont
le diametre fera de deux: modules.
P'
qye{ planche JI,
d'Architdlure dans ce Supplément, figure
2.
Divifez
cett'e circonférence eo vingt parties égales pour les
colonnes doriques,
&
en vingt-quatre parties égales
pour les colonnes ioniques, corinthiennes
&
compoú–
tes.
Pr
nons le plan de celles-ci pour modeles.
Di
vifez
cette circonférence en vingt- quatre parties égales
(;OrnmeA,
B,
dansladitefigure, &chacune de ces par–
tiesen cinq autres, favoir,
1,
.2,3,
4,
.5.
De ces cinq
parties, la cinquieme
B
marquera l'épaiífeur du lif–
t el ; & les quatre a.utres, feront
le
diametre ou la
largeu r de la
cannelure,
que vous fouillerez dans le
vif e la colonne en forme de derni-cercle
A, C,
en prenant le point
D
pour centre. On d'oit conduire
ces moulures depuis la bafe de la colonne jufqu'au–
deífous de l'orle ou anneau fup 'rieur ; enforte que
toutes les lignes mon tantes
qui
forment ces
cannelu–
res,
fi.tivent toujours entr'elles le contour de la di–
minution de la colonne. Cela fe fait facilement en
divifant auffi en vingt-quatre parties égales le diame–
tre du haut de la colonne ,
&
en faifant aboutir les
lignes montantes
a
chacune de ces divifions ' apres
avoir divifé chacune d'elles en cinq parties cornme
on a fait celles du bas de la colonne. Par cette mé–
thode , la colonne fe trouvera cannelée fort agréa–
blement de vingt-quatre canaux ou creux, & d'au–
tant de liíl:els qu · eront tous égaux au quart de la
largeur de chaque
cannelure.
Si l'qn vouloit donner
a u
liíl:elle tiers de la largeur d'une
cannelure,
il fau–
droit alors ne divifer chacune des vi gt-quatre par–
ties qu'en quatre autres
1,
.2 ,
3
,
4
,figure
3
,
&
en
prendre une
D
pour le liíl:el, laiífant les trois autres
pour la
cannelure.
N
e veut-on donner
a
u liíl:el que le
..cinquieme de la
l~rgeur
d'¡¡ne
canndure,
ori divifera
chacune des vingt-quatre parties en fix portions
1,
..2,
3
,
4,
.5,
6, figure 4,
& l'on en prendra une
1
pour le liíl:el , laiífant les cinq autres pour la
canne–
Jure.
On taille quelquefois dans ces
cannelures
pour
rendre leurs cotes moins fragiles
&
moins fujettes
a
fe brifer , certains ornemens qu'on nomme
rude!Z–
tures. Yoye{ L'article
RUDENTÉ
&
RUDENTURE,
D iaionnaireraifonné desSciences,
&c.&
RUDENt:ER
dans ce Supplément ,
Otl
l'on complette le précédent.
CANNES, (
Géogr.)
village d'Italie dans
l'
Apulie.
ll
étoit útué pres de
l'
Aufidus , au-deífous de Canu–
:fium. Ce :village étoit a peine connu avant cette fa–
meufe bataille quis'ydonna l'an de Rome
536
&
216
avant
J
efus-Chrifl:, entre les Carthaginois
&
les Ro–
mains , &
Otl
ces derniers furent entiéremenr dé–
faits : mais cette journée a acquis au village de
Can–
ms
une célébrité, qui durera autant que l'hifl:oire.
Silius Italicus nomme ce lieu le tombeau de l'Italie.
ll n'en reíl:e plus. aujourd'hni que des ruines, que les
habitans dupa ys appellent
Canna dijlrutta.
On trou ve
ces ruines au royaume de Naples. (
+)
A
NEVAS ,
f.
m. (
Belles-Leures.)
v_
e.rscompo–
Tome. 11.
CAN
~Ot
~és
fur un
a~r
de danfe, ou fur une fy mphonie.
Ert
Lfant cet artlcle dans le
DiRionnaire raifonné des S cien
ces'
&c. j'ai 'té furpris &
raché
de n'y pas voir citer
pour exemple & pour modele les paroles du menuet
de Cafl:or,
Dans cesdoux afyles ..
Et fur-toutcette pa"'
rodie inimitable d'un a
ir
de Lulli dans
1'
opéra d'
A lcejle.
Tout mortel doit ici paroítre
,
On ne peut naítre
Que pour mourir:
D~:
cent maux le trépas délivre;
Qui clzerche
a
yÍyre
Cherche
a
foujfrir.
.
Yenez tous {ur nos fombres borás:
Le repos qu'on dejire,
N e ti.ent fon empire
Que dans
ü
Jéjour des morts.
Chacun vient ici-bas prendre place
,
Sans-cejfe on y pajfe
>
lamais
OIZ
n'en Jort.
C'efl pour tous une loi. néceJ!aire;
L'ejfort qu'on peut.faire
N 'ejlqu'un vain ejfort:
Ejl-onfage
De fuir ce paj{age?
C'ejl
un orage
.
Qui mene au port.
Chacun vient ici-bas prendre place,
S
ans
ce/fe on
y
paf!e
,
lamais on n'en Jort;
T
ous les charmes,
P
laintes
,
cris
,
larmes;
Tout
efl
fans armes
Contre la mort.
Chacun vidl].t ici-bas prendre pLace ;
Sans celfe on y paj{e,
lamais on n'en Jort.
Je ne crois pas que le mérite de la difficulté vain.:
cue ait jamais été porté plus loin , ni que dans
la
contrainte de la rnefure
&
de la rime il foit poffible
de conferver au langage plus d'aifance, de force
&
de précifion.
(1-1-f.
MARMONTEL.)
CANON, f. m. (
terme de Blafon.)
meuble d'ar–
moiries qui entre en quelques écus & repréfente
un
canon
d'artillerie.
On dit
ajfúté
de fon affut, lorfqu'il eft d'émail dif-
férent.
·
Bornbarde de Beaulieu
a
París;
d'a{Ur au canon
cfor, ajff'tté de gueules, accompagné en chefd'unejleur
4
de-lis d'argent. Voye{ planche
X,
figure
$14
de l'art
H éraldique, dans le Diélionnaire raifonné des Sciences.
(G.D.
L.
T.)
§
CANON (
Mujiq.)
Il
y a une troiúeme {orte de
canon
tres-rare.
Voyez
CANON
e
Mujiq.) Día. raif.
des S ciences,
&c. tanta caufe de l'exceilive difficulté,
que paree que, ordinairement dénués d'agrémens,
ils n'ont d'autre mérite que d'avoir coí'ué beau–
coup de peine
a
faire. C'efl: ce qu'on pourroit
ap–
peller
double canon renverfé,
tant par l'inverúon
q~'on
y
met dans le chant des parties, que par celle qui
fe trouve entre les parties' meme en les chantant.
Il
y
a un tel artífice dans,cette efpece de
canon,
que,
f01t qu'on chante les parties dans l'ordre naturel, foit
qu'on renverfe le papier pour les chanter dans un
ordre rétrograde, enforte que l'on comrnence par
la
fin,
&
que la baífe devienne
le
deífus, on a tou–
jours une bonne harmonie
&
un
canon
régulier.
Voy. fig. 6 . planche X de Mujiq. dans leDiaionnaire
raif. des Sciences ,
&c. deux exemples de cette ef–
pece de
canon,
tiré de Bonternpi, lequel donne
aufii
des regles pour les compofer. Mais on trouvera le
vrai principe de ces
regl~s
au
mot
SYSTEME,
dans
l'expoúrion de celui de
M.
Tartini.
(S)
L'efpece de
canon,
dont on vient de parler,
Ce
















