
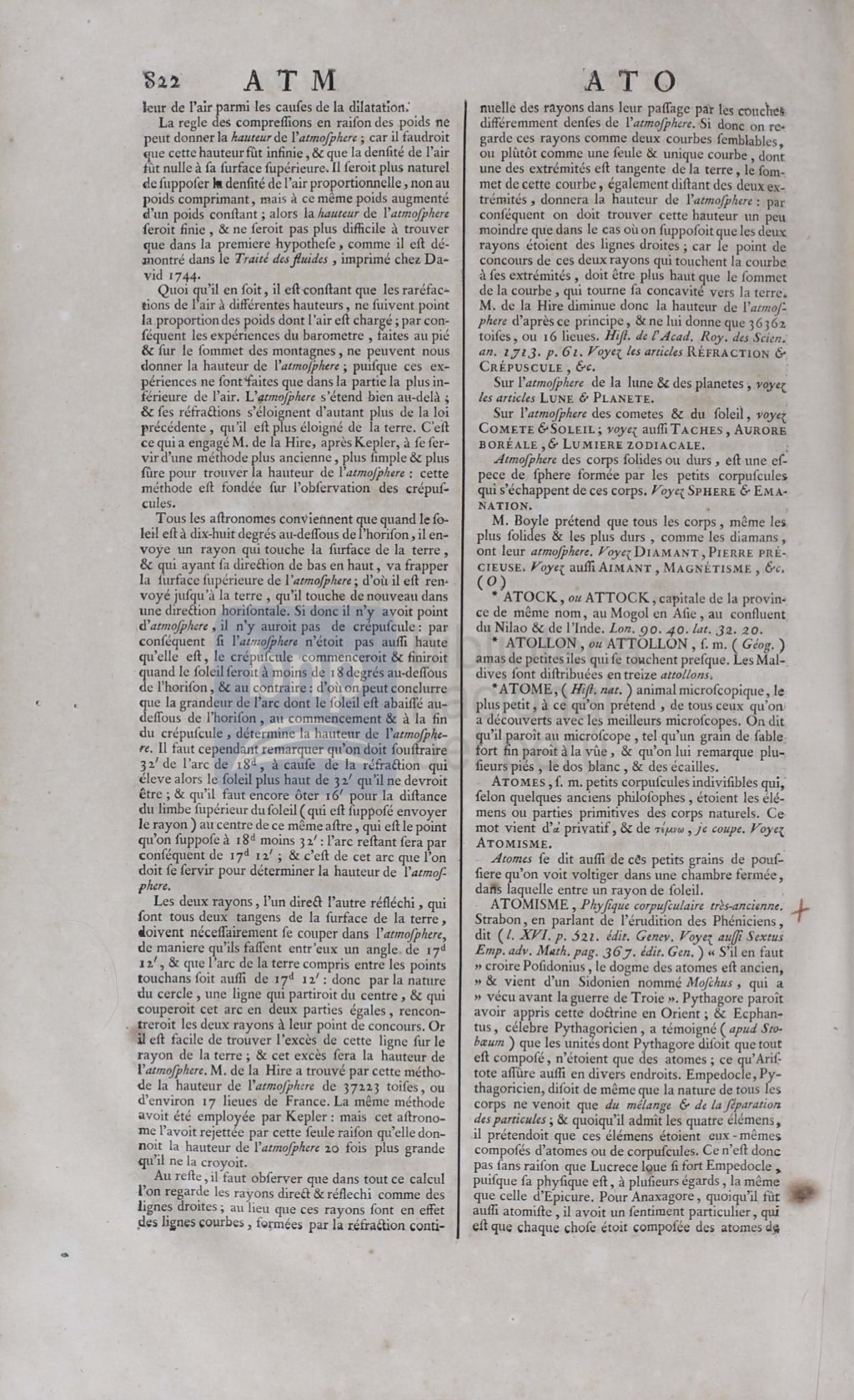
ATM
l~llr
de
l'air
parmi les caufes de la dilatation·:
La regle deS compreíIions en raifon des poids ne
peut donnerla
hauteurde I'atmofphere;
car il faudroit
'Jue cette hauteur fUt infime,
&
que la denlité de I'air
Rlt nulle
a
fa furface fupérieure,
n
feroit plus naturel
ee fuppofer
lw.
denlité de I'air proportionnelle, non au
poids comprimant, mais
a
ce meme poias augmenté
a'un poids conil:ant; a.lors la
hautel~r d~
I'atmofphere
feroit fime , & ne ferolt pas plus diffictle
a
trouver
eue dans la premiere hypothefe, comme il
ea
dé–
~ontré
daAS le
Traieé desfluides
,
imprimé chez.
Da~
vid 1744.
Quoi qu'il en foit, il efi-conaant que les raréfac"–
tions de I'air
a
différentes hauteurs, ne fuivent point
la proportion des poids dont I'air
ea
charg~;
par con–
féquent les expériences du barometre , faites au pié
&
fur le fommet des montagnes , ne peuvent nous
donner la hauteur de
I'atrnofphere;
puifque ces ex–
périences ne font'faites que dans la partie la plus in–
férieure de l'air.
L'atm0JPhere
s'étend bien au-dela;
&
fes réfrailions s'éloignent d'autant plus de la loi
précédente, qu'il
ea
plus éloigné de la terreo
Cea
ee qui a engagé M. de la Hire, apres Kepler, a fe fer–
vir d'une méthode plus ancienne, plus Í1mple
&
plus
ftITe pour trouver la hauteur de
l'atmojj>here:
cette
méthode ea fondée fur I'obfervation des
erépuf~
eltles.
Tous les afrronomes conviennent que quand le fo–
lei'¡
ea
a dix-huit degrés au-deífous del'horifon, il
en~
voye un rayon qui touche la fnrface de la terre,
&
qui ayant fa direaion de bas en haut, va frapper
la íilrface fupérieure de
1
'atmoJPhere;
d'oll
Ü
ea ren"
voyé jufqu'a la terre , qu'il touche de nouveau dans
une din:aion horifontale. Si donc ü n'y avoit point
d'atnuijphere,
il n'y auroit pas de crepufcule: par
eonféquent li
l'atmofphere
n'étoit pas auíIi haute
qn'elle ea, le crépufcule cornmenceroit
&
finiroit
quand le foleil feroit a moins de
18
degrés au-deífóus
de l'h0rifon,
&
au contraire: d'ol! on peut conclurre
que la grandeur de I'arc dont le foleil
ea
abaiífé au–
deífous de I'horifon, au commencement & a la fin
du crépufcule, détermine la hauteur de
I'atmofpl¡e–
re.
Il
faut cependant remarquer qu'on doit foufuaire
32,'
de l'arc de
18 d ,
a caufe de la réfrailion qui
éleve alors le foleil plus haut de
32,'
qu 'iI ne devroit
etre ; & qu'i1 faut encore oter 16' pour la dillance
du limbe fupérieur du foleil ( qui eft fuppofé envoyer
le
rayon ) au centre de ce meme afrre , qui
ea
le point
qu'on fuppofe
a
18 d
moins
32,' :
I'arc reaant fera par
conféquent de 17
d
u' ;
&
c'ea
de cet arc que l'on
doit fe fervir pour déterminer la hauteur de
l'atmof
phere.
Les deux rayons, ¡'un direa l'autre réfléchi , qui
font tous deux tangens de la furface de la terre,
1I0ivent néceífairement fe couper dans
I'atmofphere,
de maniere qu'ils faífent entr'eux un angle de 17
d
11.' ,
& que l 'arc de la terre compris entre les points
touchans foit auffi de 17
d
12,':
donc par la nanlre
du cercle , une ligne qui partiroit du centre,
&
qui
couperoit cet arc en deux parties égales, rencon–
treroit les deux rayons
a
leur point de concours. Or
il
ea facile de trouver l'exces de cette ligne fur le
rayon de la terre; & cet exces fera la hauteur de
l'atmofphere.
M. de la Hire a trouvé par cette métho–
de la hauteur de l'
atmofphere
de
372.2.3
toifes, ou
d'environ 17 lieues de France. La meme méthode
avoit été employée par Kepler : mais cet afrrono–
me l'avoit rejettee par cette feule raifon qtl'elle don–
noit la hauteur de l'
atmofphere
2.0
fois plus grande
qu'il ne la croyoit.
Au reae, il faut obferver que dans tout ce calcul
I:on
regar~e
les rayons direa & réflechi comme des
hgne.s droaes; au lieu que ces rayons font en effet
lies
J¡~nes
courbes ,
f~~mées
par la x:éfrall:ion
conti~
'AT O
nueIle des rayons dans leur paífage par les couche&
diJféremment denfes de l'
atmofphere.
Si done on re–
garde ces rayons comme deux courbes femblables
ou plfltot comme une feule & uniqtle courbe, do:C
une des extrémités ea tangente de la terre , le [om–
met de cette courbe, également diftant des deux ex–
trémités, donnera la hauteur de
I'atmofphere:
par
con(équent on doit trouver cette hauteur un peu
moindre qtle daas le cas
01:\
on {uppofoit qtle les deux
rayons étoient des lignes droites; car le point de
concours de ces deux rayons qui touchent la courbe
a
fes extrémités, doit etre plus haut 9ue le fommet
de la courbe, qui tourne (a concavite vers la terreo
M, de la Hire diminue donc la hauteur de
I'atmo;:
phere
d'apres ce principe, &ne lui donne que 36362
toifes,ou 16 lieues.
Hifl. de l'Acad. Roy. des Scim.
ano
z;;ri3.
p.
61.
Voye{ les anides
REFRACTION
&
CRÉPUSCULE,
&c.
Sur l'
atmoJPlzere
de la lune
&
des planetes ,
'Voye{
les articles
LUNE
&
PLANETE.
Sur
l'atmofphere
des cometes
&
du foleii,
Yoye{
COMETE &SOLEIL;
'Voye{
auíIiTACHES, AURORE
BORÉALE ,& LUMIERE ZODIACALE.
.
Atmofphere
des corps [olides ou durs, ea une ef–
pece de fphere formée par les petits corpufcule$
qtli s'échappent de ces corps.
Voye{
SPHERli & EMA–
NATION.
M. Boyle prétend que tous les corps , meme les
plus folides & les plus durs , comme les diamans ,
ont leur
atmofphere. Voye{
DI
AMANT , PIERRE PRÉ–
CIEUSE.
Voye{
auffi AIMANT , MAGNÉTlSME ,
&c.
(O)
*
ATOCK,
Olt
ATTOCK, capitale de la provin–
ce de meme nom, au Mogol en Alie, au confluent
du Nilao
&
de [,Inde.
Lon.
90.
4o.lat.
3.a.
.20.
*
ATOLLON,
ou
ATTOLLON,
f.
m.
(Géog.)
amas de petites iles qui fe tO\lchent prefque. Les Mal–
dives font diftribuées en trei2ie
attollolls.
*
ATOME, (
Hifl. nato
)
animal microfcopique, le
plus petit,
a
ce qu'on pretend , de tous ceux qu'on
a découverts avec les meilleurs microfcopes. On
dit
qu'i1 paroit au microfcope , tel qu'un grain de fable
fort fin parolt
a
la vlle, & qtl'on lui remarque
plu~
lieurs piés , le dos blanc , & des écailles.
ATOMES
,f.
m. petits corpufcules indiviíibles qui,
felon quelques anciens philofophes, étoient les élé–
mens ou parties primitives des corps naturels. Ce
mot vient d'
d
privatif,
&
de
7:""61
,je
coupe. Voye{
ATOMISME.
Atomes
fe dit auffi de
c~s
petits grains de
pouf~
liere qu'on voit voltiger dans une chambre fermée,
dans laquelle entre un rayon de feleiL
ATOMISME,
PhyJique corpufculaire
tr~s-ancimne.
1-
Strabon, en parlant de I'érudition des Phéniciens,
dit
(l.
XVI.
p•
.52l.
Mit. Gene'V. Voye{ au(Ji Sextus
Emp. ad'V. Mllth. pago
36:;.
Mit. Gen.
)
1(
S'ü en faut
" croire Polidonius , le dogme des atomes ea ancien,
" & vient d'un Sidonien nommé
Mofchus,
qui a
" vécu avant la guerre de Troie". Pythagore paroit
avoir appris cette doarine en Orient ;
&
Ecphan~
nls, célebre
Pytha~oricien,
a témoigné (
apud Sto–
haurn
)
que les unites dont Pythagore Moit que tout
ea compofé, n'étoient que des atomes; ce qu'Ari(,
tote aíflire auíJi en divers endroits. Empedocle, Py–
thagoricien, difoit de meme qtle la nature de touS les
corps ne venoit qtle
du mélange
&
de la flparation
des particules
;
& quoiqu'iI admit les quatre élémens,
iI
prétendoit qtle ces élémens étoient eux -meme$
compofés d'atomes ou de corpufcules. Ce n'eft done
pas fans raifon que Lucrece loue
ÍI
fort Empedocle •
puifque fa phyíique ea,
a
plllÍleurs égards , la meme
que celle d'Epicllre. Pour Anaxagore, quoiqu'iI fUt
auffi atornille, iI avoit un fenciment particulier ,
qui
eft que chaque chofe étoit compofée des atomes
rJ~
















