
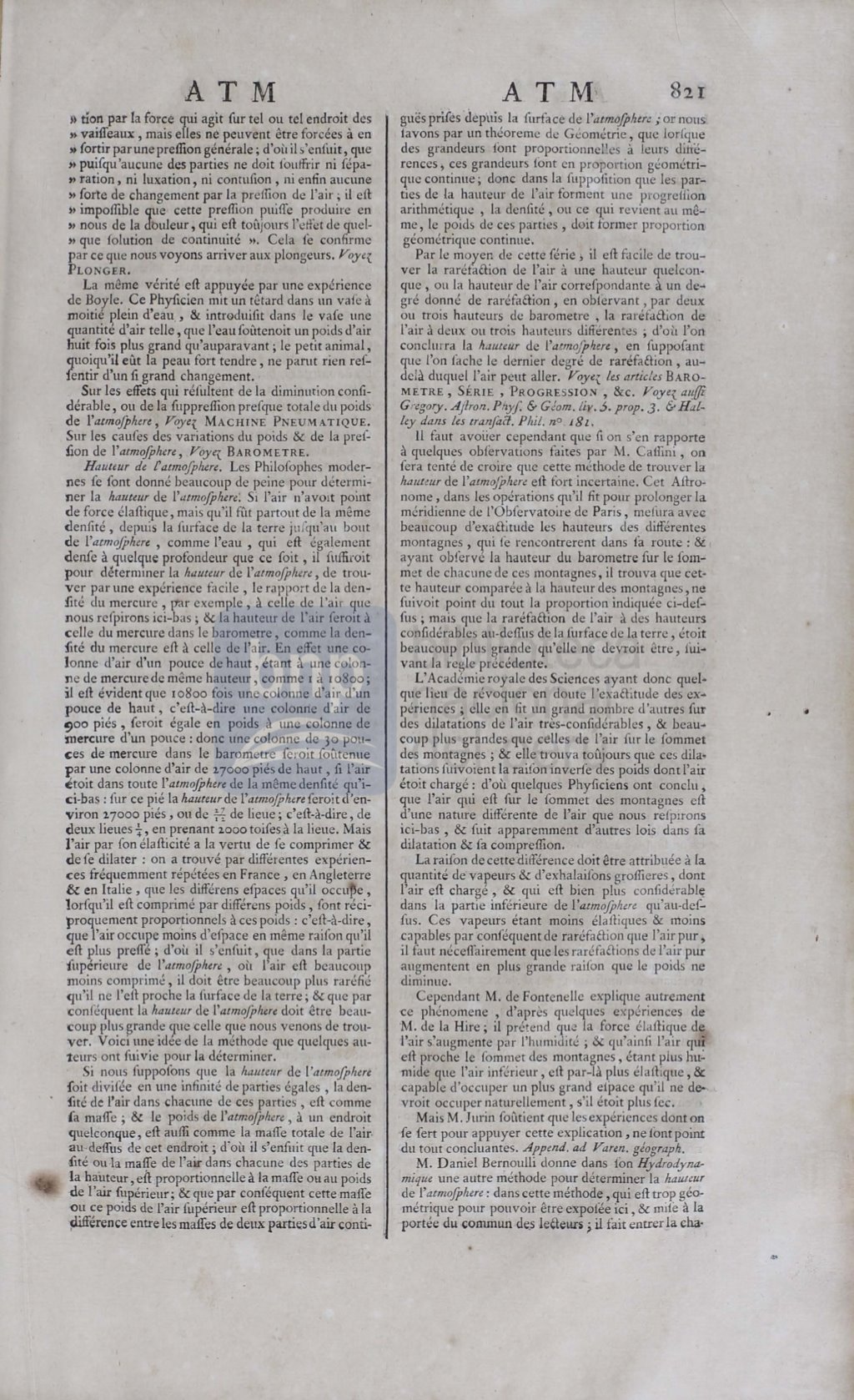
ATM
»
clon par la force
qui
agit fur tel ou tel endroit des
" vaiffeaux , mais elles ne peuvent etre forcées
a
en
»fortir parune preffion générale;
d'o~1
il s'enfuit, que
}) pl.\Ífqu'aucune des parties ne doit fonlfrir ni fépa–
,J
ration, ni luxation, ni contulion , ni enfin ancune
»
forte de changement par la preilion de l'air ; il efr
~.
impoilible que cette preilion pui{[e produire en
,J
nous de la dbuleur, qui efr tOlljOurS l'efFet de que!–
,. que {olucion de contimúté
1).
Cela fe confirme
par ce que nous voyons arriver aux plongeurs.
Yoye{
PLONGER.
La meme vérité efr appuyée par une expérienee
de
Boyle.
Ce Phyíicien mit un tetard dans un vafe
a
moitie pleio d'eau"
&
intrGlduilit dans le vafe une
quantité d'air telle, que l'eau foutenoit un poids d'air
huit fois plus grand qu'auparavant ; le petit animal,
quoiqu'il eut la peau fort tendre , ne pamt rien ref–
fentÍr d'un
íi
grand changement.
5ur les effets qui réfultent de la diminution conli–
dérable, ou de la fuppreilion prefque totale du poids
de
l'atmoJPhm, Yoye{
MACHINE PNEUMATIQUE.
Sur les caufes des variations du poids
&
de la pref–
fion de
l'atmofplzere,
Yoy~
BARoMETRE.
Hauleur de
f
atmofflzere.
Les Philo{ophes moder–
nes fe font donné beaucoup de peine pour détermi–
ner la
hauteur
de
l'atmofplzere:
Si l'air n'avOlt point
de force élafrique, mais qu'il fllt partont de la meme
deníité, depuis la fnrface de la terre jufqu'au bOllt
de
l'atmofplzere
,
comme l'eau , qui efl: égalemcnr
denfe a quelc¡ue profondeur que ce foit , il {lIffiroit
pour détermlOer la
hauteur
de l'
atmoffltert,
de trou–
ver par une expérience facile , le rapport de la den–
fité du mereure , p-ar exemple, a celle de l'air que
nous refpirons iei-bas ;
&
la hauteur de l'air feroit
a
eeHe du mercure dans le barometre, comme la den–
:(ité du mercure ell: a celle de l'air. En elfet une co–
Ionne d'air d'un pouce de haut, étant a une colon–
ne de mercure de meme hauteur , comme
1
a
10800;
il
efr évidentque
10800
fois une colonne d'air d'un
pouce de haut, c'ell:-a-dire une eolonne d'air de
~oo
piés , ferojt égale en poids
a
une colonne de
'mercure d'un pouee: donc une colonne de 30 pou–
ces de mercure dans le barometre feroit {outenue
par une colonne d'air de
1.7000
piés de haut ,
(¡
l'air
etoit dans tOute
l'atmofphere
de la meme denlité qu'i–
ei-bas : fur ce pié la
hauteurde l'atmofplzereferoit
d'en–
viron
1.7000
piés, ou de
H
de lieue; c'ell:-a-dire, de
deux lieues
~,
en prenant
2.000
toi{es a la lieue. Mais
l'air par ron élall:icité a la vertu de fe comprimer
&
de fe dilater : on a trouvé par différentes expérien–
ces fréquemment répétées en France , en Angleterre
&:
en ltalie , que les dilférens e{paces qu'il oecupe ,
lorfqu'il efl: comprimé par différens poids, font réci–
:proquement proportionnels a ces poids : c'ell:-a-dire,
que l'air occupe moins d'e{pace en meme raifon qu'il
ell: plus preífé; d'olr il s'en{uit, que dans la partie
íupérieure de
l'atmofphere
,
0[1
I'air efr beaucoup
moins comprimé, il doit etre beaucoup plus raréfié
qu'il ne l'ell: proche la furface de la terre;
&
que par
conféquent la
hauteur
de
l'atmofphere
doit etre bean–
coup plus grande que celle que nous venons de trou–
ver. Voici une idée de la méthode qne que!ques au–
teurs ont fuivie pour la déterminer.
Si nous fnppo{ons que la
hautellr
de
l'atmofflzere
foit divifée en une infinité de parties égales , la den–
Ílté de l'air dans chacune de ces parties , ell: comme
fa maffe ;
&
le poids de
I'atmofplzere,
a
un endroit
quelconque, efl: auffi comme la maífe totale de l'air·
au-deífus de cet endroit ; d'ol1 il s'enfuit que la den–
Ílté Oll la maífe de l'ait dans ehacune des parties de
la hauteur, ell: proportionnelle
a
la maífe
OH
au poids
de l'air {lIpérieur;
&
qne par conféquent cette maífe
ou ce poids de l'air fupérieur ell: proportionnelle
a
la
p.ifférence entre les maífes de deux
parti~s
d 'air conti-
AT M,
gues prifes clep\¡is la furfaee de
l'atml!fphere
;
OI nOllS
favons par un théoreme de Geométrie, que lcrique
des grandeurs {ont
proportionne~es
a
leUl's
cli:tié–
rences, ces grandeurs {ont en proportion geométri–
que continue; done dans la fuppofition que les par–
ties de la hauteur de I'air forment une progreH¡oJ1¡
arithmétique , la denlité , ou ce qlli revient au me–
me, le poids de ces parties , doit former proportion
géométrique continue.
Par le moyen de cette {érie;
ü
efr faeile de trou–
ver la raréfaéEon de I'air
a
une hauteur quelcon–
que, on la hautellr de l'air corre[pondante
a
un de..
gré donné de raréfaaion, en oblervant , par deux
ou trois hauteurs de barometre , la raréfaaion de
l'air
a
deux ou trois hauteurs dilférentes ; d'oll l'on
conclurra la
harueur
de
l'atmoffhere,
en {uppo{ant
que I'on fache le dernier degré de rarefaaion , au–
deJa duquell'air peut aUer.
Yoye{ les anides
BARO–
METRE, SÉRIE , PROGRESSION ,
&c. Yoye{ a4fi
Gregory. Aftron. Phyf
&
Géom.li'V.
.s.
prop.
3.
&
Hal–
ley dans les tra!lfaél. PI,il. !lO 18z.
II faut avoiier cependant que fi on s'en rapporte
a
que!ques obfervations faites par M.
CafIi.ni, on
fera tenté de croire que eette méthode de trouver la
lzauteur
de
l'atmoj'pher.
ell: fort ineertaine. Cet Afuo–
nome , dans les opérations qu'il fit pour prolonger la
méridienne de I'Ob{ervatoire de Paris, mefura avec
beaucoup d'exaaitude les hauteurs des dilférentes
momagnes , qui Ce rencontrerent dans
la
route :
&
ayant oHerve la hauteur du barometre {ur le fom–
met de chacune de ces momagnes, il trouva que cet–
te hauteur comparée a la hauteur des montagnes, ne
fuivoit point du tout la proportion indiquée ci-de{–
fus ; mais que la raréfaaion de l'air a des hauteurs
con{¡dérables au-deífus de la {mface de la terre , étoit
beaucoup plus grande qu'elle ne devroit etre, {ui–
vant la regle précédente.
L'Académie royale des Sciertces ayant done que!–
que lieu de révoquer en doute I'exailitude des ex"
perienees ; elle en fit un grand nombre d'autres fUI
des dilatations de I'air tres-eonlidérables ,
&
beau–
coup plus grandes que celles de l'air fur le fommet
des montagnes ;
&
elle trouva toujours que ces dila.
tations {uivoientia raifon inverfe des poids dont l'air
étoit chargé: d'olr que!ques Phyficiens ont conclu,
que l'air qlli ell: fur le {ommet des montagnes eíl
d'une nature dilférente de l'air que nous relfllrons
ici-bas ,
&
fuit apparemment d'autres lois dans fa
dilatation
&
fa comprellion.
La raifon de eette.dilférence doi! etre attribllée
a
la
quantité de vapeurs
&
d'exhalaifons grollieres, dont
l'air ell: charge ,
&
qui ell: bien plus
confidérabl~
dans la partie infétieure de
l'atmofplzere
qu'au-de{–
fus. Ces vapeurs étant moins elalliques
&
moins
capables par conféqllent de raréfaaion que I'air pur,
il fant néceífairement que les raréfaaions de l'air pUI
augmentent en plus grande raifon que le poids ne
diminue.
Cependant M. de Fontenelle explique autrement
'Ce phénomene , d'apres quelques expérienees de
M. de la Hire; il prérend que la force élafrique de
I'air
s~augmente
par I'humidité ;
&
qu'ainli I'air qui
ell: proche le {ommet des montagnes, étant plus
hu~
'mide que I'air inférieur , ell: par-la plus élall:ique ,
&
capable d'occuper un plus grand eipace qu'il ne de.-–
vroit occuper naturellement, s'il étoit plus fee.
Mais M. lurin fOlltient que lesexpériences donton
fe fert pour appuyer cet!e explication
>
ne (om poin!
du tout eoncluantes.
Append. ad Yaren. géograph.
M. Daniel Bernoulli donne dans fon
HydrodylUb
mique
une autre méthode pour déterminer la
Izauteur
de l'
atmofphere
:
dans cette méthode , qui efr trop géo–
métrique pour pOlivoir etre expolee ici ,
&
mile
a la
portée du commun de_s leaeurs ; il
filit
entrer la chao
















