
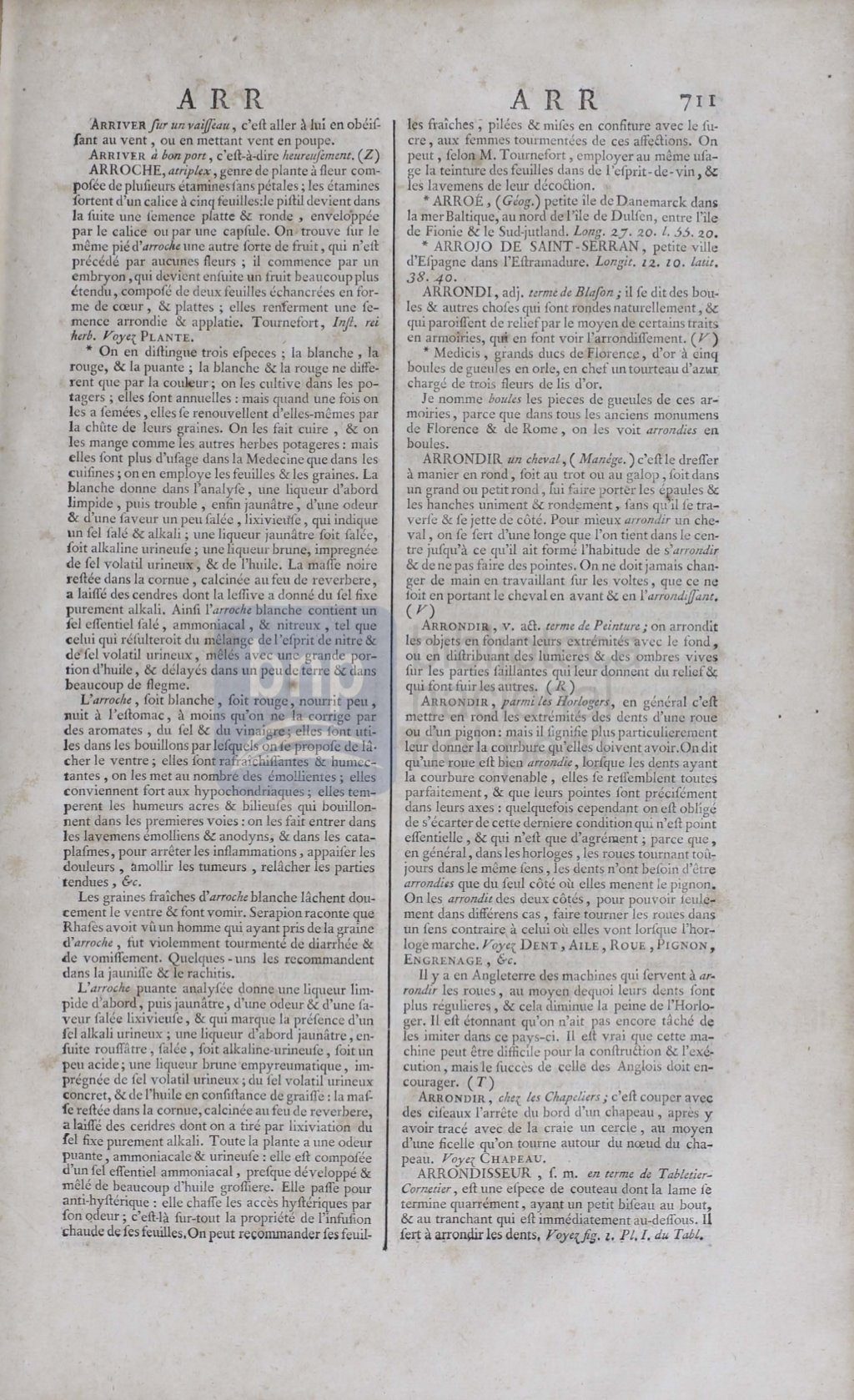
ARR
ARRIVER
litr un vaijJeau,
c'eíl: aller
a
luí en obéif–
fant au vent , ou en mettant vcnt en poupe.
ARRIVER
a
hon pon,
c'eíl:-¡l-dire
heurerifement. (Z)
ARROCHE,
atriplex,
genre de plante
a
fleur com–
pofée de plufieurs étaminesfans pétales; les étamines
Cortent d'un calice
a
cinq feuilIes:le piíl:il devient dans
la [uite une {emence platte & ronde, envelo·ppée
par le calice ou par une cap[ule. On trouve [ur le
meme pié
d'arrocne
une autre [orte de fruit, qui n'eíl:
précédé par aucunes fleurs ; il commence par un
embryon, qui devient enfuite un fruit beaucollpplus
étendll, compofé de deux feuilles t!chancrées en for–
me de creur, & plattes ; elles renferment une fe–
mence alTondie & applatie. Tomnefort,
Infl.
rei
Iterh. Voyet
PLANTE.
... On en cliíl:ingue trois efpeces ; la blanche , la
rouge,
&
la Imante; la blanche & la rouge ne di!fe–
rent que par la couleur; on les cultive dans les po–
tagers ; elles font annuelles : mais quand une fois
011
les a femées, elles fe renouvelIent d'eIles-m&mes par
la chelte de leurs graines. On les fait cuire , & on
les mange comme les autres herbes potageres : mais
elles font plus d'ufage dans la Medecine que dans les
cuifines ; on en employe les feuilles & les graines. La
hlanche donne dans l'analyfe, une liqueur d'abord
!impide, puis trollble , eHnn jaunatre, d'une odeur
&
d'une [aveur un peu [alée , lixivieli[e, qui indique
un
[el Calé & alkali ; une Jiqueur jaunatre [oit [alée,
{oit alkaline urineu[e; une liqueur brune, impregnée
de fel volatil urineux, & de l'huile. La maífe noire
reíl:ée dans Ja cornlle , calcinée au feu de reverbere,
a
laiífé des cendres dont la leffivc a donné du fel fixe
purement alkali. Ainfi
l'arroche
blanche contient un
{el eífentiel falé, ammoniacal,
&
nitreux , tel que
celui qui réfulteroit du melange del'efprit de nitre &
ce [el volatil urineux, melés avec une grande por–
tion d'huile, & délayés dans un peude terre & dans
beaucoup de flegme.
L'
arroche
,
foit blanche, foit rouge, nourrit peu,
Jluit
¡I
l'eíl:omac, a moins qu'on ne la corrige par
des aromates , du fel & du vinaigre; elles [ont uti–
les dans les bouillons par lefqueIs on [e propo[e de la·
cher le ventre; elles [ont rarraichilfames
&
humec–
lantes , on les met au nombre des émollientes; elles
conviennent fort aux hypochondriaques; elles tem–
perent les humeurs acres
&
bilieu[es qni bouillon–
nent dans les !)remieres voies : on les fait entrer dans
les lavemens emolliens & anodyns, & dans les cata–
pla[mes, pour arreter les inflammations, appaifer les
douleurs , 3mo11il" les tumeurs , reHl.cher les parties
tendues,
&c.
Les graines rralches d'
arroche
blanche 1achent dou–
cement le ventre & font vomir. Serapionraconte que
Rhafes avoit Vil un homme qui ayant pris de
la
graine
d'arroche,
fut violemment tOllrmenté de diarrhée &
(\e vomiífement. Quelques - uns les recommandeut
dans la jauniífe & le rachitis.
L'
arroche
puante analyfée donne une liqlleur lim–
pide d'abord, puis jaunatre, d'une odeur & d'une [,–
veur [alée lixivieu[e, & qtÚ marque la préfence d'un
fel
alkali urineux ; une liqueur d'abord jaunatre, en–
fuite rouífatre , [alée, [oit alkaline-urineu[e , [oit un
peu acide; une liqueur bnme empyreumatique,
im–
prégnée de [el volatil urineux; du [el volatil mÍlleux
concret, &de l'huile en confiil:ance de graiífe: la maf–
fe reíl:ée dans la cornue, calcinée au feu de reverbere,
a
laiífé des cerldres dont on a tiré par lixiviation du
(el fixe purement alkali. Toute la plante a une odeur
puante, ammoniacale
&
urineufe : elle eil: compofée
d'un
fel
eífentiel ammoniacal, prefque développé
&
me~é
de beaucoup d'huile groiliere. Elle pa{fe pour
antI-hyíl:érique : elle chaífe les acces hyíl:érigues par
fon qdeur; c'eíl:-la fm-tout la propriété de l'mfufion
~haude
de [es feuilles. On peut re¡;onunander
[es
feuil-
ARR
711
les
fralches ; pilées & mires en confiture avec le [u–
cre , aux femmes tonrmenrées de ces a!feéEons. Ou
peut, [elon M. Toumefort, cmployer au meme u[a–
ge la teinhtre des feuilles dans de l'e[prit-de-vin, &
les lavemens de lettr décoaion.
... ARROÉ,
(Géog.)
petite ile deDanemarck dans
la merBaltique, au nore! de rile de Dulfen, entre l'ue
de Fionie & le Sud-jutland.
Long.
2j. 20.
l.
.
H.
20.
... ARROJO DE SArNT -SERRAN, petite ville
d'E[pagne dans l'Eíl:ramadure.
Longit.
l2. lO.
lacit.
38.4
0 .
ARRONDI, adj.
terme de Elafon;
iI
[e dit des bou–
les
&
aun'cs cho[es qui [ont rondes naturelIement, &
qlÚ paroiífent de reliefpar le moyen de certains traits
en armoiries, quí en font voir l'arrondiífement.
(V)
*
Medicis, grands ducs de
Florence ,
d'or
a
<:inq
boules de gueules en orle, en chef lm tourteau d'azlIIr
chargé de trois fleurs de lis d'or.
Je nomme
hautes
les pieces de gueules de ces ar–
moiries, parce que dans tous les anciens monumens
de Florence
&
de Rome, on
les
voit
arrondies
en
boules.
ARRONDIR
un cheval,
(
Manége.
)
c'efr le dreífer
a
manier en rond, foit au trot on au galop ,[oit dans
nn grand ou petit rond, tui faire porter les
é~aules
&
les hanches uniment &
rond~ment,
fans qu il [e tra–
verte & [e ¡ette de cOté. Pour mieux
arrondir
un che–
val, on [e [ert d'une longe que 1'on tient dans le cen–
tre jtúqu'a ce qu'il ait formé l'habitude de
s'arrolidir
& de ne pas faire des pointes. On ne doit jamais chan–
ger de main en travaillant fttr les voltes, que ce ne
10it en portant le cheval en avant & en
l'
arrondiffant.
(V)
ARRONDIR, v. aB:.
terme de Peinture;
on arrondit
les objets en fondant leurs extrémités avec le fond ,
ou en di1l:ribuant des lumieres
&
des ombres vives
[ur les parties [aillantes qui leur donnent du rc1ief&
qui font nlir les autres.
(R)
ARRONDIR,
parmi les Horlogers,
en général c'eíl:
mettre en rond les extrémités des dents d'unc roue
ou d'un pignon: mais
iI
fignifie plus particulierement
leur donner la courbure qu'elles Joivent
avoir.Ondir
qu'tme roue eíl: bien
arrondie,
lor[que les dents ayant
la combure convenable, elles [e re1femblcnt toutes
parfaitement, & que lettrs pointes [ont précifément
dans leurs axes : quelquefois cependant on eíl: oblígé
de
s'
écarterde cene derniere condition quí n'cíl: point
eífentielle, & qui n'eíl: que d'agrément ; parce que,
en général, dans les horloges ,les roues tonmant
toCt–
jours dans le meme [ens, les dents n'ont be[oin d'etre
arrondies
que du [eul coté Oll elles menent le pignon.
On
les arrondit
des deux cotés , pour pouvoir jeule–
ment dans clifférens cas , faire tourner les roues dans
un fens contraire
a
celui on elles vont lor[que 1'hor–
loge marche.
Voyet
DENT, AILE, ROUE ,PIGNON,
ENGRENAGE ,
&c.
II
y a en Angleterre des machines qui [ervent a
aro
rondir
les roues, au moyen dequoi leurs dents [ont
plus régulieres, & cela diminue la peine de l'Horlo–
ger.
Il
eíl: étonnant qu'on n'ait pas encore
t~ché
de
les imiter dans ce pays-ci.
Il
eít vrai que cette ¡;11a–
chine peut etre diflicile pour la confuuB:ion & l'exé–
cnrion, mais le fucces de celle des Anglois doit en–
courager.
(T)
ARRONDIR,
c1ltt les Chapeliers;
c'eíl: couper avec
des ci[eaux l'arrete du bord d'lm chapeau , apres y
avoir tracé avec de la craie
llll
cercIe, au moyen
d'tme ficelle qu'on tourne autour du nreud du cha–
peau.
Voye{
CHAPEAU.
ARRONDISSEUR ,
f.
m.
en terme de Tahletier–
Cornetier,
efr une e[pece de cOllteau dont la
lame
fe
termine ql.larrément, ayant un petit bifeau au bout
7
& au tranchant qui eíl: immécliatement au-deífous.
Il
[eX"!
a
arron~
les dents.
roye{fi¡.
l.
pl.
l.
du Tabl.
















