
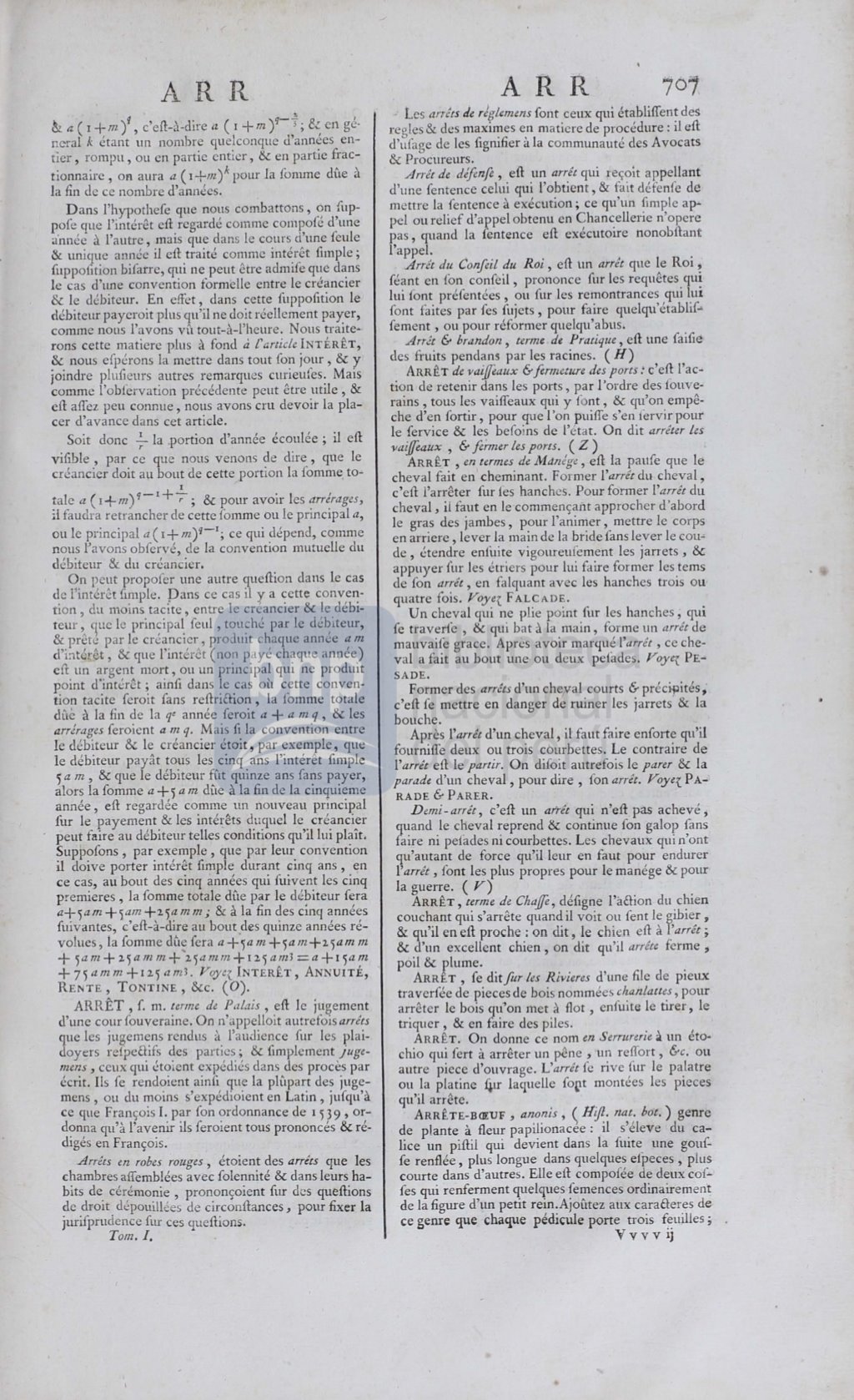
ARR
&.
11.(
1
+m)1,
c'eft-a-dire
a
(1
+m
)1-
1;
&
en ge.
neral
k
érant un nombre quelconque d'années en–
tier , rompu , ou en partie emier,
&
en partie frac-
tionnaire, on aura
11. (
1
+1Il/
¡JOur
la
Comme dtle a
la fin de ce nombre d'années.
D ans l'hypotheCe que nous combattons, on fup–
poCe que l'inténh eíl: regardé comme compoíC.: d'une
a'nnée a l'autre, mais que dans le cours d'une Ccule
&
uniquc année il eíl: traité comme intéret fimple ;
filppoútion biCarre, qui ne peut etre admiCe que dans
le cas d'une convemion formelle entre le créancier
&
le débiteur. En effet, dans cette Cuppofition le
débiteur payeroit plus qu'il ne doir réellement payer,
comme nollS l'avons
Vl1
reur-a-I'heure. Nous traite–
rons cette matiere plus
a
fond
ti
l'arúcle
INTÉRtT,
&
nous eCpérons la mertre dans tout Con jour ,
&
Y
joindre plufiems autres remarques curieu(es. Mais
comme l'obfervauon précédente peut etre utile,
&
dI:
a{fez peu connue, nOllSavons cm devoit la pla–
cer d'avance dans cet article.
Soir donc
7-
la portion d'année écoulée ; il eíl:
vifilile, par ce que nous venons de dire , que le
créancier doir au bour de cette portion la
Comme
to-
tale
a
(
1+
111
r -
1
+
+- ;
&
pour avoir les
arrérages,
¡¡
falldra retrancher de cetre
Comme
oule principal
a,
ou le principal
a(t+m)q-l;
ce qui dépend, comme
nous l'avons obfervé, de la convention mutuelle du
débiteur
&
du créancier.
On peut propofer une atltre queí!:ion dans le cas
de l'intérer úmple. pans ce cas il
y
a cette conven–
tion, dtl moin5 tacite, entre le créancier
&
le débi–
teur, (jue le principal Ceul ,touché par le débiteur,
&
prere par le créancier , produir chaque année
a m
d'i:1téret,
&
que l'inrércr (non payé chaque année)
di
un argenr mort, ou un principal qui ne produit
point d'iméret; ainfi dans le cas
O~l
cette conven–
tion tacite Ceroit Cans reí!:rifrion, la
Comme
retale
dtle a la fin de la
'l'
année Ceroit
a
+
a m
'l,
&
les
arrérages
feroient
a m
'l.
Mais fi la convention entre
le débiteur
&
le créancier éreit, par exemple, que
le débiteur payat tOU5 les cinq ans l'intéret fimple
5
a m,
&
que le débiteur fllt quinze ans fans payer,
alors la
Comme 11. +5 am
dtie a la
fin
de la cinquieme
année , eíl: regardée comme un nouveau pnncipal
fur le payement
&
les intérets duquel le créancier
peut faire au débiteur telles conditions qu'illui plalt.
SuppoCons, par exemple , que par leur convention
il doive porter intéret úmple durant cinq ans, en
ce cas, au bout des cinq années qui Cuivent les cinq
premieres , la
Comme
totale dtle par le débiteur Cera
a+5am +sam +25amm;
&
a
la fin des cínq années
Cuivantes, c'eíl:-a-dire au bout des quinze années ré–
volues, la fomme
dtl~
Cera
a+sam+5alll+25am rn
+
5am+ 25 amm + 25amm+I25alllJ =a+15 arn
+75amm+I25amJ.
Vtry'e{ INTERET, ANNUITÉ,
RENTE, T ONT1NE, &c.
(O).
ARRET , f. m.
terme de Palais
,
eíl: le jugement
d'une cour fouveraine. On n'appelloit autrefois
arréts
que les jugemens rendus
a
I'audience fur les plai–
doyers refpeétifs des parties ; & úmplement
juge–
mms>
cellX qui étoient expédiés dans des proces par
écrit. Ils fe rendoient
ainú
que la plftpart des juge–
mens, ou du moins s'expédioient en Latin, jufqu'a
ce que Frans;ois
1.
par fon ordonnance de 1539, or–
donna qu'lI l'avenir ils feroient tous prononcés
&
ré–
digés en Frans;ois.
Arrüs
en
robes rouges ,
étoient des
arréts
que les
chambres a{femblées avec {olennité
&
dans leurs ha–
bits de. cérémonie , pronons;oient fur des queíl:ions
de dmlt dépouillé s de circoníl:ances
>
pour fixer la
jurifprudence fm ces queí!:ions.
Tom.
J.
ARR
Les
ardts tle rJgiernens
{ont ceux qui établi{fent des
regles
&
des maximes en matiere de procédure : il
dl:
d'u(.1ge de les fignifier
a
la communauté des Avocats
&
Procureurs.
Ardt de défonJe,
eí!: un
arrét
qui
r-e~oit
appellant
d'une fentence celui qui l'obtient ,
&
fait défenfe de
mettre la fentence
11
exécution; ce qu'un fimple ap–
pel ou relief d'appel obtenu en Chancellerie n'opere
pas, quand la fentence eí!: exécutoire nonobíl:ant
l'appel.
Ardt du Confoii du Roi,
eí!: iLn
arrét
que le Roi ,
féant en len confeil, prononce fur les requetes qui
lui Com pré(entées , ou
{ur
les remontrances qui lui
Cont faites par fes fujets , pour faire quelqu'établif ..
fement , ou pour réformer quelqu'abus.
Arr':t
&
brandon, terme de Pratique ,
eí!: une (aifie
des fruits pendans par les racines.
(H)
ARRET
de vaiffiaux
&
firrneture des ports
.'
c'eí!: l'ac–
tion de retenir dans les ports, par I'ordre des Couve–
rains , tous les vai{feaux qui
y
font,
&
qu'on empe–
che d'en Cortir, pour que
1
'on puiífe s'en fervir pour
le (ervice
&
les be(oins de l'état. On dit
arréter les
vaijJeaux
,
&
flmltr les pomo
(Z)
ARRt T ,
en termes de Mdllége ,
eíl: la panfe que le
cheval fait en cheminant. Former
l'arrOc
du cheval,
c'eí!: l'arreter {m les hanches. Pour fonner
l'arrét
du
cheval, il faut en le commens;añt approcher d 'abord
le gras des jambes , pour ['animer, mettre le corps
en arriere , lever la main de la bride fanslever le cou–
de, étendre enfuite vigoureu(ement les jarrets
>
&
appuyer fur les étriers pour lui faire former les tems
de fon
arrét,
en falquanr avec les hanches trois ou
quatre fois.
Voye{
FALCADE.
Un cheval qui ne plie point [ur les hanches, qui
fe traver(e ,
&
qui bat
a
la main, forme un
ardt
de
mauvaiCe grace. Apres avoir marqué
l'arrét
,
ce che–
val a fait au bout une ou dem, pefades.
V'!re¡:
PE–
SADE.
Former des
arréts
d'un che,val courts
&
pré6pités ;
c'eí!: fe mettre en danger de ruiner les jarrets
&
la
bouche.
Apres
l'arrét
d'un cheval, il faut faire enforte qu'il
fourni/fe deux ou trois courbettes. Le contraire de
l'arrét
eíl: le
partir.
On difoit autrefois le
parer
& la
parade
d'un cheval, pour dire , fon
arret. Voye{
PA–
RADE
&
pARER.
D emi-arrét ,
c'eíl: un
arrét
qui n'eíl: pas achevé ,
quand le cheval reprend
&
conunue fon galop fans
faire ni pe/ades ni courbettes. Les chevaux qui n'ont
qu'autant de force qu'illeur en faut pour endurer
l'arrét
,
font les plus propres pour le manége & pour
la guerreo
(V)
ARd.T,
mme de Clzaj{e,
déúgne I'¡¡frion du chien
couchant qui s'arrete quand il voit ou fene le gibier ,
&
qu'il en eí!: proche : on dit, le chien eí!: a
l'
arrét ;
&
d'un exceUent chien, on dit qu'il
ardte
ferme ,
poil & plumeo
ARRET, fe
ditfur
les Riyieres
d'une file de pieux
traverfée de pieces de bois nommées
challiattes
,
POttr
arreter le bois qu'on mer
11
flot , enfuite le tirer, le
triquer,
&
en faire des piles.
ARRET. On donne ce nom
en
Sermrerie.
a
un éto–
chio
qui fert a arreter un pene ,
1Jl1
re{fort,
&c.
ou
autre piece d'ouvrage.
L'arret
fe rive
[UT
le palatre
ou la platine
4tr
laquelle fOllt montées les pieces
qu'il
arr~te.
ARRETE-B<I!:UF,
anonis,
(Hij!.
nato bot.)
genre
de plante a fleur papilionacee: il s'éleve du ca–
lice un piíl:il qui devient dans la Cuite une gouf–
fe renflée , plus longue dans quelques elpeces , plus
courte dans d'autres. Elle eí!: compofée de deux cof–
Ces
qui renferment quelques femences ordinairement
de la figure d'un petir rein.Ajotltez allX caraéteres de
ce genre
que
chaque pédi,ule porte trois feuilles;
Vvvv
ij
















