
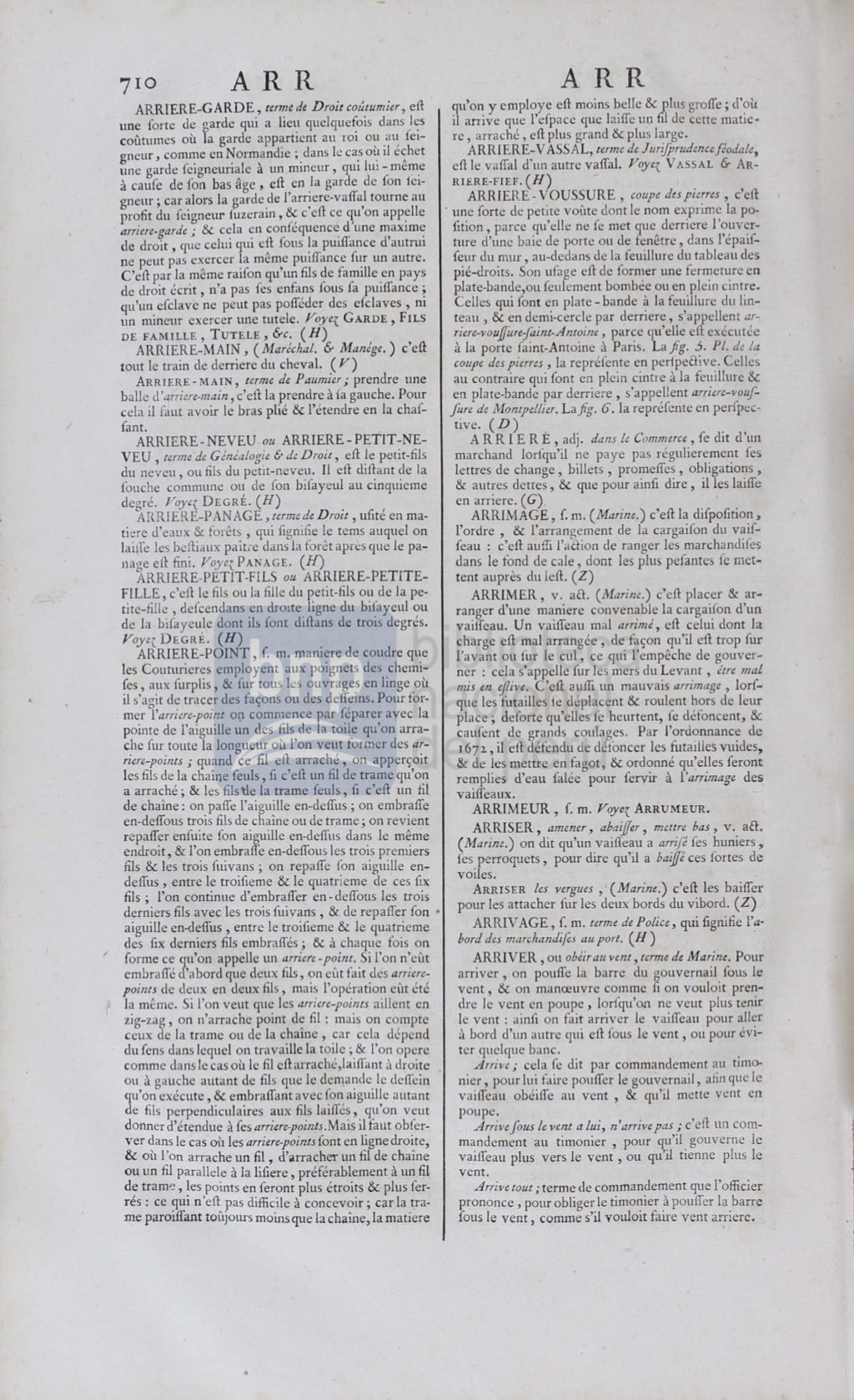
7
10
ARR
ARRIERE-GARDE,
ttnnede Droiteoútumier,
eíl:
une forte de
~arde
qui a liet.l
quelque~ois
dans
I~s
coíhumes Ol!. la garde appartlent al! rOl ou au fel–
gneur, comme en Normandie ; dans le cas 011 il échet
une garde feigneuriale
a
un mineur, qui luí - mem.e
a caufe de fon bas age, eíl: en la garde de fon fel–
gneur; car alors la garde de I'arriere-vaífal rourne au
protit du feigneur {uzerain,
&
c'ea ce qu'on appelle
arriere-garde;
&
cela en con(équence d'une maxime
de droit, que celui qui
e~
fous !a puiífance d'autrui
ne peut pas exercer la meme pmífance fm un autre.
Cea par la meme rai(on qu'un fils de famille en pays
de droit écrit , n'a pas (es enfans (ous (a puiifance ;
qU'Ul1 e(clave ne peut pas poíféder des efclaves , ni
un mineur exercer une hltele.
Voye{
GARDE, FILS
DE FAM ILLE , TUTELE,
&e.
(H)
ARRIERE-MAIN,
(Maréehal.
&
Manége.)
c'eft
tout le train de derriere du cheval.
(V)
ARRIERE - MAIN,
terme de Paumier;
prendre une
balle d
'arriere-main,
c'eíl: la prendre
a
{a gauche. Pour
cela il faut avoir le bras plié
&
l'étendre en la cha(–
fant.
ARRIERE-NEVEU
ou
ARRIERE-PETIT-NE–
VEU,
terme de Généalogi¿
é/
de D roit,
eíl: le petit-fils
du neveu, ou fils du petit-neveu. Il eíl: diaant de la
fouche commune ou de fon bi(ayeul au cinquieme
degré.
Voye{
DEGRÉ.
(H)
ARRJERE-PANAGE,
arme
de
Droit
,
ulité en ma–
tiere d'eaux
&
forets , qui fignitie le tems auquel on
laiífe les beíl:iaux palue dansla foret apres que le pa–
nage
ea
fini.
Voye{ PANAGE.
(H)
ARRlERE-PETlT-FILS
ou
ARRIERE-PETITE–
FlLLE, c'eíl: le fils ou la filie du petit-fils ou de la pe–
tite-fille , de(cendans en drOlte ligne du bi(ayeul ou
de la bi(ayeule dont
ils
font diíl:ans de trois degrés.
Voye{
DEGRÉ.
(H)
ARRIERE-POINT,
f.
m. maniere de coudre que
les Counlrieres employent aux poignets des chemi–
fes, aux furplis ,
&
(ur tous les ouvrages en linge oh
iI
s'agit de tracer des fac;ons ou des deífeins. Pour for–
mer
I'arrún-point
on commence par (éparer avec la
pointe de I'aiguille un des fils de la roile qu'on arra–
che (ur tonte la longueur 011 I'on veut former des
ar–
riere-poims;
quand ce lil eíl: arraché, on apperc;oit
les fils de la cha'ine (euls, íi c'eíl: un fil de trame qu'on
a arraché;
&
les filstle la trame (enls, fi c'eíl: un til
de chaine: on paífe l'aiguille en-deífus ; on embraífe
en-deífous trois 615 de chaine ou de trame; on revient
repaífer enfuite (on aiguille en-deífus dans le meme
endroit,
&
I'on embralfe en-deífousles trois premiers
fils
&
les trois (uivans; on repaífe (on aiguille en–
deífus , entre le troifieme
&
le quatrieme de ces fix
fils; I'on continue d'embraífer en -deífous les trois
derniers fils avec les trois (uivans ,
&
de repaífer (on •
aiguilJe en-deífus , entre le troilieme
&
le c¡uatrieme
des fix derniers ñIs embraífés;
&
achaque fois on
/ forme ce qu'on appelle un
arriere-point.
Si I'on n'ellt
embraífé d'abord que deux fils, on eitt faÍt des
arriere–
poims
de deux en deux fils, mais l'opération eut été
la meme. Si l'on veut que les
arriere-poims
ailJent en
zig-zag, on n'arrache point de 61 : mais on compte
ceux de la trame ou de la chaine, car cela dépend
du fens danslequel on travaille la toile ;
&
l'on opere
comme dansle cas Ol!. le 61 eíl:arraché,laiífant
a
droite
ou agauche autant de fils que le delT!ande le deífein
qu'on exécute,
&
embraifant avec fon aiguille autant
de lils perpendiculaires aux fils laiifés , qu'on veut
donner d'étendue
a
fes
arriere-points.Mais
il fam ob(er–
ver dansle cas otIles
arrier~pointsfont
en lignedroite,
&
oh l'on arrache un lil, d'arracher un fil de chalne
ou un fil parallele
a
la liíiere, préférablement
a
un fil
de trame , les points en feront plus étroits
&
plus (er–
Tés: ce qui n'ea pas difficile a concevoir' car la tra–
me paroiífant tOlljOurSmoinsque la chame; la matiere
ARR
qu'on
y
employe ell moins belIe
&
plus groífe ; d'oM
il arrive que l'e(pace que laille
tlO
fil de cette matie–
re, arraché, eíl: plus grand
&
plus large.
ARRIERE-VASSAL,
terme de
J
urijj;rudenceféodale,
eíl: le vaífal d'tl1l autre vaífal.
Voye{
VASSAL
&
AR–
RIERE-FIEF.
(H)
ARRIERE - VOUSSURE,
eoup¿ des pierres
,
c'eíl:
. une forte de petite voitte dont le nom exprime la po–
fition, paree qu'elle ne fe met que derriere l'ouver–
hlre d'unc baie de porte ou de fenetre, dans l'épaif–
feur du mur, au-dedans de la feuillure du tableau des
pié-droits. Son u(age ell: de former une fermeture en
plate-bande,ou (eulement bombée ou en plein cintre.
CelJes qui font en plate - bande
a
la feuiJlure dulin–
teau ,
&
en demi-cercle par derriere, s'appeUent
ar–
rier~'YouJlure-/aint-Antoine,
paree qu'eUe
ea
exécutée
a
la porte (aint-Antoine
a
Paris. La
fíg.
j.
Pl. de la
eoupe des pierres
,
la repréfente en perfpeélive. CeHes
au contraire qui (ont en plein cinrre
a
la feuillure
&
en plare-bande par derriere, s'appellent
arriere-'You!–
ji;re
de Montpellier. Lafig.
6.
la repré(ente en perfpec–
tive.
(D)
ARR 1ERÉ, adj.
dans
le
Commuce,
fe dÍt d'un
marchand 10riqu'i1 ne paye pas rég111ierement (es
lettres de change, billets , promeífes , obligations,
&
aurres dettes,
&
que pour ainú dire, i1les lai1I'e
en arriere.
(G)
ARRIMAGE, f. m.
(Marine.)
c'eíl: la di(poficion,
l'ordre,
&
l'arrangement de la cargaifon du vaif–
feau : e'eíl: allili l'aélion de ranger les marchandifes
dans le tond de cale, dont les plus pefantes (e met–
tent aupres du leíl:.
(Z)
ARRIMER, v. aél.
(Marine.)
c'eíl: placer
&
ar–
ranger d'une maniere convenable la cargaifon d'un
vaiifeau. Un vaiifeau mal
arrimé,
eíl: celui dont la
charge eíl: mal arrangée , de fas:on qll'il eíl: trop (ur
I'avant ou úlr le cul, ce qlli l'empeche de gouver–
ner : cela s'appelle (ur les mers du Levant ,
ltre mal
mis en lli'Ye.
C'eíl: auffi un mauvais
arrimage
,
lorf–
que les fl1tailles
!(:
déplacent
&
roulent hors de leur
place; deforte qu'elles
le
heurtent, fe défoncent,
&
cau(ent de grands coulages. Par l'ordonnance de
1672 ,
il eíl: défendu de défoncer les futailles vuides,
&
de les mettre en fagot,
&
ordonné qu'elles (eront
remplies d'eau (alée pour fervir
a
l'arrimage
des
vaiifeallx.
ARRIMEUR,
f.
m.
Voye{
ARRUMEUR.
ARRISER,
amener, abaiJIer, mmre bas,
V.
aél.
(Marine.)
on dir qu'un vaiíleau a
arrift
(es huniers,
fes perroquets, pour dire qu'il a
baiffl
ces fones de
voiles.
ARRISER
les 'Yergues,. (Marine.)
c'eíl: les baiífel'
pour les attaeher (ur les del1x bords du vibord.
(Z)
ARRIVAGE, f. m.
terme de Poliee,
qui úgnitie
l'a·
bord des marchandifes all port. (H)
.
ARRIVER, ou
obéiralt'Ywt, mme de Marine.
Pour
arriver, on poulfe la barre du
~ouvernail
fous le
vent,
&
on manrel1vre comme
h
on vouloit pren–
dre le vent en poupe, lorfqu'on ne veut plus ten
ir
le vent : ainfi on fait arriver le vaiífeau pour aller
a bord d'un autre 'lui eíl: fous le vent, ou pour évi–
ter quelque banco
Arri'Ye;
cela fe dit par commandement au timo–
nier, pour lui faire pouifer le gouvernail, ann que le
vailfeau obéiífe al! vent ,
&
qu'i1 metre vent en
poupe.
Arri'Yefous le'Yem a lui, n'arri'Yepas;
c'ea
un com–
mandement au timonier , pOtlr qu'il gouverne le
vaiífeau plus vers le vent , 011 qu'i:l tienne plus le
vento
Arri'Ye tout;
terme de commandement que l'officier
prononce, pour obliger le timonier
a
pouífer la barre
fous le vent, eomme s'il vouloit fau'e vent arrierc.
















