
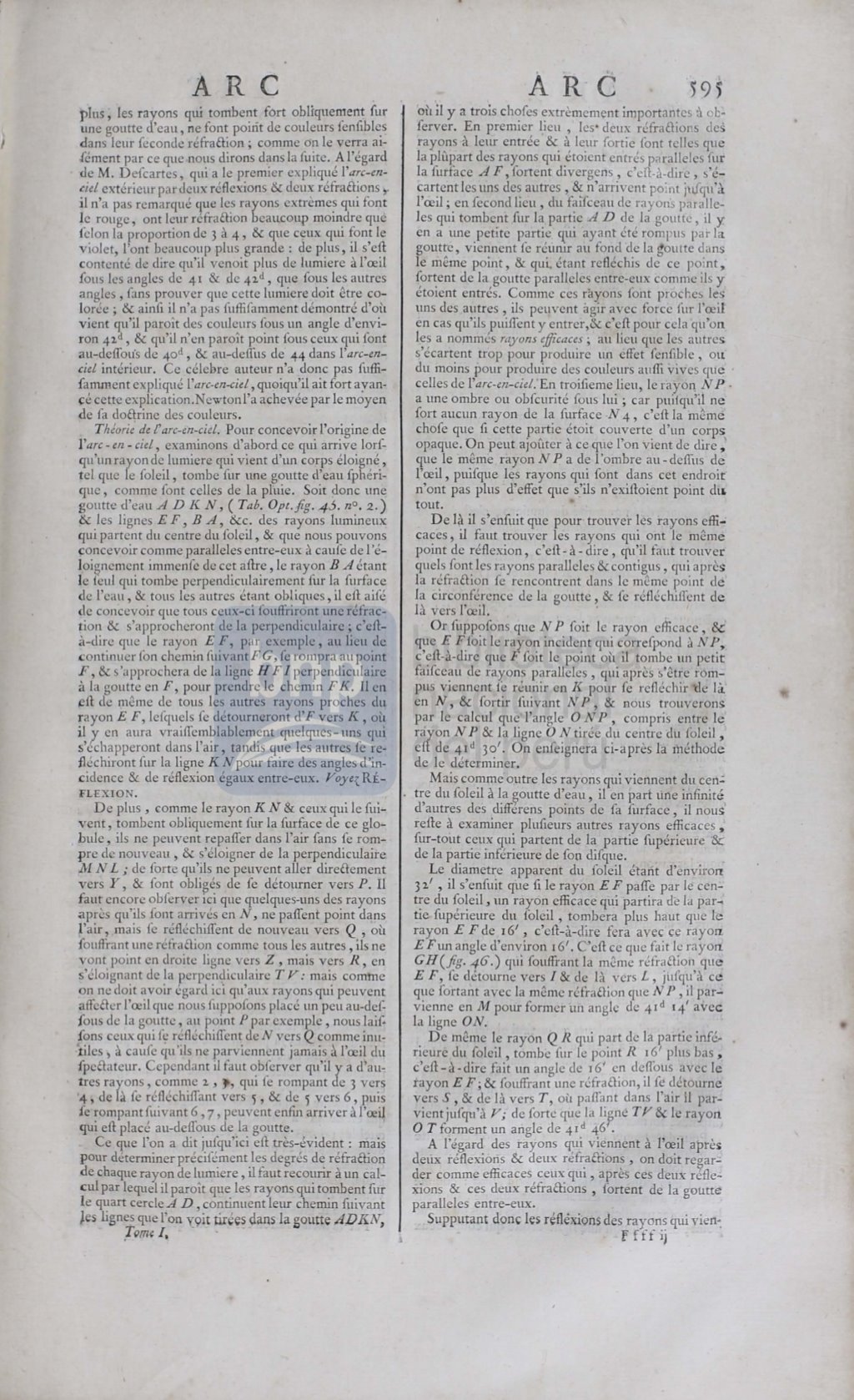
ARe
plus, (es rayons qui
tombe~t
fort obliquen:ent fur
une goutte d'eau, ne font pOlñt de couleurs
leníibl~s
dans leur feconde réfraél:ion ; comme on le yerra al–
{ément par ce que nous dirons dansla {uite. AI'égard
de M. De(cartes, qui a le premier expliqué
l'
trre-m–
cíel
extérieur pardeux réflexions & deux réfraél:ions
il n'a pas remarqué cJue
les
rayons extremes qui font
le rouge, ont leur refraél:ion beaucoup moindre que
(clon la proportion de
3
a
4, & que ceux qui fonr le
violet, l'ont beaucoup plus grande: de plus, ils'efl:
comenté de dire c¡u'il venoit plus de lumiere a I'reil
{OllS les angles de 41
&
de 42d, que (ous les autres
angles , 6ns prouver que cette lumiere doit etre co–
lorée ; & ainli il n'a pas (uffifammcnt démontré d'ol!
vienr qu'il parolt des couleurs (ous un angle d'envi–
ron 42d, & qu'il n'en paroJt point fous ceux qui {ont
3n-dcifOlISde 40d, & au-deírus de 44 dans l'
are-en–
cíel
intérieur. Ce célebre auteur n'a donc pas {uffi–
famment expliqué l'
arc-en-cieL,
quoiqu'il ait fort ayan–
ce cctte explication.Newtonl'a achevée par le moyen
de fa doél:rine des couleurs.
ThJarie de
l'
arc-en-ciet.
Pour concevoir I'origine de
l'arc
-
en
-
ciel,
examinons d'abord ce qui arrivc lorf–
qu'un rayon de lumiere qui vient d'lill corps éloigné,
tel que le foleil, tombe fur une goutte d'ean fphéri–
(Jue, comme (Ollt celles de la pluie. Soit donc une
gOlltte el'eau
A D
J(
N,
(
Tab.
Opt.{zg.
4.5.
nO.
2.)
&
le ligne
E F, B A,
&c. des rayons lumineux
qui partenr du centre du folcil,
&
que 1l0US pouvons
cOllcevoir comme paralleles entre-eux a cau(e de I'é–
loignemcnt immenfe de cet afue , le rayon
B A
étant
le leul qui tombe perpendiculairement fmla furface
de l'eau ,
&
tous les autres étant obliques, il efl: aifé
de cOllcevoir que tous ceux-ci fOllffriront une réfrac–
tion & s'approcheront de la perpendiculaire; c'efl:–
a-dire que le rayon
E F,
par exemple, au lieu de
continuer (on chemin fuivant
F G,
fe rompra au point
F,
& s'approchera de la ligne
H F 1
perpendiculaire
a la goutte en
F,
pour prendre le chemin
F K.
Il en
efl: de meme de tous les autres rayons proches du
rayon
E F,
lefquels fe détourneronr d'
F
vers
J(
,
Oll
iI
Y
en aura vraiifemblablement quelc¡ucs- uns qui
s'échapperont dans I'air, tandis qlle les autres fe re–
flécruronr fur la ligne
K N
pour faire des angles d'in–
cidence
&
de réflexion égaux entre-eux.
Vaye{
RÉ–
FLEXION.
De plus, comme le rayon
J(
N
&
ceux qui le fui–
vent, tombent obliquement fur la furface de ce glo–
bule , ils ne peuvent repaifer dans l'air fans fe rom–
pre de nouveau , & s'éloigner de la perpendiculaire
.M
N L
;
de (orte c¡u'ils ne peuvent aUer direél:ement
vers
Y,
&
(ont obligé de fe détourner vers
P.
Il
faut encore ob(erver ici que quelc¡ues-uns des rayons
apres qu'ils font arrivés en
N,
ne paifent pojnt dans
I'air, mais fe réfléchiífent de nouveau vers
Q
,
Ol!
fouffrant une réfraélion comme tous les autres , ils ne
ont point en droite ligne vers
Z,
mais vers
R,
en
s'é[oignant de [a perpendiculaire
T V:
mais comme
on ne doit avoir égard ici c¡u'aux rayons c¡ui peuvent
affeéler l'rei[ que nous fuppo[ons placé un peu au-def–
fous de la goutte, au point
P
par exemple , nous [aif.
fons celLX c¡ui fe; réfléchiifent de
N
vers
Q
comme inu–
tiles,
a
caufe qu'i[s ne parviennent jamais
~
l'rei[ du
fpeél:ateur. Cep ndanr il fam
~b(erver
c¡u'i[ y a d'au–
tres rayons, comme
2. ,
t,
qll1 le rompant de
3
vers
4 de la fe réfléchiifant vers ) , & de
S
vers 6, puis
fe rompantúüvant 6,7, pcuvent enfin arriver al'reil
qui ea placé au-deifous de la goutte.
e que I'on a dit jlúqu'ici ea tres-évident : mais
pour determiner précilcmenr les degrés de réfraél:ion
de chaque rayon de lumi re, ilfaut recourir a un cal–
cul par lequel il parolt que les rayons qui tombent fur
le C[uart cercle
A D
, concinuent leur chemin (¡Iivant
¡
S
lignes que l'on Y9it
cir '
es
d~s
la goutte
/lDKN,
,~m,I.
ARe
59)
O~I
il
Y
a trois chofes extremement importantes :\
01:–
{erver. En premier lieu , les' deux réfraélions de'
rayons
¡\
lem entrée & a leur {ortie font telles que
la plllpart de ra}'ons qui étoient entrés paralleles (ur
la furface
A F,
fortent divergens, c'cfi-a-dire, s'é–
cartent les uns des auttes ,
&
n'arrivent po:nt juJqu
'a
l'reil; en {econd lieu , dl! faifceau de rayons paralle–
les qui tombent fur la partie
A D
de la gOlllte , il
Y
en a lUle petite partie '{ui ayant éré roml'us par la
goutte, viennent
fe
réul11r au fond de la goutte d¡ll1s
le meme point,
&
qui. étant reflécru de ce point,
fortent de la gOlltte paralleles entre-eux comme ils
y
étoient entrés. Comme ces rayons lont proches les
uns des autres , ils peuvent agir avec force Itlr I'reil
en cas qu'ils puiífenty entrer,&
c'ea
pour cela qu'on
les a nommés
rtlrY()nS efficaces;
au lieu que les autres
s'écartent trop pour produire un effet reníible, Oll
dll moins pour produire des couleurs auffi vives que
celles de l'
arc-en-ciel.Enrroiíieme lieu, le rayon
N P
a une ombre ou ob(curité {ous lui ; car puiíqu'il ne
[on aucun rayon de la furface
N
4, c'efl: la meme
chofe que
fi
cette partie étoit COllverte d'un corps
opaque. On peut ajoí'tter a ce que l'on vient de dire,
que le meme rayon
N P
a de l'ombre au-deifus de
I'reil, puifque les rayons qui font dans cet endroit
n'ont pas plus d'efFet que
5)15
n'exifl:oient point
dl~
tout.
De
la
il s'enfuit que pour trouver les rayons effi·
caces, il faut trouver les rayons qui ont le meme
point de réflexion, c'ea -
a-
dire , C¡1I'il faut trouver
quels (ontles rayons paralleles &contigus, qui aprcs
la réfraél:ion fe rencontrent dans le meme point de
la circonférence de la goutte,
&
fe réfléchiifcnt de
la vers l'reil.
Or lilppofons que
N P
foit le rayon efficace,
&
que
E
Ffoit le rayon incident qui correfpond
¡)
N P,
c'ea-a-dire que
F
foit le point ou il tombe un petit
fauceau de rayon paraUeles, qui apres s'etre rom–
pus viennent
le
réunir en
K
pour fe refléchir 'de lit
en
N,
& {ortir (llivant
N P
,
&
nous trouverons
par le calcul que l'angle O
N P,
compris entre le
rayon
N P
&
la ligne O
N
cirée du centre du (oleil ,
ea
de 4ld
30'.
On enfeignera ci-apresla méthode
de le déterminer.
Mais comme outre les rayons qui viennent du cen':
tre du {oleil
a
la
~outte
d'eau, il en part une infinité
d'autres des differens points de (a furface, il nous
reae
a examiner pluíieurs autres rayons efficaces,
fur-tout ceux qui partent de la partie fupérieure
&
de la partie inférieure de fon difque.
Le diametre apparent du foleil étañt d'enviroll
32' ,
il
s'enfuit que íi le rayon
E F
paife par le cen–
tre du (oleil, un rayon efficace qui partira de la par.
tie fupérieure du {oleil , tombera plus haut que le
rayon
E Fde
16' , c'ea-a-dire fera avec ce rayoll
EFun
angle d'environ 16'. C'eace que fait le rayon
GH(fig·
46.)
qui fouffrant la meme réfraél:ion que
E F,
fe détourne vers
1
&
de la vers
L,
jilrqu'iI ce
que fortant avec la meme réfraél:ion que
N P
,
il par–
vienne en
M
pour former
un
angle de 41d 14' avec
la ligne
ON.
De meme le rayon
Q
k
c¡ui part de la parcie infé–
rieure du foleil, tombe fur le point
R
16' plus bas,
c'ea-a-dire fait un angle de ¡6' en deifolls avec le
rayon
E F;
& {ollffram une réfraél:ion, il [e dérourne
vers
S
,
&
de la vers
T ,
Oll paifant dans l'air 11 par–
vient jufqu'a
V;
de forte que la lipné
TV
& le rayon
O
T
fonnenr un angle de 4ld 46 .
A
l'égard des rayons qui viennent a 1'reil a¡m:$
deux réflexioris & deux réfraél:ions , on doit re
9
ar–
der comme efficaces ceux c¡ui , apres ces deux rcfle–
xions
&
ces deux réfraél:ions , fortent de la gotltte
paralleles entre-elLX.
Supputant done
le~
réfléxlons des farons qui vien–
f
fH
jj
















