
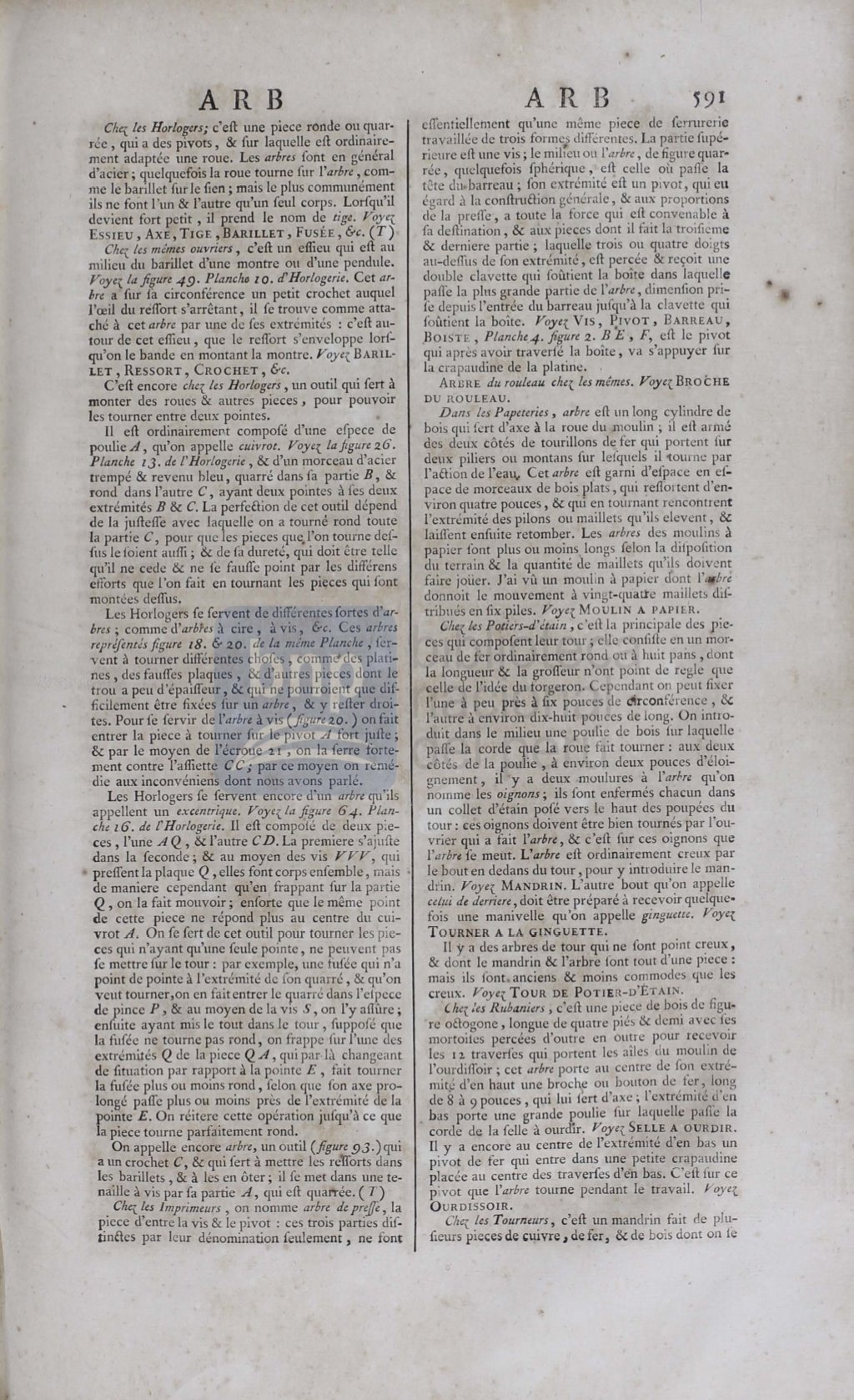
ARB
Che'{ les Horlogers;
c'eft une piece ronde ou quar·
ree , qui a des pivots,
&
[ur laquelle eft ordinaire–
ment adaptée une roue. Les
arbres
[ont en genéral
d'acier; quelquefois la roue tourne [ur
l'arbre,
com–
me le barillet [urle /ien ; mais le plus comnnmément
ils ne font l'un
&
l'autre qu'un [eul corps. Lor[qu'ü
devient fort petit , ü prend le nom de
tige. VOye'{
ESSIEU, AXE, TIGE ,BARILLET, FUSÉE,
&c. (T)
Cher les mémes oUllriers,
c'eft un effieu qui eft au
milieu du barillet d'une montre ou d'une pendule.
Voyer la figure
49.
Planche
la.
d'Horlogerie.
Cet
ar–
bre
a [ur
ÚI
circonférence un petit crochet auqllel
l'oeil du reffort
s'arr~tant,
il [e trouve comme atta–
ché a cet
arbre
par une de [es extrémités : c'eft au–
tour de cet effieu, que le reffort s'enveloppe lor/:'
qll'on le bande en montant la montre.
Voye{
BARIL–
LET, RESSORT, CROCHET,
&c.
C'eft encore
clu{
les B or/ogers
,
un outil qlÚ [ert a
monter des roues
&
autres pieces , pour pouvoir
les tourner entre deux pointes.
Il
eft ordinairemeI't compo[é d'une e[pece de
poulie
A,
qu'on appelle
cuillrot. Voye{ lajzgure
26.
Planche
l3.
de [,BorLogerie,
&
d'un morceau d'acier
trempe
&
revenu hleu, quarré dans [a partie
B,
&
rond dans l'autre
C,
ayant deux pointes a [es deux
extrémités
B
&
C.
La perfeétion de cet outü dépend
de la jufteffe avec lac[uelle on a tourné rond toute
la partie
C,
pour quc les pieces que.J'on tourne def–
rus
le
[oient auffi;
&
de fa dureté, qui doit
~tre
telle
qu'il ne cede
&
ne [e faulfe point par les différens
efforts que I'on fait en toumant les pieces qui [ont
montees delfus.
Les Horlogers [e {ervent de différentes [artes d'
ar–
bres;
comme
d'arMes
a cire,
a
vis ,
&c.
Ces
arbres
repréfends figure
l8.
&
20.
de la mime Planche,
[cr–
vent
a
tourner différentes cho[es , comme' des plati–
nes , des fauffes plaques,
&
d'autres pieees dont le
trou a peu d 'épaiffeur ,
&
qui ne pounoient que dif–
ficücment
~tre
fixées
[lIT
un
arbre,
&
V
refter droi–
tes. Pour [e [ervir de l'
arbre
a vis
(figule
2.0.
)
on fait
entrer la piece
a
tourner [ur le pivot
A
fort jufte;
&
par le moyen de l'écroue
11 ,
on la [erre forte–
ment contre l'alliette
CC
;
par ce moyen on reme–
die allX inconvéniens dont nous avons parlé.
Les Horlogers [e [ervent encore d'un
arbre
qu'ils
appellent un
excentri'lue. Voye{ la figure
64-
Plan–
che
l6.
de t'Hor/oguie.
Il eft compo'lé de deux pie–
ces, I'une
A
Q
,
&
1'autre
CD.
La premiere s'ajufie
dans la feconde;
&
au moyen des vis
rvv,
qui
preffent la plaquc
Q
,
elles font corps
enfemble,
mais
de maniere cependant qu'en frappant [ur la partie
Q,
on la fait mouvoir; enforte que le m@me point
de cette piece ne répond plus au centre du cui–
vrot
A.
On [e [ert de cet
outíl
pour tourner les pie–
ces qui n'ayant qu'une [eule pointe, ne peuvent pas
fe mettre fur le tour : par exemple, une fÍlfée qui n'a
point de pointe a l'extrémité de ron quarré ,
&
qu'on
veut tourner,on en faitentrer le qtlarré dans l'elpece
de p!nce
P>
&
a.u moyen de la vis
S,
on I'y aíITlre;
enfUlte ayant nus le tout dans le tour, [uppofé que
la ftúée ne tourne pas rond, on frappe [ur l'tUJe des
exrrémités
Q
de
la
piece
Q
A
,
qui par·la changeant
de útuation par rappon a
la
pointe
E
,
fait tourncr
la fufée plus ou moins rond,
[elon
que ron axe pro–
longé paíl'e plus ou moins pres de l'extrémité de la
pointe
E.
On reitere cette opération jufqu'a ce que
la piece tourne parfaitement rondo
On appelle encore
arbre,
un outü
(figure
93.) qtú
a un crochet
C,
&
qui [ert
a
mettre les reITorts dans
les, barillets ,
&
a les en oter; ü [e met dans une te–
nallle a vis par {a parrie
A,
qlú eft quarrée. (
T)
. Cite'{ !es
J
mprim~urs
,
0r:
nomme
arbr~
de pr.effi,
la
~Iece
d entre la VIS
&
le
plvOt : ces trOIS partles dif–
tmétes par IcUT dénomination feulement, ne font
ARB
clfenticlletncnt qu'une m@me piece de ferrurerie
travaillée de trois formes Jifférentes. La partie fupé–
rieure e!l: une vis; le mil:eu ou
I'arbre,
de figure quar–
rée , quelqtlefois fphérique, e!l: celle oh paíle la
tete du.barreau ; ron extrémité eft un plVOt , qui en
égard
a
la conftruétion générale,
&
allX proportions
de la preífe, a toute la force qui efi convenable
a
{¡1
deftination ,
&
aux picces dont
il
fait la troifieme
&
derniere partie; laquelle trois ou qllatre doigts
all-defflls de ron extremité, eft percée
&
res;oit une
double c1avctte qui CoutÍent la bOlte dans laquelle
paffe la
plus
grande partie de
l'arbre,
dimen/ion pri–
[e depuis l'entrée du barreau juCqu'a la clavette qui
{otltient la bolte.
Voye{
VIS,
~IVOT,
BARREAU,
.B0I5TE,
Planche4- figure
2..
BE, F,
eft le pivot
qui apres avoir traverfé la bOlte, va s'appuyer [ur
la
crapaudine de la
platine. .
AltERE
du rouleau che{ les mémes. Voyt{
BRO CHE
DU ROULEAU.
D alls les Papeteries, arbre
eft un long cylindre de
bois 'lui fert d'axe a
la
roue du moulin ; il eft armé
des deux cotés de tourillons de fer qui portent fur
dellx piliers ou montans [ur lefquels il 1:ourne par
l'aétion de I'eau,. Cet
arbre
eft garni d'efpace en e[–
pace de morceaux de bois. plats, qlli reílol tent d'en–
viran quatre pouees ,
&
C[ui en tournant rencontrent
I'extrémité des pilons ou maillets qu
'ils
elevent,
&
laj{[ent enfuite retomber. Les
arbres
des moulins
él
papier [ont plus ou moins longs
[elon
la di(po/ition
du terrain
&
la quantité de maillets qu'ils dOlvcnt
faire joiier. J'ai Vll un moulin
a
papier dont
I',.bre
donnoit le mouvement
a
vingt-quatl'e maillets dif–
triblles en /ix piles.
Voye{
MOULlN A PAPIER.
Che{ tes Potiers-d'üain ,
c 'eft la principale des pie–
ces qui compo[ent leur tour; clle confifie en un mor–
ceau de
ter
ordinairement rond ou
iI
hlút pans , dont
la longueur
&
la groíl'ellr n'ont point de regle que
celle de I'idée du torgeron. Cepcndant on peut fuer
l'une
iI
peu pres a /ix pouces de circonférence ,
&
l'autre
a
environ dix-huit pouees de
long.
On inrro–
duit dans le milieu une poulie de bois lur laquelle
paíle la corde que la roue fait tourner: aux deux
cotés de la poulie , a environ deux pouces d'éloi–
gnement, il ·y a deux muulllres
a
l'arbre
qu'on
nomme les
oignons;
ils font enfermés chacun dans
un collet d'étain po{é vers le haut des pOllpees du
tour : ces oignons doivent @tre bien tournés par l'ou–
vrier qui a fait
l'arbre,
&
c'eft Cur ces oignons que
l'
arbre
fe mellt. L'
arbre
efi ordinairement creux par
le bout en dedans du tour, pour y introduire
le
man–
drino
Voye{
MANDRIN. L'autre bout qu'on appelle
ceLlli
de derriere,
doit @tre preparé a recevoir quelque.
fois une manivelle qu'on appelle
gingueue. Voye{
TOURNER A LA GINGUETTE.
Il
ya des arbres de tour qui ne [ont point
c~eux,
&
dont le mandrin
&
l'arbre font tour d'une plece :
mais
ils
font.anciens
&
moins commodes que les
creux.
Voye{
TOUR DE POTIER-D'ÉTAIN.
(/ter
les Rubaniers,
c'eft une piece de bois de figu–
re oét?gone, 10,ngue de quatre piés
&
demi avec
{~s
mortOlles percees e1'outre en outre pour receVOlr
les
11
traverfes qui portent
les
aües du moulin de
I'ourdiíloir; cet
arbre
porte au ccntre de
[0!1
extre–
miti
d'en ham une
~ro~~e
ou, bouto,n de ,te:"
1~lIg
de
8
a
9
pOllces , qUl 1m len; d axe; 1extremlte d en
. bas porte une grande pou[¡e fm laquelle paffe
la
corde de la [elle a ourdír.
Voye{
SELLE A OURDIR.
Il
y a encore al! centre de
l'extrémi~é
d'en has .un
pivot de fer
cflll
entre dans une petlte crapaudme
placee au centre des traverfes d'en baso C'ell: {ur ce
pivot que
l'arbre
tourne pendant le travail.
Voye{
OURDISSOIR.
Che'{ les Tourmurs,
c'eft un manelrin fait de plu–
/ieurs pieces de cuivre, de fer,
&
de bois dont on
¡¡~
















