
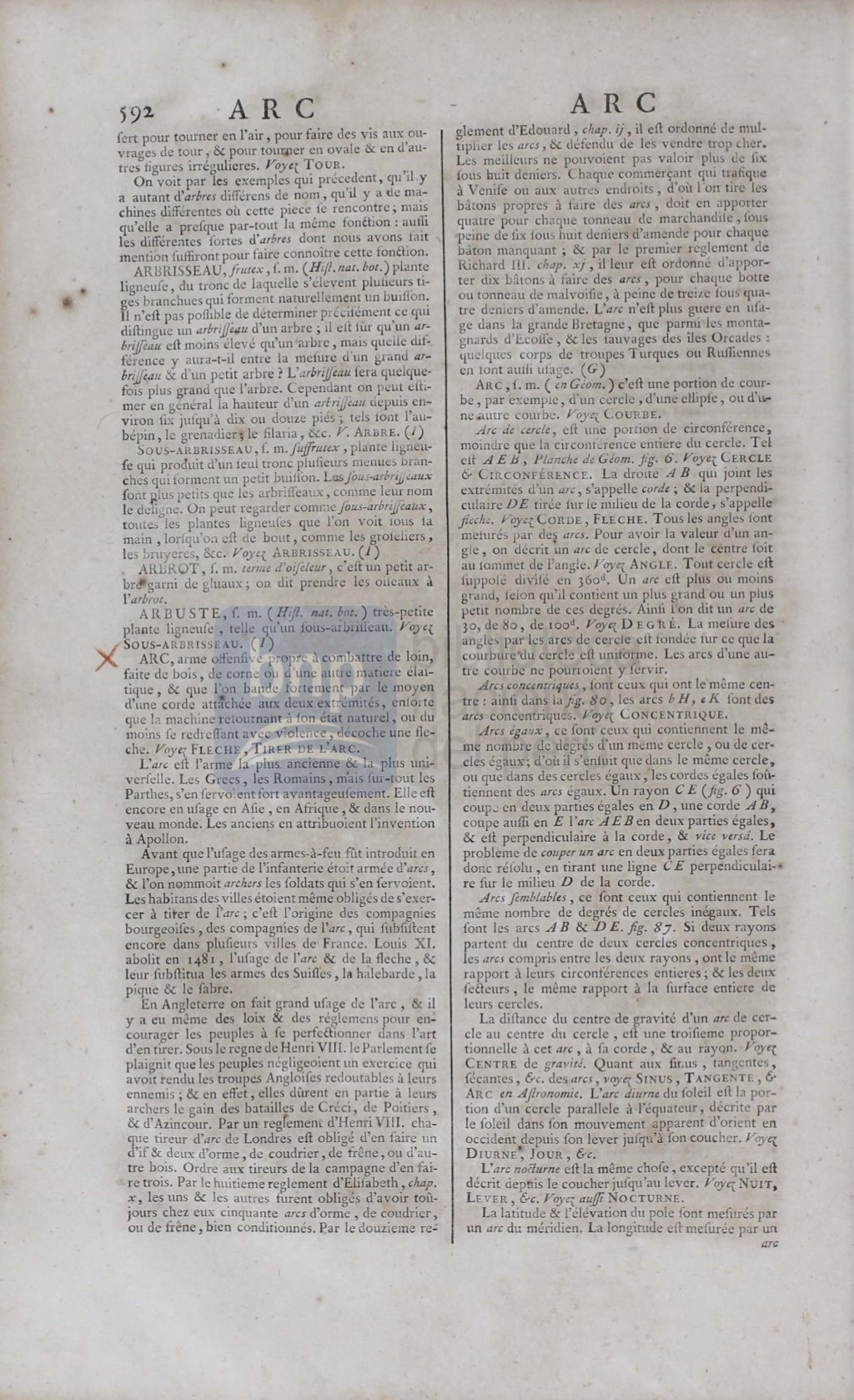
ARC
fert pour tOl1rner en I'air, pour faire des vis aux ou–
vrages de tour,
&
pour tourner en ovale
&
en d'au-
tres figures irrégl1lieres.
Voyt{
TOUR.
.
On voit par les exemples qui préce.dent, qu
'11
y
a autant
d'arhres
diíférens de nom, ql1'il ya de ma–
chines différentes ou cette piece fe rencontre; mais
qtl'elle a prefque par-tout la mcme fonélion: auí!i
les di/fére:1tes {ortes
d'arbres
dont nous avons talt
mention fuffiront pour faire connoitre cette fonélion.
ARBRISSEAU
frutex,
f.
m.
(Hip.natobot.)
plante
ligneLl[e , du
tron~
de laquelle s'e1event
plubeur~
ti–
ges branchues qui forment naturellement un buúlon.
11
n'efr pas poflible de déterminer préc.:ifément ce qui
difringue un
a~br1J,eau
?'Ul;
arbre ;
11
efl: 1.tir qu'un
~r
brif{ea¡¿
ell: mOlns eleve qu un ?sbre , mals quelle
dif–
férence y aura-t-il entre la mefme d'un grand
ar–
hriffiau
&
d'un petit arbre?
L'arbrijJeau
(era
quelqtl(~fois plus grand que l'arbre. Cependant on peut
ell!–
mer en général la hauteur d'un
arf:.rifJeau
depuis en–
viron fIx jufqu'a dix ou dome piés; tels lont I'au–
bépin, le grenadier; le filaria, &c.
Y.
ARBRE.
(/)
SOUS-ARBRISSEAU, f.
m.jitifrutex
,plante ligneu–
fe qui produit d'un leul tronc plufieurs menues bran–
ches qui torment un petit buiflon.
Lesjims-arbr!JJeaux
font ¡;¡lus petits que les arbriíreaux, comme leur llom
le ddi ..,ne. On peut regarder cOJl1Lle
flus-arbrif{eaux ,
toute,"les plantes ligneufes que 1'0n voit IOUS la
main , 10r!Clu'01l cfr de bout, comme les groiehers>
les bruycrcs, &c.
Voyt{
ARBRISSEAU.
(1)
ARhROT,
f.
m.
terme d'oiféleur,
c'efr un petit ar–
br garni de gluaux; 011 dit prendre les oI1eaux
a
l'arbrot.
AR BU STE,
f.
m.
(Hifl. nato hot.
)
tres-petite
plante lignel1Ce , relle qu'un iou:.-arbrilfeau.
Voye{
·V
SOUS-ARBRISSEAU.
(1)
/' ARC, arme otfenlive propre
a
combattre de loin,
faite de bois, de come ou d'une autre matlere élal–
ti,ue, & que I:on ,bande fortement, par, le moyen
d une cOl'de attachee aux deux extrcmltes , enlol te
que la machine retournant
a
(on état natllrel, OU du
mOlns fe redre(rant avec violence, décoche une fle–
,he.
Voye{
FLECHE, TIRER DE L'ARC.
L'are
efr I'arme la plus ancienne
&
la plus uni–
verfelle. Les Grecs , les Romains , m'ais
li.lr-tOllt les
Parthes, s'en fervo:ent fort avantagellfemenc. Elle efr
encore en ufage en Alic , en Afrique ,
&
dans le nou–
veau monde. Les anciens en attríbuoient I'invention
a
Apollon.
Avant que I'u(age des armes-a-feu fftt introduit en
Europe, une partie de I'infanterie étoit armée
d'ares,
&
I'on nommoit
arehers
les foldats qui s'en fervoient.
Les habitans desvilles étoient meme obligés de s'exer–
cer
a
titer de
Pare;
c'efr l'origine des compagnies
bourgeoifes, des compagnies de
I'are,
qui fubliíl:ent
encore dans plulieurs villes de France. Louis XI.
abolit en
1481,
I'ufage de l'
are
&
de la fleche &
l~ur
fubfrima les armes des Suilres , la halebarde', la
pique
&
le fabre.
En Angleterre on fait grand ufage de l'arc,
&
il
Y a eu meme des loix
&
des réglemens pour en–
courager les peuples
a
fe perfeélionner dans l'art
d'en tirer. Sous le regne de Henri VIlLleParlement fe
plaignit que les peuples négligeoient un exercice qui
avoit rendu les troupes Angloifes redoutables
a
leurs
ennemis ;
&
en e/fet, elles dllIent en partie
a
leurs
archers le gain des batailles de Créci, de Poitiers
&
d'Azincour. Par un regfement d'Henri Vnf.
cha~
que tireur
d'are
de Londres efr obligé d'en faire un
d'if
&
.deux d'orme , de coudrier, de frene, ou d'au–
tre b,?ls. Ordre aux tireurs de la campagne d'en fai–
re trols. Par le huitieme reglement d'Elifabeth ,
ehap.
::' les uns
&
les. autres furent obligés d'avoir tOll–
JOurs chez eux. cmquante
ares
d'orme , de coudricr,
Ol!
de fi'ene, bIen condirionnés. Par le douzieme re-
ARC
glement d'Edouard ,
ehap.
ij,
íl efr ordonné de mul–
tiplier les
ares,
&
défendu de les vendre trop (her.
Les meillellIs ne pouvoient pas valoir plus de lix
fous buit deniers. haque commerc;ant qui trafique
a
Venife ou aux autres endlOits, d'Oll ]"orr tire les
batons propres
a
faire des
ares,
doit en apporter
quatre pour chaque tonneau de marchandile, lous
peine de (¡x 10us hUlt deniers d'amcnde pOllI chaque
baton manquant ;
&
par le premier reglement de
Richard
lIL
ehap. xj ,
¡lleur efr ordonné d'appor–
ter dix biltons
a
faire des
ares,
pour chaque borte
ou tonneau de malvoilie,
a
peine de treize lous qua–
tre deniers d'amende.
L'are
n'efr plus guere en ula–
ge dans la grande Bretagne, que parnu les monta–
gnards d'Eco!1e,
&
les lauvages des ues Orcades :
Ifue!ques corps de troupes Turc¡ues ou RtúJiennes
en tont aulh ullge.
(G)
ARC ,
l.
m. (
en G"om.
)
c'efr une portion de cour–
be, par exemple, d"t1l1 cerele , d'une eHiple, ou d'u,–
ne.auue combe.
Voye'{
COURBE.
.Are
d~
cerele,
efr une portion de cireonférenee.
moindre que la circollterence entiere du cerc!e. Te!
elt
A
E
Jj
,
Planche
d~
Glom.
fig.
6.
Voye{
CERCLE
&
CmcoNFÉRENCE. La drOlte
A B
qtll jOll1t les
extrénutés d'un
are,
s'appelle
eorde
;
&
la perpendi–
culaire
DE
tirée 1m le nulieu de la corde, s'appeHe
jlee"". Voye{
CORDE, FLECHE. Tous les angle:. iont
meiurés par
de~
ares.
Pour avoir la valeur d'un an–
gle , on décrit un
are
de cercle, dont le centre loít
au ¡ammet de,l'ang!e.
Vqy.,¡:
ANGLE. TotIt cerele efr
fuppolé diviié en 360d. Un
are
efr plus ou moins
grand, ¡e1on qu'jl contient un plus grand ou un plus
petIt nombre de ces degrés. Ainú ron dit un
are
de
30, de 80, de 100d.
Voyer
D EGR
É.
La meiúre des
angles par les ares de cercJe eH tondée lur ce que la
cOllrbtu'e'du cercle ea unIÍorme. Les ares d'U11e au–
tre combe ne pounoient y íervir.
Ares eoneentriques
,
font ceux 'Iui ont le meme cen–
tre : ain{¡ dans la
jig.
8
O, le:. ares
bH,
e
K
font des
ares
concentriquc5.
Voyet
CONCENTRIQUE.
Ares ¿gaux,
ce fOil! ceux qui contiennent le me–
me nombre de degrés d'un meme cercle , ou de cer–
eles égaux; d'ou il s'enluit que dans le meme eerele.
ou que dans des cercles égaux, les cordes égales fOtl–
tiennent des
ares
égaux. Un rayon
e
E
(!tg.
6 )
qui
coup.:: en dellx parties égales en
D,
une corde
A B,
coupe auffi en
E
I'are A
E B
en deux parties égales,
&
eH perpendiculaire
a
la corde,
&
yice
Yersá.
Le
probleme de
eouper un are
en deux parcies égales fera
done réfolu, en tirant une ligne
CE
perpendiculai.·
re ftlI le milieu
D
de la corde.
Ares flmhLables
,
ce font ceux qui contiennent le
meme nombre de degrés de cercles inégallx. Tels
font les arcs
A B
&
DE.
fig.
8:;.
Si deux rayons
partent du centre de deux cercles concentriques,
les
ares
compris entre les denx rayons, ont le meme
rappore
a
lellIs eirconférences entieres;
&
les dellx
feélenrs , le meme rapport a la furface entiere de
lenrs cercles.
La diíl:ance du centre de gravité d'un
are
de cer–
ele au centre dn cercle , efr une troilieme propor–
tionnelle
a
cet
are,
a fa corde,
&
au rayon.
Voyt~
CENTRE de
grayit¿.
Quant aux lir,us, tangentes ,
fécantes,
&e.
des
ares, vqyer
SINUS, TANGENTE,
&
ARC
en AJlronomie. L'are diume
du foleil efr la por–
tion d'un cerele parallele
a
l'équatellr, décrite par
le foleil dans fon mOllvement apparent d'orient en
occident ,depuis fon lever jufqu'a l'On couehcr.
Vqyer
DlURNE,
J
OUR,
{,·e.
L'
are noaurne
efr la meme chofe, excepté qu 'il eft
décrit cieplÚs le coucher jufqu'au lever.
Voy"t
NUIT,
LEVER,
&e. Voytt auJ!i
NOCTURNE.
La latitud;
~.r'élévation ~u
pole font !l1efurés par
un
are
du mendlen. La longltude eíl: mc!urée par un
are
















