
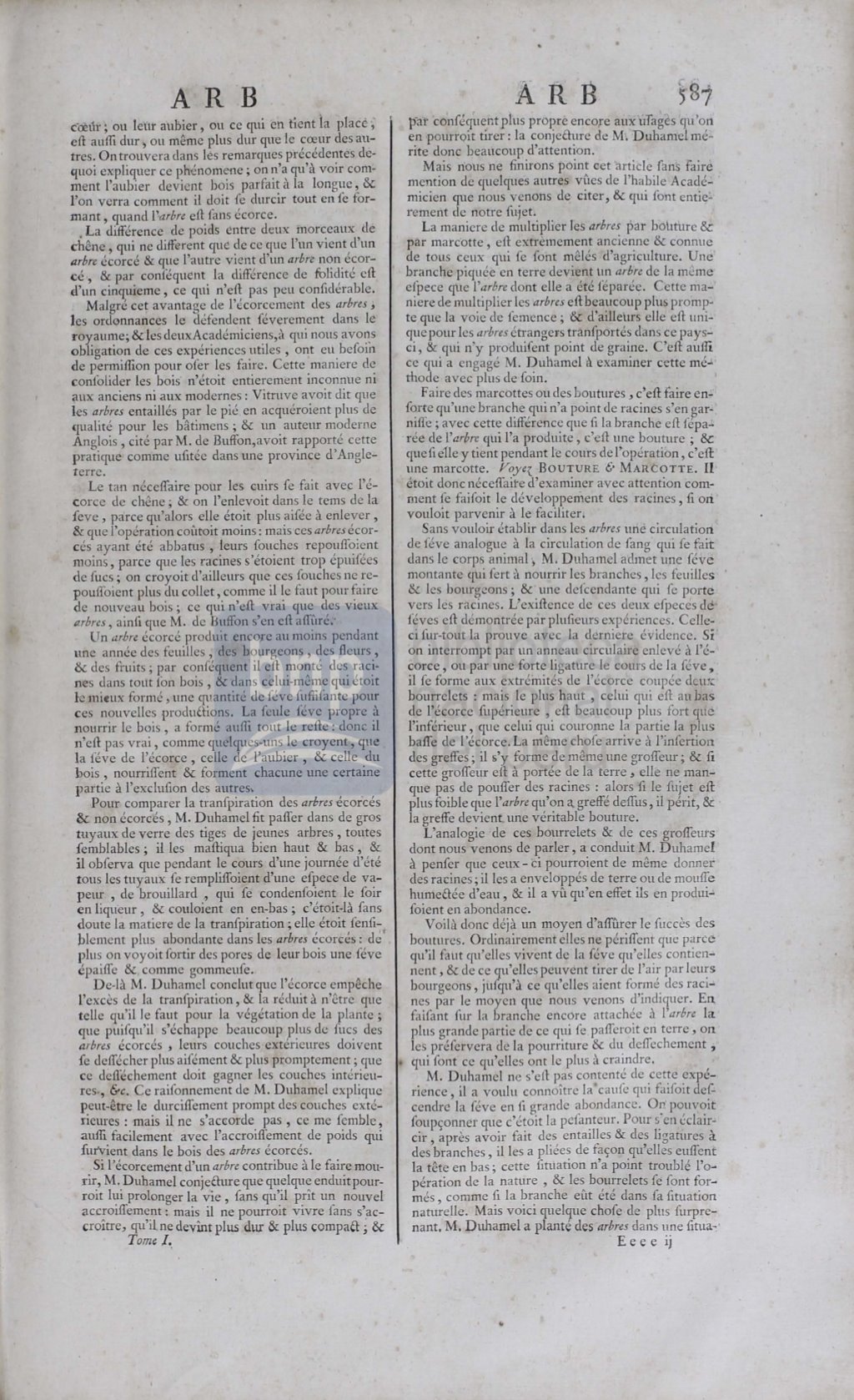
ARB
c"&lh;
011
¡eur auoier, on ce qui en nent
la
place;
cl1: auffi dur
~
ou meme plus dur que le cceur des au–
tres. On trouvera dans les remarques précédentes de–
quoi expliquer ce phénomene ; on n'a c¡u'iI voir com–
ment l'aubier devient bois parfait
a
la longue,
&
l'on vcn'a comment il doit fe durcir tout en fe for–
mant, c¡uand
l'arbre
eíl: (ans écorce.
. La différence de poids entre deux morceaux de
chene , c¡ui ne diffl'rent c¡ue de ce c¡ue l'un vient d'un
arbre
écorcé
&
que l'autre vient d'un
arbr~
non écor–
cé,
&
par conféquent la différence de folidité eíl:
d'un cinquieme, ce qui n'el1: pas peu conftdérable.
Malgré cet avantage de l'écorcement des
arbres,
les ordonnances le défendent (éverement dans le
royaume;
&
les deuxAcadémicisns,a c¡ui nous avor:s
obligation de ces expériences utiles , ont eu befoin
de permiffion pour o(er les faire. Cette maniere de
coniolider les bois' n'étoit entierement inconnue ni
aux anciens ni aux modernes: Vitruve avoit dit que
les
arbres
entaillés par le pié en acqnéroient plus de
'lualité pour les batitnens;
&
un auteur moderne
Anglois, cité par M. de Buffon,avoit rapporté cetre
pratique comme ulitée dans une provinee d'Angle–
terreo
Le tan néceffaire pour les cuirs (e fait avec l'é–
coree de chene;
&
on l'enlevoit dans le tems de la
{eve, parce qu'alors elle étoit plus ai[ée a enlever ,
&
que I'opération coutoit moins: mais ces
arbres
écor–
eés ayant été abbatus , leurs [ouches repouffoient
Jlloins, parce que les racines s'étoient trop épuifées
de [ucs; on croyoit d'ailleurs que ces [ouches ne re–
poufi'oient plus du collet, comme ille faut pourfaire
de nouveau bois; ce c¡ui n'efi vrai que des vieux
arbres,
ainft c¡ue M. de Buffon s'en eíl: aífllré..
Un
arbre
écorcé produit encoJe au moins pendant
une année des feuilles , des bourgeons , des f1eurs ,
&
des fruits; par con[équent il eíl: monté des raci–
nes dans tont 10n bois,
&
dans celui-meme c¡ui étoit
le
mifUX formé, une c¡uantité de [éve fuf!i[ante pour
ces nouvelles produilions. La feuie féve propre a
110urrir le bois, a formé auffi tout le reíl:e: done ii
11'el1: pas vrai , comme quelques-uns le croyent, que
la féve de l'écorce , celle de l'aubier,
&
eelle du
bois , nourriffent
&
forment chacune une certaine
partie a l'exclufton d s autres,
POllr
comparer la tranfpiration des
arbres
ét::orcés
&
non écorcés , M. Duhamel lit paífer dans de gros
tuyaux de verre des tiges de jeunes arbres, toutes
{emblables; illes maíl:ic¡ua bien haut
&
bas,
&
il
oHerva que pendant le cours d'une journée d'été
tous les tuyaux [e rempliffoient d'une efpece de va–
peur , de brollillard ., c¡ui fe condenfoient le foir
en lic¡ueur,
&
couloient en en-bas; c'étoit-la fans
doute la matiere de la tranfpiration; elle étoit fenft–
blement plus abondante dans les
arbres
écorcés; de
plus on voyoit fonir des pores de leur bois une féve
épaiífe
&
comme gommeufe.
De-la M. Duhamel conclutque l'écorce empeche
l'exd:s de la tranfpiration,
&
la réduit a n'etre que
telle qu'il le faut pour la végétation de la plante;
que puifqu'il s'échappe beaucoup ,Plus de [ucs des
Ilrbres
écorcés , leurs couches exterieures doivent
fe deffécher plus aifément
&
plus promptement ; que
ce dellechement doit gagner les couches intérieu–
res·,
&c.
Ce raifonnement de M. Duhamel explique
peut-etre le durciffement prompt des couches exré–
riemes : mais
iI
ne s'acGorde pas, ce me femble,
auffi facilement avec l'accroill'ement de poids qui
{utvient dans le bois des
arbres
écorcés.
Si I'écorcement d'un
arbre
contribue
a
le faire mon–
rir,
M.
Dubamel conjefuue que quelqlle enduitpour–
roit 1\li prolonger la vie, fans qu'il prlt un nouvel
accroJifement: mais il ne pourroit vivre fans s'ac–
¡;roltre, qu'ilne devmt plus
dm'
&
plus ,ompaa;
&
Tome!..
ARÉ
p-al' conféquent plus propre enco,e aux uTages qu 'on
en pourroit tirer: la conjefulre de M. Duhamelmé–
rite donc beaucoup d'attention.
Mais notts ne linirons point cet ·article f:tns faire
mention de quelques autres viles de l'habile Acadé–
micien qne nous venons de citer,
&
qui font
entie~
rement de notre fujet.
La maniere de multiplier les
ar'pres
par hobture
&
par marcotte, eíl: extJ.·emement ancienne
&
connue
de tons ceux qui fe [ont melés d'agriculture. Une
branche pic¡uée en rerre devient Un
arbre
de la meme
elpece (¡tle
I'arbre
elont elle a été féparée. Cette ma–
niere de multiplier les
arbrts
eíl:beaucoup plus promp–
te que la voie d'C [emence;
.&
d'ailleilrs elle eíl: uni–
que pour les
arbres
étrangers tranfportés dans ce pays–
ci,
&
c¡ui n'y produifent point de graine. C'eíl: auíIi
ce 'lui a engagé M. Duhamel
a
examiner cette mé..\
mode avee plus de [oin.
Faire des marcottes ou des Loutures , c'eíl: faire en!
forte qu'une branche qui n'a point de racines s'en $ar–
niffe ; avec cette différence (lue fi la branche el1: fepa–
rée de
l'arhre
'lui l'a produite, c'eíl: une boutme ;
&
queft efle y tient pendant le cours de l'opération, c'efi
une marcotte.
Yoye{
BOUTURE
6>
MARCOTTE.
II
étoit donc néceffaite d'examiner avec atrention com–
ment fe faifoit le développement des racines, ft on
vouloit parvenir a le faciliter,
Sans vouloir établir dans les
arbres
une circulation
de féve analogue a la circulation de fang qui fe fait
dans le corps animal, M. Duhamel adme, une féve
montante c¡tli fert
a
nourrir les branches, les feuilles
&
les bourgeons;
&
une detC:endante qui fe pone
vers les racines. L'exiíl:ence de ces deux efpeces de
féves eíl: démontrée par plufieurs expériences. Celle–
cí fur-tout la prouve avec [a derniere évidence. Sr
on interrompt par un anneau circu1aire enlevé a l'é–
coree, ou par une forte ligatme le
COU1'S
de la féve,
il fe forme aux extrémités de l'écorce conpée dculC
bourrelets : mais le plus haut , celui qui eíl: au bas
de l'écorce [upérieure , eíl: beaucoup plus fort que
l'inférieur, c¡ue celui c¡ui couronne la partie la plus
baffe de l'écorce. La meme chofe arrive
a
l'infertion
des greffes;
iI
s'y forme de meme une groffeur;
&
ft
cetre groífeur eíl: a portée de la telTe , elle ne man–
que pas de pouífer des racines : alors
1i
le fujet eíl:
plus foiblec¡ue
l'arbre
qu'on a.greffé deffus, il périt,
&
la greffe devient une véritable boutme.
L'analogie de ces bourrelets
&
de ces grofi'eurs
dont nous venons de parler, a conduit M. DuhameI
a penfer que ceux -
ti
pourroient de meme donner
des rat::ines; illes a enveloppés de terre ou de mouífe
humeaée d'eau ,
&
il a
vU
qu'en effet ils en produi–
[oient en abondance.
Voila donc déja un moyen d'afffrrer le fucces des
boutures. Ordinairement elles ne périífent c¡ue parce
qu'il faut qu'elles vivent de la féve qu'elles conticn–
nent,
&
de ce qu'elles peuvent tirer de I'air par leurs
bourgeons, jufc¡u'a ce c¡u'elles aient formé des raci–
nes par le moyen que nous venons d'indic¡uer.
En
faifant fur la branche encore attachée
a
l'
arbre
la
plus grande partie de ce qui [e paíferoit en terre, on
les préfervera de la pourriture
&
du deífechement ,
(lui [ont ce qu'elles ont le plus
a
craindre.
M. Duhamel ne s'ell pas contenté de certe expé–
rience, il
a
voulu connolrre la'caufe qui faifoit def-.
cendre la féve en ft grande abondance. On'pouvoit
[oupc;:onner que c'étoit la pefaI?teur. Pour s.'en éclair–
cir apres avoir fait des entailles
&
des hgantres
a
des'branches, illes a pliées de fac;:on c¡u'elles euífent
la tete en bas; certe ftntarion n'a point troublé
l'o~
pération de la nature ,
&
les bourrelets fe font for–
més, comme fl la branche ellt été dans fa fituation
natmelle. Mais voici
quel~ue
chofe de plus furpre–
nant. M. Duhamel a plante eles
arbres
dans une fttua-
E
e e e ij
















